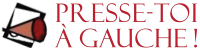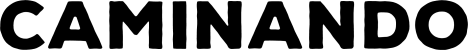Derniers articles
Québec : des organismes dénoncent la militarisation de l’économie aux dépens de la transition écologique et de la justice sociale
Les élections municipales ont un impact sur la scène politique centrale

Le sens et la portée du choix de Sol Zanetti comme porte-parole masculin de Québec solidaire

L'élection de Sol Zanetti avec plus de 50,4 % des voix reflète une recomposition des équilibres internes au sein de Québec solidaire. La majorité de la députation s'était rangée derrière Étienne Grandmont, qui a obtenu 37,9 %. Il n'était pas identifié comme le porteur du projet indépendantiste, mais plutôt comme un député centré sur le travail parlementaire et le soutien aux luttes sociales. Le soutien à Yv Bonnier Viger était d'abord motivé par le désir d'avoir un porte-parole qui ne soit pas membre de l'équipe parlementaire et qui fasse de la reconstruction des associations électorales l'essentiel de son travail. Cette approche n'a toutefois attiré que 9,2 % des membres de Québec solidaire.
Sol Zanetti a bénéficié du ralliement des indépendantistes du parti — notamment des ancien·nes militant·es d'Option nationale — ainsi que de figures comme Ruba Ghazal, qui partage avec lui une vision d'une indépendance ouverte et inclusive. La majorité des membres qui ont voté pour Sol Zanetti y ont sans doute vu un moyen de réaffirmer le projet indépendantiste comme préoccupation essentielle du parti.
Cette élection se traduira donc par un renforcement de la place de l'indépendance dans le profil et la communication de Québec solidaire. Dans le contexte des élections à venir et de la perspective d'un éventuel référendum, le choix des membres visait à replacer Québec solidaire au centre d'un champ politique redéfini par la question nationale.
Son discours d'inauguration
Le discours inaugural de Zanetti a insisté sur l'indépendance comme projet démocratique, social et inclusif, ouvert aux personnes immigrantes et aux nations autochtones, rompant ainsi avec la tradition souverainiste du PQ, fondée sur une conception plus fermée de l'identité québécoise. Ruba Ghazal a repris cette ligne et a formulé une critique bien sentie des propos de PSPP sur la prétendue responsabilité des personnes migrantes dans les maux vécus par la société québécoise.
Ces interventions ont déjà provoqué un conflit ouvert avec le Parti québécois, sur le terrain même de l'indépendance. PSPP a accusé Québec solidaire de chercher à diviser la société québécoise et de nuire à la cause indépendantiste. De nombreux péquistes ont relayé ces attaques sur les médias sociaux.
En même temps, cette première escarmouche réintroduit la centralité de la question de l'indépendance du Québec dans le discours de Québec solidaire, après plusieurs années où elle avait été marginalisée au profit d'enjeux sociaux souvent définis de manière étroite. La campagne électorale de 2022 avait pratiquement écarté la question de l'indépendance.
Ce porte-parolat Ghazal–Zanetti peut-il redéfinir la politique et le profil de Québec solidaire ?
L'enjeu pour le nouveau porte-parolat sera de transformer le discours sur l'indépendance en un projet politique concret, articulé à la transition écologique, à la justice sociale, à la refondation démocratique et à la rupture avec l'impérialisme. Cela nécessitera une vision stratégique claire, une démarcation sans concession face au projet péquiste et une capacité à se lier aux différents mouvements sociaux antisystémiques.
« Un Québec indépendant devra aligner ses politiques économiques et militaires sur celles des États-Unis, malgré la guerre tarifaire menée par Donald Trump », croit Paul St-Pierre Plamondon. Contrairement au premier ministre canadien, Mark Carney, le chef péquiste ne compte pas tourner le dos au voisin américain en cas de victoire du Oui. D'une part pour « favoriser la stabilité » du nouvel État indépendant, d'autre part en raison de sa situation géographique. « Il y a un contexte géopolitique et nos intérêts, au Québec, sont alignés sur ceux des États-Unis », a-t-il déclaré jeudi en dévoilant les premiers éléments de son Livre bleu sur un Québec souverain. [1]
L'indépendance proposée par PSPP n'est pas une indépendance véritable : le Québec demeurerait assujetti aux politiques de l'empire américain et à celles de l'État canadien. Ce serait une indépendance croupion.
À l'inverse, une indépendance pleine et entière devrait s'enraciner dans la souveraineté du peuple, non seulement sur le plan constitutionnel, mais aussi sur les plans économique, écologique, démocratique et culturel. Elle devrait affirmer le droit à l'autodétermination des nations autochtones, rompre avec les logiques néolibérales et impériales, et ouvrir la voie à l'institution d'une république démocratique, solidaire, écologiste et décoloniale — une république du peuple pour le peuple, libre des tutelles du capital et des empires.
Conclusion : un tournant à saisir
Le choix de Sol Zanetti par les membres de Québec solidaire traduit une volonté de réorientation stratégique afin de remettre le projet d'indépendance au centre de la stratégie politique du parti et de replacer celui-ci au cœur d'un champ politique où la question nationale redevient un enjeu essentiel. Mais ce tournant ne prendra sens que s'il s'accompagne d'une repolitisation du parti lui-même : formations sur les enjeux de l'indépendance, explication de la nécessité que la lutte pour une majorité indépendantiste soit portée par un projet de société égalitaire, féministe, écologiste et décolonial.
Le nouveau porte-parolat de Québec solidaire devra relever un défi crucial : rendre le projet solidaire clair, intelligible et convaincant, en démontrant sa nécessité face au projet péquiste d'une indépendance croupion — une indépendance qui ne remettrait pas en cause le Québec néolibéral ni son intégration au cadre géopolitique nord-américain actuel. Il s'agira donc d'affirmer une alternative nette : s'opposer à cette indépendance sans rupture réelle et défendre un projet de société porteur d'une véritable libération nationale, fondée sur la souveraineté populaire et la justice sociale. Il faudra également redéfinir clairement la stratégie de lutte pour une majorité indépendantiste et le caractère essentiel de la perspective de constituante, qui a été remise en cause par l'abandon d'une option claire de sa mise en place lors d'une élection au suffrage universel au dernier congrès. Le pire abandon serait de faire croire qu'une victoire du PQ pourrait constituer une voie royale vers le référendum et vers l'indépendance. Il est des illusions qu'il faudra éviter de nourrir. Reconstruire la pertinence du projet de Québec solidaire pour l'indépendance impliquera de surmonter une série d'obstacles. Comme l'a rappelé Sol Zanetti dans son allocution au congrès : « Il n'y en aura pas de facile. »
[1] Patrick Bellerose, Journal de Québec, 6 novembre 2025.

Définir les orientations politiques pragmatiques d’un futur gouvernement solidaire

Le 18ᵉ congrès de Québec solidaire, consacré à l'« actualisation » du programme, aurait pu être un moment fort de délibération démocratique et de clarification des orientations stratégiques du parti. Il s'est plutôt transformé en un exercice d'encadrement politique et organisationnel révélant la normalisation électoraliste en cours. Derrière le discours rassurant de la « lisibilité » et de la « pédagogie » du programme, la direction a imposé une conception restrictive du mandat confié par le parti : réduire le programme à un document de gouvernement, formulé à un haut niveau de généralité, dénué de propositions concrètes et de toute perspective de rupture radicale avec l'ordre existant, exprimée de façon claire et précise. Sous prétexte de simplification du langage et d'accessibilité pour le grand public, ont été écartés les éléments les plus structurants du projet solidaire : la mention explicite du capitalisme comme responsable de la dégradation de la biodiversité, des crises économiques, politiques et environnementales a été rejetée.
Les débats autour du programme réactualisé se sont faits très rapidement. Il y avait 288 amendements à discuter, sans parler des parties du texte qui n'avaient pas fait l'objet d'amendements et qui ont également été votées. Nous faisons ci-dessous un survol rapide des débats.
La majorité des amendements portaient sur le Bloc I « Économie et transition socioécologique » et sur le Bloc II « Habitation, énergie, ressources naturelles et travail ». Dans les domaines économiques et écologiques, les mesures adoptées restent symboliques ou limitées : la décroissance est réduite aux industries fossiles, et le rôle des PME et du secteur privé est légitimé comme pouvant être l'instrument de la transition socioécologique. Si la discussion a permis de clarifier que le secteur privé ne se limite pas aux PME, mais qu'il comprend également de grandes entreprises engagées dans le capital fossile et dans les industries d'extraction des ressources naturelles, souvent multinationales, aucune politique concrète en direction de ces secteurs n'a été définie. La définition de la décroissance a été limitée aux industries fossiles, évitant toute prise de position explicite sur la décroissance globale. Ainsi, la reconversion des industries militaires en industries productrices de biens utiles (comme des moyens de transport électrifiés), par exemple, n'a pas été discutée. Pourtant, à l'heure où Legault veut relancer cette industrie, une position claire sur sa nécessaire décroissance aurait été indispensable.
Les propositions de nationalisation/socialisation des grands monopoles du secteur de l'énergie, de l'exploitation des ressources forestières ou minières ont toutes été rejetées. Ces propositions ont été présentées comme trop spécifiques, et il a été avancé que ce serait un éventuel gouvernement de Québec solidaire qui pourrait définir les entreprises à nationaliser. Le texte du programme révisé s'est donc contenté de définir des critères. C'est un choix qui empêche de prendre en compte que, tant que les grandes entreprises contrôleront les choix en matière d'énergie et d'exploitation des ressources, la planification démocratique et décentralisée nécessaire à la transition écologique sera entravée. C'est un choix qui reporte dans un avenir indéterminé, après l'accession hypothétique de Québec solidaire au pouvoir, la lutte effective pour la reprise en main de nos ressources naturelles. Les propositions adoptées se contentent de parler de surveillance attentive des entreprises, sans s'interroger sur le pouvoir réel que garderont les grandes entreprises sur l'économie du Québec.
Dans les secteurs sociaux — Bloc III « Santé et services sociaux » — tels que le logement, le travail et l'éducation, des mesures progressistes ont été adoptées. Mais la proposition de réduction du temps de travail à 35 heures, puis à 32 heures, sans baisse de salaire et sans augmentation de l'intensité du travail, qui était reprise de l'ancien programme de Québec solidaire, a été rejetée (jugée trop spécifique). A également disparu, faute d'amendement en ce sens, le soutien à la syndicalisation multipatronale. En ce qui concerne la santé publique et les services sociaux, aucune discussion n'a eu lieu sur la privatisation rampante du système de santé, ni sur la rémunération des médecins. Les débats sur le système de santé sont restés limités à la reconnaissance ou non des médecines traditionnelles.
Dans le Bloc IV, portant sur la fiscalité, les familles, l'éducation et la justice, Québec solidaire a confirmé son refus des politiques d'austérité et adopté une fiscalité orientée vers la réduction de la pauvreté. Les services de la petite enfance ont été élargis et le caractère mixte du réseau scolaire a été maintenu. Des mesures redistributives et progressistes ont été adoptées, mais sans que des propositions concrètes en ce sens ne soient discutées, car elles avaient été d'emblée écartées des débats.
Dans le Bloc V, sur le plan démocratique et culturel, certaines avancées symboliques ont été adoptées : élargissement du droit de vote à 16 ans, protection contre l'usage discriminatoire de la laïcité, régularisation des sans-papiers et promotion de l'inclusion.
Le Bloc VI « Indépendance et altermondialisme » illustre des reculs dont l'importance reste à évaluer. L'abandon de l'élection au suffrage universel de l'Assemblée constituante affaiblit considérablement la stratégie indépendantiste de Québec solidaire. Le débat portait sur le tirage au sort, l'élection au suffrage universel ou le fait de ne pas se prononcer sur le mode de constitution de l'Assemblée constituante. C'est cette dernière proposition qui a été retenue, avec le soutien du porte-parole masculin, Sol Zanetti. Cette position a été, comme les autres, adoptée à la va-vite. Il s'agissait pourtant d'un abandon de la position traditionnelle de Québec solidaire.
L'élection d'une assemblée est essentielle à une réelle expression de la souveraineté populaire.
Cette élection permet de définir le peuple québécois comme le seul détenteur du pouvoir constituant, capable de définir ses institutions, ses droits fondamentaux et son mode de gouvernement. Elle permet à chaque Québécoise et Québécois de participer directement à la fondation de son pays. L'élection d'une assemblée constituante ouvre toute une période où les mouvements sociaux, syndicaux, féministes, écologistes et communautaires sont invités à formuler leurs propres propositions constitutionnelles. Cette élection ouvre un vaste débat public sur la société québécoise à construire. Les peuples autochtones, s'ils le souhaitent, peuvent s'impliquer dans ce processus. L'ensemble des citoyennes et citoyens sont invité·es à se prononcer sur les droits sociaux, sur la protection de l'environnement, sur la laïcité, sur la démocratie économique… Cette élection de la constituante et le travail qui s'en suivrait permettraient d'articuler le projet d'indépendance au projet de société défini collectivement, dans une réelle démarche de souveraineté populaire. L'élection n'est pas qu'un simple mécanisme de désignation : c'est un moment d'expression de la souveraineté populaire. Il faut reconnaître qu'une assemblée élue au suffrage universel, ouverte à toutes les forces politiques et validée par un référendum final, comme le proposait le programme de Québec solidaire, aurait une légitimité indiscutable pour parler au nom du peuple québécois lui-même. Le tirage au sort, lui, court-circuite cette politisation, en réduisant la participation citoyenne. Affirmer que la question reste ouverte, et qu'il sera toujours possible de réactualiser cette position, c'est affaiblir la position de Québec solidaire dans le débat actuel.
Le refus du congrès d'indiquer explicitement qu'un Québec indépendant refuserait de participer à l'OTAN et au NORAD constitue un recul par rapport au programme original de Québec solidaire. L'OTAN est une organisation qui « oblige ses membres à dépenser 5 % de leur PIB au détriment des investissements en santé, en éducation, en logement social et dans la lutte contre les changements climatiques ». À l'heure d'une reprise de la course aux armements, sous l'impulsion de l'OTAN, cette position nous désolidarise de celles et ceux qui mènent chaque jour un combat contre le militarisme.
Le Bloc VII, portant sur le féminisme, les identités sexuelles et de genre, et les peuples autochtones, n'a pas donné lieu à des débats, car, contrairement aux autres, le seul amendement significatif concernait la reconnaissance de l'écoféminisme. Le texte réactualisé a donc été adopté avec un minimum de débats.
Le Bloc VIII, sur l'immigration, l'inclusion et la langue française, a permis l'adoption de mesures favorisant l'inclusion et l'égalité des droits. L'obligation stricte « pour toute personne vivant au Québec de maîtriser suffisamment le français pour en faire sa langue d'usage dans la vie courante comme au travail » a été biffée du texte du programme actualisé. La régularisation des sans-papiers et l'égalité de traitement pour toustes les résident·es ont été adoptées. La tendance qui se dégage est clairement progressiste et inclusive, évitant toute forme de discrimination ou de traitement différencié.
En résumé, le programme se distingue par son caractère idéologique, son absence d'objectifs politiques concrets et sa faiblesse critique à l'égard du pouvoir économique de la classe dominante. Les luttes syndicales, populaires, écologiques, féministes et décoloniales ne sont pas présentées comme le principal moteur du changement. En fait, le programme est réduit, dans l'ensemble, à de futures orientations politiques et sociales d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire. Les transformations sociales y sont ainsi présentées comme s'effectuant à partir des sommets de la société. Cela découle du choix d'avoir écarté l'idée de faire du programme une boussole pour les luttes de rupture sociale et écologique, pourtant si nécessaires dans le moment actuel.
L'organisation de la discussion a su imposer l'idée que la « lisibilité » du programme devait primer sur la cohérence politique, et que les débats de fond sur la stratégie de rupture pouvaient être ajournés au nom de la définition d'un projet de société sans propositions spécifiques claires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les grands propriétaires bien servis par le PL60 du gouvernement Ford
La CAQ menace la grève de la STM, les travailleurs battent en retraite

Le budget 2025 prévoit des dépenses massives pour le complexe militaro-industriel, mais des coupes presque partout ailleurs

Mark Carney avait promis d'augmenter les dépenses militaires à 2 % du PIB, et c'est ce qu'il fait dans son premier budget. Le coût pour presque toutes les autres activités du gouvernement est considérable.
Tiré de rabble.ca
5 novembre 2025
Il y a soixante-cinq ans, alors qu'il quittait ses fonctions, le président américain Dwight Eisenhower mettait en garde contre « l'influence injustifiée » du « complexe militaro-industriel ».
Eisenhower n'y est pas allé par quatre chemins.
L'ancien général, qui avait commandé les forces alliées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, qualifiait le pouvoir « mal placé » de ce complexe de « désastreux ».
À la lecture du premier budget du premier ministre canadien Mark Carney, on constate que l'influence et le pouvoir dangereux contre lesquels Eisenhower avait mis en garde se sont désormais étendus à l'échelle mondiale.
Le budget du 4 novembre du Canada compte de nombreux perdant·es, mais une grande gagnante : l'armée et les industries qui lui sont liées.
Alors que le budget 2025 réduit presque toutes les autres dépenses publiques, y compris celles consacrées aux ancien·nes combattant·es, aux relations entre la Couronne et les Autochtones et à l'aide au développement international, il augmente les dépenses militaires de plus de 16 milliards de dollars par an pendant cinq ans.
Carney et son ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qualifient cela d'« investissement générationnel » dans les armes et les appareils de guerre.
Au début de l'année, le gouvernement canadien a promis aux autres membres de l'OTAN qu'il accélérerait le processus visant à porter notre budget de défense à 2 % du produit intérieur brut (PIB), et il a tenu parole.
Mais ce n'est pas tout.
Lors du sommet de l'OTAN en juin dernier, Donald Trump a ordonné aux dirigeant·es de l'alliance réuni·es de sauter, et ils ont tous répondu à l'unisson : « À quelle hauteur ? »
Trump, de manière capricieuse et sans s'appuyer sur aucun fait ni aucune preuve, a décidé que tous les membres de l'OTAN devaient désormais consacrer 5 % de leur production économique à l'achat d'armes, de bombes, de chars, de missiles, de drones et de soldats.
Un tel renforcement massif de l'armement dépassera les pires craintes de Dwight Eisenhower.
Cela représentera bien plus que ce que l'ancien général appelait une « influence injustifiée ».
Elle créera des États-garnisons, armés jusqu'aux dents, partout dans le monde.
Mauvaises nouvelles économiques ; le gouvernement comme catalyseur
Le budget 2025 vise ostensiblement à rendre l'économie canadienne plus résistante face à la guerre économique menée par Trump.
Le document budgétaire plante le décor en brossant un tableau économique sombre pour le Canada :
« Les droits de douane et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement devraient freiner les investissements et la productivité des entreprises. Combiné à un ralentissement de la croissance démographique, le niveau du PIB réel devrait être inférieur de 1,8 % à ce qui était prévu en 2024 avant le conflit commercial. »
Parmi les éléments négatifs cités dans le budget 2025, les principaux sont une baisse de 7 % des exportations canadiennes vers tous les pays et une baisse de 10 % des exportations vers les États-Unis.
Les exportations d'acier et d'aluminium ont baissé beaucoup plus, d'environ un tiers.
Pour le gouvernement, ce « choc économique » se traduit par une baisse des recettes fiscales. Il en résulte, selon le budget, une « détérioration du solde budgétaire fédéral de 7 milliards de dollars par an ».
Pour atténuer les effets négatifs induits par Trump, le budget propose une « nouvelle stratégie industrielle ».
Cette approche à plusieurs volets permettrait au gouvernement fédéral d'agir, dans une large mesure, comme catalyseur des investissements du secteur privé.
Ainsi, le budget 2025 prévoit que le gouvernement fédéral dépensera beaucoup dans les infrastructures, un peu moins dans le soutien à la recherche et au développement des compétences et, pour la première fois depuis des décennies, investira dans le logement.
Parallèlement, le gouvernement offrira aux entreprises du secteur privé une série d'incitations fiscales généreuses pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars.
L'une de ces mesures fiscales est ce que le budget appelle une « super-déduction pour la productivité ».
Cette mesure permettra aux entreprises de déduire plus rapidement une plus grande partie du coût de leurs investissements dans les machines, les équipements et les technologies.
Les entreprises pourront bénéficier de cet allégement fiscal avant d'avoir dépensé ce qu'elles prévoient investir dans de nouveaux « actifs améliorant la productivité ».
Le budget fait une déclaration ambitieuse concernant ces mesures de stratégie industrielle.
Le gouvernement Carney affirme qu'elles permettront, d'une manière ou d'une autre, de générer plus d'un trillion de dollars d'investissements (un milliard de milliards) au total sur cinq ans. Le budget 2025 ne précise toutefois pas comment cela se produira. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le budget manque de détails.
Mais même dans le chapitre consacré à la stratégie industrielle, l'armée occupe une place de choix.
En effet, les prévisions budgétaires concernant les nouvelles dépenses de défense, qui dépasseraient 16 milliards de dollars par an, pourraient être sous-estimées.
Entités d'investissement militaire autonomes
Parmi les piliers de la stratégie industrielle figurent un nouveau Bureau des grands projets et une agence tout aussi nouvelle, Build Canada Homes.
Mais le gouvernement créera également une nouvelle Agence d'investissement dans la défense dans le cadre de ce qu'il appelle sa stratégie industrielle de défense.
L'un des objectifs de ces initiatives de défense autonomes est de détourner les achats canadiens en matière de défense faits aux États-Unis, désormais peu fiables, vers le Canada et les alliés non américains, en particulier en Europe.
Cela semblera une bonne idée à toustes celleux qui n'ont pas dormi depuis l'arrivée au pouvoir de Trump en janvier dernier.
Mais une grande partie des motivations de cette stratégie industrielle axée spécifiquement sur la défense est moins bienveillante. Son objectif est d'intégrer plus étroitement l'activité militaire dans le tissu non militaire de l'économie.
Le document budgétaire le dit clairement. Il vante les avantages des achats militaires pour l'ensemble de l'économie :
« Les opportunités commerciales se trouveront tout au long de la chaîne d'approvisionnement : de la production de matières premières, notamment l'acier et l'aluminium, aux camionneur·euses et cheminots qui assurent leur transport, en passant par ceux qui transforment ces matériaux en équipements, armes, munitions et véhicules. »
Pour faire bonne mesure, le budget 2025 promet que les investissements militaires massifs « stimuleront également l'innovation dans les secteurs technologiques, notamment l'intelligence artificielle, la technologie quantique et la cybersécurité ».
Certain·es pourraient imaginer qu'une augmentation massive des dépenses militaires pourrait aider ce pays à résister aux intentions agressives et hostiles des États-Unis de Donald Trump.
Ce n'est guère le cas.
Il faut tenir compte du fait qu'une bonne partie des nouvelles dépenses militaires sera consacrée à des domaines dans lesquels nous, Canadien·nes, sommes étroitement intégré·es aux Américain·es. Le principal d'entre eux est le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).
Quoi qu'il en soit, le gouvernement Carney semble ambivalent dans son évaluation de la menace que représente l'Amérique de Trump, malgré tous ses discours musclés.
Un exemple concret : il y a quelque temps, Trump a envisagé d'utiliser les ressources du gouvernement américain pour acheter une grande partie de l'industrie canadienne des minéraux rares.
Interrogé sur les ambitions de Trump et sur les dangers que représente le fait qu'une puissance étrangère possède un actif stratégique tel que les minéraux rares, le ministre des Ressources naturelles de Carney, Tim Hodgson, a répondu : « Les États-Unis sont un allié. »
Oui, les États-Unis sont toujours (en quelque sorte) un allié. Mais leur président actuel ne cache pas son désir de mettre la main sur nos ressources en eau et autres, voire sur l'ensemble du pays.
Réductions importantes des dépenses non militaires
Il y a un coût à nourrir de force le complexe militaro-industriel avec un régime aussi riche. Ce coût sera payé par une grande partie des autres activités gouvernementales.
Une annexe au document budgétaire indique, pour presque tous les ministères, de quelle façon ils doivent réduire leurs dépenses de 15 %.
Les responsables des Pêches et Océans ont reçu pour instruction de « réduire » les activités de recherche et de surveillance pour lesquelles des « sources de données alternatives » (non spécifiées) sont disponibles.
Pour Environnement et Changement climatique, le mot d'ordre est de « réduire ou de réduire progressivement les activités qui ne sont pas essentielles au mandat du ministère », en supposant que de telles activités existent. Le commissaire fédéral à l'environnement a souvent signalé que le ministère de l'Environnement ne remplissait pas bon nombre des activités qui relèvent entièrement de son mandat.
Ressources naturelles Canada supprimera également des programmes environnementaux, notamment le programme Maisons vertes et le programme du gouvernement précédent visant à planter deux milliards d'arbres absorbant le carbone.
En plus d'une série de mesures d'efficacité vaguement définies, le budget 2025 enjoint à l'emploi et au développement de la main-d'œuvre « d'accroître son utilisation de l'intelligence artificielle (IA) afin de rationaliser et d'automatiser les processus internes ».
L'IA connaît un succès fulgurant auprès du gouvernement Carney.
Mais le budget 2025 ne met-il pas la charrue avant les bœufs en matière d'IA ?
Les lecteurs et lectrices se souviendront qu'au début de l'année, le Premier ministre a créé un tout nouveau ministère de l'Intelligence artificielle (IA), dirigé par l'ancien animateur de télévision Evan Solomon. Dans une récente interview, M. Solomon a promis une nouvelle législation pour faire face aux dangers et aux risques potentiels de l'IA.
Mais le gouvernement n'attend pas les nouvelles règles et réglementations de M. Solomon pour se lancer tête baissée dans l'IA – et, comme l'aurait dit Shakespeare, que le diable emporte les derniers.
Certaines institutions culturelles bénéficient d'une augmentation modeste de leur financement.
Le budget 2025 ajoute 150 millions de dollars au financement de CBC/Radio-Canada pour cette année et promet une révision tant attendue du mandat du radiodiffuseur public.
C'est loin de ce que l'ancienne ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, avait recommandé en février dernier.
Mme St-Onge avait proposé que le Canada investisse le montant moyen que les pays du G-7 consacrent à la radiodiffusion publique, soit 62,50 dollars par personne, et en fasse un montant garanti. Actuellement, le Canada dépense environ 37,50 dollars par personne pour le radiodiffuseur public.
Malgré les nouveaux fonds accordés à CBC/Radio-Canada (et à d'autres organismes tels que Téléfilm Canada et l'Office national du film), le ministère responsable de ces organismes, et de bien d'autres choses liées à l'identité canadienne, doit réduire ses coûts de fonctionnement de 15 %.
Il en va de même pour l'Agence du revenu du Canada (ARC), malgré le manque scandaleux de services fournis par cet organisme avec son niveau de financement actuel.
L'aide au développement international est souvent considérée comme le pendant « soft power » des dépenses militaires.
Selon cette théorie, pour parvenir à un monde plus sûr et plus sécurisé, les nations riches doivent contribuer à réduire la pauvreté, les problèmes de santé, les conditions de logement inadéquates, la dégradation de l'environnement et le chômage dans les nations plus pauvres.
C'est pourquoi, il y a plusieurs années, le monde entier a adopté les objectifs du Millénaire pour le développement, qui encourageaient les pays riches à consacrer 0,7 % de leur PIB à l'aide au développement. (Le Canada n'a jamais atteint cet objectif, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni.)
Mark Carney ne souscrit manifestement pas à cette théorie.
Son budget 2025 réduit le niveau déjà faible de l'aide apportée par le Canada aux pays moins développés.
Parmi les victimes figurent les programmes de santé mondiaux et les institutions financières internationales.
Et ainsi de suite. Le document budgétaire présente de nombreuses autres coupes similaires.
Le premier ministre a tenu à préciser que son gouvernement ne réduisait pas les transferts aux provinces pour les services de santé et les services sociaux, ni ne supprimait ses propres programmes, tels que celui des soins dentaires, résultat de l'accord conclu par le gouvernement précédent avec les néo-démocrates.
Cependant, le programme d'assurance-médicaments sera victime de ce budget.
À ce jour, seules la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et le Yukon ont signé des accords d'assurance-médicaments avec le gouvernement fédéral, mettant ainsi le programme en œuvre.
Le plan consistait à négocier des accords similaires avec les autres provinces et territoires. Mais cela ne se produira pas maintenant. L'initiative d'assurance-médicaments sera gelée.
Le budget comporte quelques points positifs et encourageants, mais aussi d'autres éléments inquiétants. Pour cet espace sur rabble.ca, il faudra attendre un autre jour.
Le débat sur le budget 2025 est actuellement en cours à la Chambre, mais celle-ci suspendra ses travaux la semaine prochaine, pour les reprendre la semaine suivante.
C'est à ce moment-là que nous pouvons nous attendre à un vote sur le budget.
L'équipe de Carney a obtenu le soutien d'un député conservateur dissident, Chris d'Entremont, le seul conservateur élu en Nouvelle-Écosse lors du scrutin du printemps dernier.
Cela signifie qu'il ne leur manque plus que deux voix (ou abstentions) pour faire adopter le budget 2025 par le Parlement. S'ils échouent, des élections seront organisées.
Mais un échec semble désormais peu probable.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« New York restera une ville d’immigrant-es : une ville construite par des immigrant·es, animée par des immigrant·es

Mardi 5 novembre 2025, Zohran Mamdani a gagné les élections municipales à New York avec un million de voix en battant Andrew Cuomo (ancien gouverneur démocrate de l'État de New York) qui était soutenu par Donald Trump et l'establishment. Mamdani a 34 ans et est musulman, il est né en Ouganda. Lors de son discours de victoire il a notamment déclaré ceci en défiant le néofasciste Trump : « New York restera une ville d'immigrant-es : une ville construite par des immigrant-es, animée par des immigrants et, à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. ».
Il a également déclaré : « Le 1er janvier, je prêterai serment en tant que maire de la ville de New York. (...) Merci à ceux qui sont si souvent oubliés par la politique de notre ville, qui ont fait leur ce mouvement. Je parle des propriétaires de bodegas yéménites et des abuelas mexicaines. Des chauffeurs de taxi sénégalais et des infirmières ouzbèkes. Des cuisiniers trinidadiens et des tantines éthiopiennes. »
Il faut souligner que Zohran Mamdani qu'en 2021 a soutenu activement le combat des chauffeurs de taxis de NYC (25.000), qui protestaient contre les conditions abusives imposées par les créanciers. La grève de la faim et du travail des chauffeurs a obligé Marblegate, leur principal créancier à un accord dit « Taxi Medallion Debt Relief Deal » qui a conduit à une restructuration de leur dette, à un plafonnement du taux d'intérêt et à la protection de leur logement contre le risque de saisie.
Parmi les propositions de Mamdani qui ont entraîné une importante mobilisation lui assurant la victoire le 5 novembre 2025 : un gel des loyers qui concernerait 1 million de logements ; une augmentation du taux d'imposition sur les sociétés dans l'État de New York jusqu'à 11,5 % (soit un niveau comparable à celui du New Jersey), afin de générer environ 5 milliards de $ par an ; une surtaxe de 2 % sur le revenu des résidents de la ville gagnant plus d'1 million de $ par an ; rendre les bus de la ville gratuits.
Trump avait menacé les New Yorkais·es qui souhaitaient voter pour le « gauchiste » Mamdani de couper la dotation fédérale à la ville. Cela n'a pas réussi à dissuader un million de personnes d'apporter leur soutien à la candidature de celui-ci. Le nombre de voix recueillies par Mamdani n'avait plus été atteint depuis 1969 par un maire élu à New York.
Le CADTM publie dans son intégralité le discours que Zohran Mamdani a prononcé dès que sa victoire a été confirmée le 5 novembre 2025 en fin de soirée. Cela vaut la peine de lire l'ensemble du discours afin de se faire une opinion. Bien sûr il faut exercer un esprit critique. Il n'y a pas de doute qu'il faudra prendre le temps d'analyser de manière contradictoire ce que dit cet élu en le comparant avec la réalité de son action. Il ne faut pas se laisser convaincre par un beau discours, il faut des actes concrets qui doivent correspondre avec les paroles.
Mamdani et son équipe devront surmonter de nombreux obstacles et faire face à de puissants ennemis. Cela s'est déjà vu lors de la campagne durant laquelle, d'après le magazine Forbes, 26 Milliardaires étatsuniens ont dépensé plus de 22 millions de dollars pour empêcher Mamdani d'accéder à la mairie de New-York. Fort heureusement, la volonté et l'énergie populaires, notamment chez les plus jeunes, ont triomphé sur le pouvoir de l'argent et du capital.
Son nouveau mandat de maire commencera le 1er janvier 2026 s'il n'y est pas empêché par un acte criminel. Nous serons attentifs dans les mois qui viennent et en particulier lors des premiers 100 jours du mandat de Mamdani, à ce qu'il mettra en pratique.
Rappelons que l'arrivée de la gauche au gouvernement en Grèce en janvier 2015 avait soulevé d'énormes espoirs. Néanmoins la stratégie politique adoptée par le gouvernement de Tsipras avait été désastreuse. Il avait capitulé face aux ennemis du changement, le grand capital grec et notamment la Troïka (FMI, BCE, Commission européenne). Les dirigeants européens voulaient éviter un virage progressiste tant en Grèce que dans d'autres pays d'Europe comme l'Espagne et le Portugal et ils ont atteint leurs objectifs à cause du manque de combativité et de radicalité de Tsipras et de son gouvernement.
L'arrivée de Zohran Mamdani, membre des Démocrates socialistes d'Amérique (DSA) à la mairie de New York va susciter beaucoup d'attentes, espérons qu'elles ne soient pas déçues et qu'elles contribuent à une authentique contre-offensive face à Trump, au 1% et à l'extrême-droite en général.
6 novembre 2025 ,/ tiré du site du CADTM | Photo : Bingjiefu He, CC, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zohran_Mamdani_at_the_Resist_Fascism_Rally_in_Bryant_Park_on_Oct_27th_2024.jpg
https://frustrationmagazine.fr/new-york-zohran-mamdani
Le discours de victoire de Mamdani
Merci, mes amis. Le soleil s'est peut-être couché sur notre ville ce soir, mais comme l'a dit un jour Eugene Debs [1], « je vois poindre l'aube d'un jour meilleur pour l'humanité ».
Depuis aussi longtemps que nous nous souvenons, les travailleurs de New York se sont entendu dire par les personnes riches et bien connectées que le pouvoir ne leur appartenait pas.
Les doigts meurtris à force de soulever des cartons dans les entrepôts, les paumes calleuses à force de tenir le guidon des vélos de livraison, les jointures marquées par les brûlures de cuisine : ce ne sont pas des mains qui ont été autorisées à détenir le pouvoir. Et pourtant, au cours de ces 12 derniers mois, vous avez osé viser plus haut.
Ce soir, contre toute attente, nous l'avons atteint. L'avenir est entre nos mains. Mes amis, nous avons renversé une dynastie politique.
Je souhaite à Andrew Cuomo tout le meilleur dans sa vie privée. Mais que ce soir soit la dernière fois que je prononce son nom, alors que nous tournons la page d'une politique qui abandonne le plus grand nombre au profit d'une minorité. New York, ce soir, vous nous avez chargés d'une mission. Une mission pour un changement. Une mission pour une nouvelle forme de politique. Une mission pour une ville à la portée de tous. Et une mission pour un gouvernement qui tient exactement ces engagements.
Le 1er janvier, je prêterai serment en tant que maire de la ville de New York. Et c'est grâce à vous. Avant toute autre chose, je tiens donc à vous dire ceci : merci. Merci à la nouvelle génération de New-Yorkais qui refuse d'accepter que la promesse d'un avenir meilleur soit une relique du passé.
Vous avez montré que lorsque la politique s'adresse à vous sans condescendance, nous pouvons nous diriger vers une nouvelle ère de leadership. Nous nous battrons pour vous, car nous sommes vous.
Ou, comme on dit à Steinway, ana minkum wa alaikum [2].
Merci à ceux qui sont si souvent oubliés par la politique de notre ville, qui ont fait leur ce mouvement. Je parle des propriétaires de bodegas yéménites et des abuelas mexicaines. Des chauffeurs de taxi sénégalais et des infirmières ouzbèkes. Des cuisiniers trinidadiens et des tantines éthiopiennes. Oui, des tantines.
À tous les New-Yorkais de Kensington, Midwood et Hunts Point, sachez ceci : cette ville est votre ville, et cette démocratie est aussi la vôtre [3].
Cette campagne concerne des gens comme Wesley, un organisateur du 1199 que j'ai rencontré devant l'hôpital Elmhurst jeudi soir [4].
Un New-Yorkais qui vit ailleurs, qui fait deux heures de trajet aller-retour depuis la Pennsylvanie parce que les loyers sont trop chers dans cette ville.
Elle concerne des gens comme cette femme que j'ai rencontrée il y a des années dans le bus Bx33 et qui m'a dit : « Avant, j'aimais New York, mais maintenant, c'est juste l'endroit où je vis. » Et elle concerne des gens comme Richard, le chauffeur de taxi avec lequel j'ai fait une grève de la faim de quinze jours devant l'hôtel de ville, et qui doit encore conduire son taxi sept jours sur sept. Mon frère, nous sommes à l'hôtel de ville maintenant [5].
Cette victoire est pour eux tous. Et elle est pour vous tous, les plus de 100 000 bénévoles qui ont fait de cette campagne une force imparable [6]. Grâce à vous, nous ferons de cette ville une ville que les travailleurs pourront à nouveau aimer et dans laquelle ils pourront à nouveau vivre. À chaque porte frappée, à chaque signature obtenue, à chaque débat difficilement remporté, vous avez érodé le cynisme qui caractérise désormais notre politique.
Je sais que je vous ai beaucoup demandé au cours de cette dernière année. À maintes reprises, vous avez répondu à mes appels, mais j'ai une dernière requête. New York, inspirez profondément en cet instant. Nous avons retenu notre souffle plus longtemps que nous ne le pensons.
Nous l'avons retenu dans l'attente de la défaite, nous l'avons retenu parce que notre souffle a été coupé trop de fois pour pouvoir les compter, nous l'avons retenu parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'expirer. Merci à tous ceux qui ont tant sacrifié. Nous respirons l'air d'une ville qui renaît.
À mon équipe de campagne, qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait et qui a transformé un projet électoral en quelque chose de bien plus grand : je ne pourrai jamais exprimer toute ma gratitude. Vous pouvez enfin dormir tranquilles.
À mes parents, maman et papa : vous avez fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis très fier d'être votre fils. Et à ma merveilleuse épouse, Rama, hayati [7] : il n'y a personne d'autre que je préférerais avoir à mes côtés en ce moment, et à chaque instant.
À tous les New-Yorkais, que vous ayez voté pour moi, pour l'un de mes adversaires ou que vous ayez été trop déçus par la politique pour voter, merci de m'avoir donné l'occasion de prouver que je suis digne de votre confiance. Je me réveillerai chaque matin avec un seul objectif : rendre cette ville meilleure pour vous qu'elle ne l'était la veille.
Beaucoup pensaient que ce jour n'arriverait jamais, craignant que nous soyons condamnés à un avenir moins prometteur, chaque élection nous assignant à répéter les mêmes conditions.
D'autres considèrent la politique actuelle comme trop cruelle pour que la flamme de l'espoir continue de brûler. New York, nous avons répondu à ces craintes.
Ce soir, nous nous sommes exprimés d'une voix claire. L'espoir est vivant. L'espoir est une décision que des dizaines de milliers de New-Yorkais ont prise jour après jour, bénévolat après bénévolat, malgré les attaques publicitaires incessantes. Nous étions plus d'un million à nous rassembler dans nos églises, nos gymnases, nos centres communautaires, pour remplir le registre de la démocratie [8].
Et si nous avons voté seuls, nous avons choisi l'espoir ensemble. L'espoir plutôt que la tyrannie. L'espoir plutôt que l'argent et les idées étroites. L'espoir plutôt que le désespoir. Nous avons gagné parce que les New-Yorkais se sont permis d'espérer que l'impossible pouvait devenir possible. Et nous avons gagné car nous avons affirmé que la politique ne serait plus quelque chose que nous subissons. Désormais, c'est quelque chose que nous faisons.
Debout devant vous, je pense aux paroles de Jawaharlal Nehru : « Il arrive un moment, rare dans l'histoire, où nous passons de l'ancien au nouveau, où une époque s'achève et où l'âme d'une nation, longtemps réprimée, trouve enfin sa voix. »
Ce soir, nous sommes passés de l'ancien au nouveau. Alors d'une voix claire et convaincue qui ne peut être mal interprétée, parlons de ce que cette nouvelle ère offrira, et à qui.
Ce sera une ère où les New-Yorkais attendront de leurs dirigeants une vision audacieuse de ce que nous accomplirons, plutôt qu'une liste d'excuses pour ce que nous sommes trop timides pour tenter. Au cœur de cette vision se trouvera le programme le plus ambitieux jamais mis en place pour lutter contre la crise du coût de la vie que connaît cette ville depuis l'époque de Fiorello La Guardia : un programme qui gèlera les loyers de plus de deux millions de locataires bénéficiant d'un loyer stabilisé, rendra les bus rapides et gratuits et offrira des services de garde d'enfants universels dans toute notre ville [9].
Depuis sa victoire aux primaires démocrates, Zohran Mamdani a été comparé à plusieurs reprises à La Guardia. Le gel du prix des loyers fut durant toute sa campagne une de ses mesures phares.
Dans quelques années, notre seul regret sera peut-être que ce jour ait mis si longtemps à arriver. Cette nouvelle ère sera marquée par des améliorations constantes. Nous embaucherons des milliers d'enseignants supplémentaires. Nous réduirons le gaspillage lié à une bureaucratie pléthorique. Nous nous efforcerons sans relâche de rétablir l'éclairage dans les couloirs des immeubles de la NYCHA, où il est défaillant depuis longtemps [10].
La sécurité et la justice iront de pair, car nous collaborerons avec les agents de police pour réduire la criminalité et créer un ministère de la Sécurité communautaire qui s'attaquera de front aux crises de la santé mentale et du sans-abrisme. L'excellence deviendra la norme au sein du gouvernement, et non plus l'exception. Dans cette nouvelle ère que nous créons pour nous-mêmes, nous refuserons de laisser ceux qui sèment la division et la haine nous monter les uns contre les autres [11].
En cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons qu'il faut défendre ceux que nous aimons, que vous soyez un immigrant, un membre de la communauté transgenre, l'une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées et privées d'un emploi fédéral, une mère célibataire qui attend toujours que le prix des produits alimentaires baisse, ou toute autre personne acculée, au pied du mur. Votre combat est aussi le nôtre.
Nous construirons une mairie qui se tiendra fermement aux côtés des New-Yorkais juifs et qui ne faiblira pas dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme ; une mairie où plus d'un million de musulmans sauront qu'ils ont leur place, non seulement dans les cinq arrondissements de cette ville, mais aussi dans les couloirs du pouvoir.
New York ne sera plus une ville où l'on peut faire campagne sur l'islamophobie et remporter une élection. Cette nouvelle ère sera marquée par une compétence et une compassion qui ont trop longtemps été opposées l'une à l'autre. Nous prouverons qu'il n'y a pas de problème trop grand pour que le gouvernement le résolve, ni de préoccupation trop insignifiante pour qu'il s'en soucie [12].
Pendant des années, les responsables de la mairie n'ont aidé que ceux qui pouvaient les aider ; mais le 1er janvier, nous inaugurerons une administration municipale qui aidera tout le monde.
Je sais que beaucoup n'ont entendu notre message qu'à travers le prisme de la désinformation. Des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour redéfinir la réalité et convaincre nos voisins que cette nouvelle ère est quelque chose qui devrait les effrayer. Comme cela s'est souvent produit, la classe des milliardaires a cherché à convaincre ceux qui gagnent 30 dollars de l'heure que leurs ennemis sont ceux qui gagnent 20 dollars de l'heure.
Ils souhaitent que les gens se battent entre eux afin que nous restions distraits du travail de refonte d'un système défaillant depuis longtemps. Nous refusons de les laisser dicter les règles du jeu plus longtemps. Ils peuvent jouer selon les mêmes règles que nous tous.
Ensemble, nous inaugurerons une génération de changement. Et si nous embrassons cette nouvelle voie courageuse, plutôt que de la fuir, nous pourrons répondre à l'oligarchie et à l'autoritarisme avec la force qu'ils redoutent, et non avec l'apaisement qu'ils recherchent.
Après tout, si quelqu'un peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est bien la ville qui l'a vu naître. Et s'il existe un moyen de terrifier un despote, c'est en démantelant les conditions mêmes qui lui ont permis d'accumuler le pouvoir.
Ce n'est pas seulement ainsi que nous arrêterons Trump, c'est aussi ainsi que nous arrêterons le prochain. Alors, Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, j'ai trois mots à vous dire : augmentez le volume [13].
Nous demanderons des comptes aux mauvais propriétaires, car les Donald Trump de notre ville ont pris l'habitude de profiter de leurs locataires. Nous mettrons fin à la culture de corruption qui a permis à des milliardaires comme Trump d'échapper à l'impôt et de profiter d'allégements fiscaux.
Nous nous tiendrons aux côtés des syndicats et renforcerons la protection des travailleurs, car nous savons, tout comme Donald Trump, que lorsque les travailleurs ont des droits inaliénables, les patrons qui cherchent à les exploiter deviennent très petits.
New York restera une ville d'immigrants : une ville construite par des immigrants, animée par des immigrants et, à partir de ce soir, dirigée par un immigrant.
Alors écoutez-moi bien, président Trump, lorsque je vous dis ceci : pour nous atteindre, vous devrez passer par nous tous. Lorsque nous entrerons à la mairie dans 58 jours, les attentes seront élevées. Nous y répondrons. Un grand New-Yorkais a dit un jour que l'on fait campagne en poésie, mais que l'on gouverne en prose.
Si cela doit être vrai, faisons en sorte que la prose que nous écrivons rime encore, et construisons une ville brillante pour tous [14].
Et nous devons tracer une nouvelle voie, aussi audacieuse que celle que nous avons déjà empruntée. Après tout, la sagesse conventionnelle vous dirait que je suis loin d'être le candidat idéal.
Je suis jeune, malgré tous mes efforts pour vieillir. Je suis musulman. Je suis un socialiste démocrate. Et le plus accablant de tout, c'est que je refuse de m'excuser pour tout cela.
Et pourtant, si cette soirée nous enseigne quelque chose, c'est que les conventions nous ont freinés. Nous nous sommes inclinés devant l'autel de la prudence, et nous en avons payé le prix fort. Trop de travailleurs ne se reconnaissent pas dans notre parti, et trop d'entre nous se sont tournés vers la droite pour trouver des réponses à leur questionnement sur les raisons pour lesquelles ils ont été laissés pour compte.
Nous laisserons la médiocrité dans le passé. Nous n'aurons plus à ouvrir un livre d'histoire pour prouver que les démocrates peuvent oser être grands.
Notre grandeur sera tout sauf abstraite. Elle sera ressentie par chaque locataire bénéficiant d'un loyer stabilisé qui se réveille le premier jour de chaque mois en sachant que le montant qu'il va payer n'a pas augmenté par rapport au mois précédent. Elle sera ressentie par chaque grand-parent qui peut se permettre de rester dans la maison pour laquelle il a travaillé et dont les petits-enfants vivent à proximité parce que le coût de la garde d'enfants ne les a pas envoyés à Long Island.
Elle sera ressentie par la mère célibataire qui se déplace en toute sécurité et dont le bus circule suffisamment rapidement pour qu'elle n'ait pas à se précipiter pour déposer ses enfants à l'école afin d'arriver à l'heure au travail. Et elle sera ressentie lorsque les New-Yorkais ouvriront leur journal le matin et liront des titres qui parlent de succès, et non de scandales.
Mais surtout, elle sera ressentie par chaque New-Yorkais lorsque la ville qu'ils aiment leur rendra enfin leur amour.
Ensemble, New York, nous allons geler les… [le public : loyers !] Ensemble, New York, nous allons rendre les bus rapides et… [le public : gratuits !] Ensemble, New York, nous allons offrir à tous… [des services de garde d'enfants !]
Que les mots que nous avons prononcés ensemble, les rêves que nous avons rêvés ensemble, deviennent le programme que nous réaliserons ensemble. New York, ce pouvoir, il est à vous. Cette ville vous appartient.
Merci.
mailfacebookprintertwitter
Source : Le Grand Continent
Notes
[1] Eugene Debs est l'une des figures les plus emblématiques du socialisme américain. Cinq fois candidat à l'élection présidentielle américaine entre 1900 et 1920, il devient président de l'American Railway Union en 1893 et crée le premier syndicat industriel d'Amérique en regroupant les travailleurs du rail.
Il devient célèbre dès l'année suivante pour sa participation à de grandes grèves, qui le conduiront à faire six mois de prison. En 1898 il mène la création du Parti socialiste américain.
[2] « Et que la paix soit avec vous tous » en arabe.
[3] Kensington et Midwood sont des quartiers de Brooklyn dont la population est parmi les plus diverses ; ils comptent notamment une importante communauté originaire de l'Asie du Sud. Hunts Point est un quartier du Bronx à population majoritairement hispanique et latino.
De manière générale, Mamdani a connu un succès plus large que Cuomo lors de la primaire démocrate dans les quartiers aux populations diversifiées, avec près de 52 % des voix dans les quartiers à forte population sud-asiatique.
[4] Le Local 1199 est un syndicat de travailleurs de la santé, allié de longue date des candidats démocrates, qui a retiré son soutien à Andrew Cuomo pour l'offrir à Mamdani en juillet, à la suite d'un changement de présidence.
[5] En 2021, Mamdani a participé à la grève de la faim organisée par les taxis de New York pour demander une baisse des paiements à effectuer pour rembourser le « medallion », le certificat permettant d'exercer le métier de chauffeur de taxi à New York, victime d'une forte inflation due à un manque de régulation.
[6] Paola Nagovitch, « One hundred thousand volunteers and one million doors knocked on : Zohran Mamdani's historic campaign for mayor of New York », El Pais, 4 novembre 2025.
[7] Terme affectueux arabe, qu'on peut traduire par « ma vie ».
[8] L'élection a attiré plus de deux millions d'électeurs, contre seulement 1,1 million lors du précédent scrutin, en 2023. Il s'agit du taux de participation le plus élevé depuis 1993.
[9] Fiorello La Guardia était un membre du Parti républicain et maire de New York de 1934 à 1945. Un des soutiens du New Deal, il a créé l'Office of Price Administration, chargé de réguler les prix des produits de première nécessité, comme les loyers ou la nourriture. Il est également à l'origine de la création de la New York City Housing Authority (NYCHA), qui a mené de nombreux projets de construction de logements sociaux.
[10] Créée en 1934, la New York City Housing Authority (NYCHA) est l'organisme public chargé de la gestion des logements sociaux de New York, et l'un des plus importants bailleurs sociaux au monde. L'éclairage de la NYCHA est un sujet récurrent dans la vie urbaine new-yorkaise : elle doit compter avec des coupures de courant et des systèmes électriques défaillants dans le Bronx qui laissent les résidents dépendants de générateurs de secours. En avril 2016, la NYCHA et la police new-yorkaise ont mené une campagne spéciale d'éclairage extérieur pour réduire la criminalité nocturne, bien que l'efficacité de la campagne soit contestée.
[11] Selon un rapport du contrôleur de l'État de New York publié en janvier, le nombre de sans-abri a presque doublé dans l'État entre 2022 et 2024. La ville de New York a représenté à elle seule 93 % de cette augmentation : il y avait plus de 158 000 sans-abri à New York en 2024, soit environ un cinquième des sans-abri du pays.
Le nombre d'enfants sans domicile fixe est ainsi passé de 20 299 en 2022 à 50 773 en 2024. Près d'un sans-abri sur trois à New York est un enfant, ce qui représente l'un des pourcentages les plus élevés du pays. Le taux de sans-abri à New York — environ 8 pour 1 000 habitants — est plus élevé que celui de tous les autres États, à l'exception d'Hawaï et du district de Columbia.
[12] Zohran Mamdani est le premier maire musulman de la ville. Selon un rapport du Centre d'étude de la haine organisée (CSOH), celui-ci a été victime de nombreux discours islamophobes et xénophobes durant la campagne. Ces discours le présentaient notamment comme un terroriste, un djihadiste ou un musulman radical 3.
Son statut de citoyen naturalisé a été remis en cause à plusieurs reprises, avec des appels à sa dénaturalisation et à son expulsion, jugeant qu'il serait incompatible avec les valeurs politiques et civiques américaines, voire un ennemi de la nation.
[13] En septembre, Donald Trump a menacé de réduire les financements fédéraux de New York en cas de victoire de Zohran Mamdani, qu'il considère comme un communiste. La veille de l'élection, il a exhorté ses partisans à voter pour Andrew Cuomo plutôt que pour le candidat républicain Curtis Sliwa, vu comme un original au sein même du GOP, afin d'éviter une division des voix.
[14] Avec ces deux dernières références, Mamdani emprunte directement au père d'Andrew Cuomo, Mario Cuomo, qui fut le 52e gouverneur de New York de 1979 à 1982.
Né dans le Queens, dans une famille d'origine italienne, Mario Cuomo a prononcé un discours télévisé remarqué lors de la Convention démocrate nationale de 1984, A Tale of Two Cities, devant 80 millions de personnes. Dans celui-ci, il s'attaque à Ronald Reagan : « Il y a du désespoir, Monsieur le Président, dans les visages que vous ne voyez pas, dans les endroits que vous ne visitez pas, dans votre ville brillante ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment la gauche radicale a conquis New York

New York City, ses huit millions d'habitants, ses gratte-ciel du Financial District, ses théâtres de Broadway et… son maire socialiste. Capitale de la mode et de la culture, centre de la finance globalisée, “NYC” représente la 10e économie mondiale en incluant son agglomération. Elle vient d'élire un jeune maire de 34 ans, musulman, immigré naturalisé en 2018 et ouvertement propalestinien. Zohran Kwame Mamdani aura sous sa responsabilité un budget de 115 milliards de dollars et trois cent mille fonctionnaires, dont plus de trente mille policiers. Comprendre comment ce jeune “démocrate socialiste” a conquis la capitale du capitalisme permet de tirer des leçons précieuses.
Tiré de Frustration Magazine
6 novembre 2025
Par Politicoboy
La campagne a également démontré le degré d'acharnement et de violence dont était capable la bourgeoisie, démocrate comme trumpiste, pour s'opposer au modeste projet progressiste porté par Mamdani. Si sa victoire constitue un séisme politique aux États-Unis, Mamdani va faire face à des défis colossaux pour parvenir à incarner une alternative crédible au trumpisme.
Certes, New York est une ville démocrate ayant voté à 76 % pour Joe Biden en 2020 et 68 % pour Kamala Harris en 2024. Certes, Zohran Mamdani n'est pas son premier maire “socialiste”. Mais les élections récentes montrent la tendance de la ville à élire des maires issus de l'aile droite du Parti démocrate, voir des républicains. Le sortant Éric Adams avait été élu sur une ligne sécuritaire, contre le slogan “Defund the police” porté par le mouvement Black Lives Matter. Il a pactisé avec Donald Trump pour obtenir l'abandon des chefs d'accusation pour corruption dont il faisait l'objet. Avant lui, le progressiste Bill de Blasio avait eu toutes les peines du monde à faire oublier le règne de Michael Bloomberg, ancien républicain et milliardaire ayant fait fortune en vendant des terminaux informatiques pour les salles de marché de Wall Street. Bloomberg avait institutionnalisé le contrôle au faciès et succédait au républicain Rudy Giuliani. Si ce dernier s'était illustré par sa réponse aux attentats du 11 septembre, on retiendra davantage son rôle d'homme de main de Donald Trump qui a culminé par son implication dans la tentative de subversion des élections de 2020.
Eric Adams était le maire sortant de New York. Crédit : Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0 Wikimedia Commons
New York, c'est la rapacité de Wall Street, la brutalité policière du NYPD et la grande pauvreté du Bronx. À la présidentielle de 2024, la ville qui a produit Donald Trump connaît le plus fort transfert d'électeurs du pays vers le candidat républicain. Une hémorragie particulièrement prononcée dans les quartiers populaires new-yorkais où vivent les populations hispaniques et afro-américaines censées constituer le cœur de l'électorat démocrate.
MAMDANI FAISAIT FACE À DES OBSTACLES THÉORIQUEMENT INSURMONTABLES
Loin de tirer les leçons de la présidentielle, les élites démocrates se sont rapidement rangées derrière la candidature du centriste Andrew Cuomo, fils d'un ancien gouverneur de l'État de New York et lui-même gouverneur entre 2011 et 2021. Cuomo avait été contraint de démissionner après avoir été accusé d'harcèlement sexuel par 13 femmes, sur fond de scandale portant sur sa sous-évaluation du chiffre des décès en maison de retraite liés à l'épidémie de Covid. Cuomo, dont le frère cadet était le présentateur vedette du JT de CNN, incarnait une dynastie politique indéboulonnable. Fort de ses réseaux politiques et du soutien des milieux d'affaires, il avait fait de sa victoire à New York une inévitabilité. Battu aux primaires, il s'est représenté comme indépendant à l'élection générale avec le soutien des anciens maires Éric Adams et Michael Bloomberg, de Bill et Hillary Clinton, de 26 milliardaires de Wall Street, de Woody Allen, du lobby pro-israélien AIPAC et d'Elon Musk. Il disposait de trois fois plus d'argent que Mamdani pour faire campagne et bénéficiait du soutien plus ou moins implicite de la presse nationale et locale.
Andrew Cuomo en décembre 2016. Crédit : Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Dans ce contexte, le triomphe d'un Musulman ouvertement “démocrate socialiste” et propalestinien ouvre des perspectives politiques saisissantes. D'autant plus que sa victoire s'accompagne d'une participation record, portée par la surmobilisation des jeunes hommes, des classes populaires et des personnes de couleur qui avaient déserté le parti démocrate.
“THE AFFORDABILITY AGENDA" : MANDANI A AXÉ SA CAMPAGNE SUR LE COÛT DE LA VIE EN L'ANCRANT DANS LA CONFLICTUALITÉ
Suite à la réélection de Donald Trump , Mamdani a arpenté les ruesdu Bronx et du Queens pour interroger les anciens électeurs de Biden ayant voté Trump. Systématiquement, la réponse tournait autour du pouvoir d'achat et de l'inflation. Armés de leurs enquêtes d'opinions, les stratèges démocrates estimaient que la mairie de New York se jouerait sur le thème de la sécurité. Ignorant ces conseils, Mamdani a décidé de faire campagne sur les questions relatives au coût de la vie. Et de porter des propositions simples : des bus gratuits et rapides, le gel des loyers pour les deux millions d'appartements à loyer contrôlé, la gratuité des places en crèche et l'instauration d'épiceries de quartier à but non lucratif, gérées par la ville. Cet agenda sera financé par une taxe sur les plus riches et les grandes entreprises, afin d'aligner le taux de prélèvement sur celui pratiqué par l'État voisin du New Jersey.
Avoir un programme populaire, porteur de conflictualité (“les milliardaires ne devraient pas exister”) et soutenu par la majorité des Américains est nécessaire, mais pas suffisant. Le message doit être crédible et entendu. La gratuité des bus peut sembler idéaliste à certains électeurs ou, pour citer une journaliste surpayée de Fox News, le meilleur moyen de détériorer le service en le rendant accessible aux clochards et plus démunis. À ces objections, Mamdani a opposé le test convaincant déjà effectué par l'État de New York sur une poignée de lignes. Et la gratuité des ferrys. De même, l'idée des épiceries publiques a été moquée par la presse et ses concurrents, avant que Mamdani explique que ce type de projet a existé par le passé, qu'il commencerait par un magasin test et qu'il abandonnera le programme en cas d'échec. L'objectif est de baisser le prix des biens essentiels tout en offrant aux quartiers délaissés un accès facile à des supermarchés de proximité. Pragmatisme et connaissance du terrain ont permis à cette proposition de séduire l'électorat.
Enfin, Mamdani maîtrise les dossiers sur le bout des doigts, ce qui lui permet de briller en interview et de démontrer la faisabilité de son programme de manière convaincante. D'autant plus qu'il répond à un besoin réel des New-Yorkais étouffés par la hausse du coût de la vie. Que ce soit dans les quartiers hipster de Brooklyn et West village où les places en crèches coûtent les yeux de la tête, ou au fin fond du Bronx mal desservi par des bus hors de prix.
DES OBSTACLES MAJEURS SURMONTÉS PAR UNE CAMPAGNE PARTANT DE LA BASE ET DU TERRAIN
Zohran Mamdani n'a pas été serveur dans un bar comme Alexandria Ocasio-Cortez. Il n'a pas grandi dans un logement social comme Bernie Sanders. Sa mère est une cinéaste indienne primée et son père un professeur d'université originaire d'Ouganda. Mamdani a immigré à New York à l'âge de 7 ans et a grandi dans le quartier privilégié de l'Upper West Side. Après avoir tenté une carrière dans le rap, Zohran s'est rapidement investi dans la politique auprès du DSA (Democratic Socialist of America, organisation qu'on peut classer un poil plus à gauche que la France Insoumise). Il a fait campagne pour des initiatives locales et des candidats issus du DSA avant d'être à son tour élu sous l'étiquette de ce mouvement au poste de State Assembly (député du parlement de l'État de New York) de la 36e circonscription de l'État recouvrant une partie du Queens et de Long Island. Réélu en 2022 et 2024, il a défendu de nombreuses initiatives populaires, dont la hausse du salaire minimum local. Il a également pris part à une grève de la faim avec les chauffeurs de taxi pour demander l'annulation des dettes contractées pour l'achat des licences désormais dévaluées par l'irruption d'Uber.
“Depuis trop longtemps, mes amis, la liberté appartient uniquement à ceux qui peuvent se permettre de l'acheter. Les oligarques de New York ne veulent pas que l'équation change. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour éviter que leur pouvoir s'amenuise. La vérité est aussi simple que non négociable : nous avons tous le droit à la liberté.”
Zohran Mamdani – dernier meeting de campagne, le 26/09/2025
Si sa légitimité vient du terrain, sa campagne s'inscrit dans le long et patient effortdu DSA pour conquérir le pouvoir dans l'État de New York. Le parlement et le conseil municipal comptent déjà de nombreux élus issus de ce mouvement. La candidature de Mamdani s'inscrit dans cette dynamique et a logiquement bénéficié d'une infrastructure militante conséquente pour prendre son envol.
Crédité de 5 % dans les sondages au début de la campagne, Mamdani a mobilisé des dizaines de milliers de volontaires pour faire du porte à porte dans 3 millions de logements afin de diffuser son message. Ses vidéos virales partagées sur les réseaux sociaux sont probablement le principal aspect de sa campagne retenu par les démocrates de Washington. Mais la forme s'appuie sur le fond : lorsqu'il interroge les célèbres vendeurs de rue de chicken rice sur la hausse de leurs prix, c'est pour identifier le problème. La ville sous-traite à des intérêts privés l'attribution de licences hors de prix. Et de conclure qu'en reprenant la main sur ce cauchemar administratif, Zohran obtiendra un retour du prix de ce plat emblématique en dessous des dix dollars.
Zohran Mamdani parlant lors d'une réunion DSA 101 à l'Église du Village à NYC, le 11 novembre 2024. Crédit : Par Bingjiefu He — Travail personnel, CC BY-SA 4.0
De fait, sa discipline exemplaire en matière de communication, ramenant sans cesse ses réponses à sa vision d'une ville financièrement accessible à tous et pas seulement aux milliardaires, a été un facteur déterminant de son succès. Comme sa volonté d'ancrer ce discours dans une logique de lutte des classes.
ISLAMOPHOBIE ET PROCÈS EN ANTISÉMINISTME : LE FLOP DES ARMES DE LA BOURGEOISIE CONTRE MAMDANI
Le premier tournant de la campagne a probablement eu lieu lors du débat des primaires démocrates. Les candidats devaient donner le nom du premier pays qu'ils visiteraient en tant que maire. Tous ont rivalisé de zèle pour nommer Israël, en partie pour séduire le million d'habitants de confession juive vivant à New York. Mamdani a répondu qu'il resterait à New York pour s'occuper des cinq arrondissements de la ville. Désireux de le pousser à la faute, la modératrice lui demande s'il défend le droit à Israël d'exister en tant qu'État juif (“Right to exist as a jewish state”). Mamdani répond avec le sourire qu'il défend l'existence d'Israël comme État universaliste et démocratique. Il jette ainsi un pavé dans la marre en soulignant le fait qu'Israël ne traite pas de manière égale ses citoyens.
Zohran Mamdani au rassemblement Resist Fascism à Bryant Park le 27 octobre 2024.. Crédit : Par Bingjiefu He — Travail personnel, CC BY-SA 4.0
Selon les stratèges démocrates, cette sortie aurait dû condamner Mamdani. Ses adversaires tentent d'exploiter cette “faute” en déclenchant une première vague d'attaques visant à le repeindre en dangereux antisémite voire en jihadiste. On le somme de condamner des slogans propalestiniens, lui reproche de parler de génocide à Gaza ou d'apartheid en Israël. Mais Mamdani refuse de céder, pointe à chaque interview l'incongruité de la question israélienne dans une élection municipale et pivote toujours sur son programme pour “un New York abordable” (“affordable agenda”). Tout en confirmant qu'il fera arrêter Netanyahou par la police de New York si ce dernier remet les pieds à l'ONU.
Cuomo a instrumentalisé l'islamophobie à outrance et usé du procès en antisémitisme jusqu'à la corde. Il était question de savoir si Mamdani mangeait avec les mains et espérait un nouvel attentat du 11 septembre. Dans les dernières heures de la campagne, les alliés de Cuomo ont publié des vidéos montrant le crash des avions sur les Twin towers pour relier Mamdani à cette tragédie, tandis que Hillary Clinton a évoqué sa crainte pour la sécurité des Juifs new-yorkais en cas de victoire de ce dernier.
LE RÉSULTAT DES PRIMAIRES DÉMOCRATES IGNORÉ PAR LES CADRES ET ÉLITES DU PARTI
Mamdani a largement remporté les primaires démocrates. Les sondeurs n'avaient pas anticipé la surmobilisation des jeunes et des classes populaires en faveur de Mamdani. Assuré de l'emporter à l'élection générale en cas de duel contre le candidat républicain, ce premier succès provoquait déjà des retentissements nationaux.
Joe Biden et Kamala Harris en 2022. Crédit : The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Depuis la lourde défaite de Kamala Harris, le Parti démocrate tétanisé ne parvenait pas à trouver une stratégie d'opposition face à Donald Trump. Ni un projet politique susceptible de mettre fin à l'hémorragie des électeurs jeunes, masculins, non diplômés et non blancs vers le trumpisme. Dans ce contexte, Mamdani propose une solution clé en main : ne rien concéder à l'extrême droite sur ses thèmes de prédilection (sécurité, immigration, question israélienne) et faire campagne sur des thèmes universellement populaires (le pouvoir d'achat, la hausse du salaire minimum, le renforcement des services publics). Si les démocrates ont repris le thème du coût de la vie, ils n'ont pas embrassé la lutte des classes et la taxation des milliardaires qui l'accompagne. Ni ne se sont rangés derrière Mamdani.
Malgré sa nette victoire à la primaire, les cadres du Parti ont refusé de lui apporter leur soutien officiel (“endorsment”). En particulier, la gouverneur de l'État de New York, le sénateur de l'État de New York (Chuck Schumer, président de l'opposition démocrate au Sénat) et Hackeem Jeffries (président de l'opposition démocrate à la Chambre des représentants du Congrès et élu de New York) ont refusé de le soutenir. Pire, un nombre important d'entre eux y sont allés de leurs attaques personnelles pour repeindre Mamdani en dangereux islamiste antisémite. Au point de contaminer l'esprit d'une représentante de la bourgeoisie intellectuelle française comme Laure Adler.
En France aussi les attaques racistes contre Zohran Mamdani ont été relayées.
Si ce n'était pour l'insistance de ses donateurs et le manque de ralliement des cadres du Parti démocrate derrière Mamdani, Andrew Cuomo aurait probablement jeté l'éponge. Au lieu de cela, il s'est présenté en tant que candidat indépendant à l'élection générale. S'il fallait une preuve que les primaires auxquelles tiennent de nombreux acteurs politiques français ne servent qu'à neutraliser la gauche de rupture, le cas new-yorkais est particulièrement parlant.
TRUMP, PRINCIPAL OBSTACLE À LA RÉUSSITE DE MAMDANI ?
Le dernier enseignement de cette campagne provient de la réaction de la droite et de l'extrême droite américaine. La veille du scrutin, Cuomo a obtenu le soutien de Donald Trump. Le président avait un double message à faire passer aux New-Yorkais. Le premier s'adressait aux électeurs républicains pour leur demander de voter Cuomo au lieu de Sliwa, le candidat officiel du Parti conservateur. Cela a fonctionné, Sliwa n'obtenant que 7 % des voix alors que les sondages le créditaient de 15 à 20 %.
Aux démocrates, Trump promettait les foudres de son administration en cas de victoire de Mamdani : suppression de la contribution fédérale au budget de la ville et envoi de la garde nationale dans les rues de New York pour intimider les habitants. Musk a amplifié ce message sur son réseau social, ainsi que ceux des alliés de Donald Trump demandant à ce que Mamdani soit déchu de sa nationalité et expulsé en Ouganda.
Mamdani n'a pas fléchi. Il a promis de résister à Trump tout en dénonçant le fait qu'il avait rompu ses promesses de campagne en ne faisant rien pour améliorer le pouvoir d'achat des Américains. Il a rappelé que le ralliement d'Elon Musk derrière son adversaire avait coûté près d'un milliard de dollars en exonération d'impôts aux New Yorkais via les politiques fiscales mises en place par Cuomo lorsqu'il était gouverneur de l'État.
“Nous pouvons répondre à l'autoritarisme de l'oligarchie par la force qu'elle craint, pas par l'apaisement qu'elle souhaite.”
Zohran Mamdani – discours de victoire, le 5 novembre 2025
L'extrême droite montre ainsi son vrai visage. Elle n'hésite pas à s'allier avec les centristes démocrates pour protéger les intérêts d'un petit groupe de riches New Yorkais menacé d'une modeste hausse d'impôt (Mamdani notait que les 26 milliardaires qui ont financièrement soutenu la campagne de Cuomo ont dépensé plus pour le battre que ce que leur coûterait sa nouvelle taxe). Si la comparaison avec la panique provoquée par la proposition de taxe Zucman en France auprès de la bourgeoisie parisienne semble évidente, l'opposition de Trump à Mamdani s'explique aussi par ce qu'il incarne : un contre-modèle à son capitalisme oligarchique et fascisant.
“IF YOU CAN MAKE IT THERE, YOU CAN MAKE IT ANYWHERE"
Le plus dur reste à faire. Tenir ses promesses électorales nécessitera de composer avec l'hostilité de la toute puissante police new-yorkaise, le risque de fuite des capitaux orchestrée par les pontes de Wall Street, l'opposition de la presse (New York Times compris) et l'ombre de la Maison Blanche, qui pourrait tenter de mettre ses menaces à exécution. Le Parti démocrate représente une autre inconnue. Kathy Hochul, la gouverneur de l'État de New York, a le pouvoir de bloquer divers projets de hausse d'impôts municipaux promis par Mamdani. Si elle a fini par le soutenir, c'est avant tout par crainte de faire face à un candidat proche de lui lors des primaires pour sa propre réélection. Elle a clairement indiqué que ce ralliement ne l'empêcherait pas de s'opposer aux hausses d'impôts. Reste à savoir si le rapport de force lui permettra de tenir cette ligne.
Mamdani semble déterminé à relever ce défi. Il peut compter sur l'exemple de Bernie Sanders, ancien maire ultra populaire de Burlington, avec qui il s'entretient régulièrement. Et sur celui de Fiorello Laguardia à New York, il y a près d'un siècle. Contrairement à de nombreux démocrates, Mamdani comprend que le pouvoir est fait pour servir. “Les républicains n'ont jamais de scrupule à utiliser tout le pouvoir conféré par les institutions, je compte faire de même en tant que maire” expliquait-il. Or, il dispose d'un mandat clair octroyé par une victoire sans appel.
“Je suis un musulman. Je suis démocrate socialiste. Et je refuse de m'en excuser.”
Zohran Mamdani – discours de victoire, le 5 novembre 2025
Porté par une coalition multiculturelle et socialement diverse, il obtient plus de 50 % des voix et provoque la plus forte participation depuis 1969. Les retours de terrain et données électorales montrent qu'il s'agit à la fois d'un vote d'adhésion pour son projet, d'un vote anti-Trump survenant dans un contexte particulier (le blocage budgétaire au Congrès instrumentalisé par Trump pour mettre fin à l'aide alimentaire dont dépendent 41 millions d'Américains) mais également d'un vote contre l'establishment démocrate. Des retraités expliquaient ainsi voter Mamdani pour exprimer leur colère contre les cadres de leur parti, jugés incapables de s'opposer à Trump et promptes aux manœuvres politiciennes. Encore une leçon que la gauche bourgeoise française fera semblant d'ignorer…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre

Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l'avons déjà fait le 11 octobre, avec et pour les femmes du monde entier
Tiré de l'infolettre de Nouveau Parti Anticapitaliste NPA29
3 novembre 25
Celles qui sont victimes des violences machistes, des conflits armés, des famines, des spoliations de terres et de leurs biens naturels, des gouvernements réactionnaires et des états théocratiques. Avec toutes celles qui ne peuvent pas parler, dont les voix sont étouffées, qui subissent des violences sexuelles, des tortures et des mutilations.
Le 25 novembre nous marcherons pour rendre hommage à toutes les victimes de la violence machiste, les femmes, les filles, les personnes LGBTQIA+, à toutes celles qui souffrent et qui luttent, en dépit des risques encourus. A toutes celles que nous avons perdues.
Les violences et l'impunité des agresseurs persistent 8 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, en plein #MeToo. La plupart du temps, encore, les victimes ne sont pas crues, les plaintes classées sans suite. Le parcours judiciaire revictimise bien souvent les femmes et constitue un obstacle à la sortie de la violence comme la baisse du financement public des associations d'accompagnement des victimes.
Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, et tout le temps : dans nos espaces familiaux, sur nos lieux de travail et d'études, dans l'espace public, dans les transports, dans les établissements de soin, les cabinets gynécologiques, dans les maternités, dans les ateliers des chaînes d'approvisionnement des multinationales, les commissariats, les centres de rétention, dans les milieux du théâtre, du cinéma, du sport, en politique… Dans tous les milieux sociaux.
Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent au croisement de plusieurs systèmes d'oppressions.
Ainsi les femmes les plus touchées par ces violences sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : les femmes victimes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, les femmes migrantes, sans papiers, les travailleuses précaires, les femmes sans domicile et autres femmes précarisées, femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes et bi, les femmes trans, les femmes en situation de prostitution, et celles victimes de l'industrie pédo et pornocriminelle.
Sans autorisation de travailler, les femmes étrangères dont les demandeuses d'asile sont très vulnérables aux réseaux de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
En France, en 2024, c'est encore plus d'un féminicide tous les trois jours commis par un conjoint ou un ex-conjoint Des femmes assassinées parce qu'elles sont femmes. Le nombre de femmes victimes de violences dans le couple et les enfants co- victimes ne diminue pas, tout comme les viols ou tentatives.
La quasi-totalité des agresseurs sont des hommes (97,3%).
Une femme en situation de handicap sur cinq a été victime de viol. 50% des lesbiennes et 75% des bi ont été confrontées à des violences dans l'espace public et 85 % des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe. Les femmes âgées de plus de 70 ans ne sont pas prises en compte dans les enquêtes sur les violences, elles représentent pourtant 21% des féminicides.
160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, en majorité au sein de la famille. Sur les lieux de travail plus de 8000 viols ou tentatives ont lieu chaque année et un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel. Les employeurs publics et privés doivent faire cesser les violences et protéger les victimes, y compris de violences conjugales.
La montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde constitue une menace majeure pour les droits des femmes et en France, le danger de son accession au pouvoir n'est pas écarté. Ces droits sont attaqués dès que l'extrême droite est au pouvoir.
Depuis quelque temps, elle prétend lutter contre les violences faites aux femmes. Sous couvert de défendre certaines d'entre elles, ces mouvements exploitent la question des violences sexistes à des fins racistes et fémonationalistes, ne s'indignant que selon l'origine, la nationalité ou la religion réelle ou supposée des agresseurs. Dans ce climat délétère, les femmes portant le voile sont de plus en plus souvent la cible d'agressions dans la rue, dans les médias, comme dans les discours politiques.
Les groupuscules fascistes attaquent régulièrement des militantes et militants sans réaction des pouvoirs publics.
Derrière les slogans et les postures prétendument féministes, l'extrême droite ne défend ni la liberté des femmes, ni leur émancipation, ni l'égalité, et se désintéresse profondément de la réalité et des droits des femmes qui luttent dans le monde.
Sans politique publique à grands moyens, sans prévention et sans éducation, les garçons et les hommes continueront de perpétrer des violences
Les organisations féministes et syndicales exigent :
Une loi-cadre intégrale contre les violences, comme en Espagne.
3 milliards d'euros nécessaires pour la mettre en œuvre
Une Éducation à la Vie Affective Relationnelle et à la Sexualité (EVARS) effective partout
L'arrêt immédiat de la baisse des financements et un rattrapage du budget des associations qui accompagnent les victimes et assurent l'éducation populaire sur les questions de violences et d'égalité femmes-hommes.
Tant que l'une d'entre nous n'est pas libre, tant que les violences machistes s'exerceront sur une seule d'entre nous, nous lutterons !
Nous appelons à participer aux mobilisations à l'occasion de la journée internationale des droits des enfants et pour le jour du souvenir trans (TDoR).
Contre les violences faites aux femmes et aux filles, les violences sexistes et sexuelles, manifestons partout le samedi 22 novembre 2025 et le mardi 25 novembre 2025 !
31 Oct 2025
https://www.grevefeministe.fr/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sept thèses sur les insurrections de la génération Z dans le sud global

Les murs de Santiago, au Chili – la ville où je vis – sont marqués de graffitis effacés de l'estallido social (soulèvement social) de 2019. Des années plus tard, ces slogans continuent de se répandre sur les trottoirs, de « Ils nous ont tellement pris qu'ils nous ont même enlevé la peur » à « Ce ne sont pas 30 pesos, ce sont 30 ans ».
Les deux slogans font référence aux 30 années d'austérité néolibérale imposées au peuple chilien, y compris une augmentation de 30 pesos du prix des billets de métro et des coupes profondes dans le système de salaire social du pays. Le soulèvement a été mené par des lycéens nés entre 2001 (18 ans) et 2005 (14 ans), qui font partie de la génération Z ou « Gen Z ». Cependant, ce terme, imposé au monde par les médias grand public, efface souvent la complexité sociale et la spécificité nationale de telles révoltes. Néanmoins, ce terme, ainsi que le concept de « génération », méritent d'être explorés.
Les protestations au Chili – qui ont finalement attiré toutes les tranches d'âge et délégitimé le gouvernement de droite de Sebastián Piñera – n'étaient pas singulières. Les jeunes nés à cette époque ont mené des protestations à travers le monde, y compris des mobilisations de masse contre un viol collectif à Delhi, en Inde (2012) ; la campagne March for Our Lives contre la violence armée aux États-Unis (2018) ; et la campagne Fridays for Future contre la crise climatique (2018), initiée par l'activiste suédoise Greta Thunberg (née en 2003 et récemment torturée par le gouvernement israélien). Le soulèvement chilien a été suivi par la grève nationale en Colombie en 2021, l'Aragalaya (lutte) au Sri Lanka en 2022, et le soulèvement au Népal plus tôt cette année qui a entraîné la démission du gouvernement de centre-droite. Dans chacun de ces cas, ce qui a commencé comme une indignation morale à propos d'une question singulière s'est transformé en une critique d'un système qui s'est avéré incapable de reproduire la vie pour les jeunes.
Le concept de génération a été développé il y a un siècle par le chercheur allemand Karl Mannheim dans son essai « Le problème sociologique des générations » (1928). Pour Mannheim, une génération n'est pas définie par l'époque où une cohorte est née mais par sa « situation sociale » (soziale Lagerung). En termes politiques, une génération se produit lorsqu'elle connaît des changements rapides et perturbateurs qui la font rencontrer à nouveau la tradition par le biais de nouveaux « porteurs de culture » (Kulturträger) – des individus et des institutions qui transmettent la culture – et devient une force active de changement social, bien loin de la manière dont les générations sont devenues une typologie de marketing après la Seconde Guerre mondiale (Baby Boomers, Génération X, Génération Y, etc.). Mannheim voyait les générations comme des forces de changement social, tandis que la culture néolibérale les a transformées en « segments » dans leurs stratégies de marque.
Le terme Gen Z a été utilisé dans les descriptions des protestations qui ont lieu des Andes à l'Asie du Sud, où les jeunes – frustrés par les possibilités limitées d'avancement social – sont descendus dans les rues pour rejeter un système défaillant. Certains éléments de la théorie de Mannheim sont à l'œuvre ici. Il est vrai que les forces impérialistes interviennent souvent pour instiguer et façonner ces protestations, mais il serait inexact de considérer ces protestations comme étant simplement le produit d'une intervention extérieure. Il existe d'importants facteurs sociologiques internes qui nécessitent une analyse afin de comprendre ces « protestations de la génération Z ». Beaucoup d'entre eux sont motivés par une série de processus qui se chevauchent et qui émergent du contexte national tout en étant conditionnés par la conjoncture internationale. Dans cette newsletter, nous proposons sept thèses pour commencer à comprendre ces évolutions et peut-être les canaliser dans une direction progressiste.
Thèse un. Il y a une poussée démographique de la jeunesse à travers le Sud Global, où l'âge médian est de 25 ans, et les gens dans ces jeunes sociétés se retrouvent victimes de politiques d'austérité et de dette sévères, de catastrophes climatiques et de guerres permanentes. En Afrique, l'âge médian est de 19 ans – plus bas que sur n'importe quel autre continent. Au Niger, l'âge médian est de 15,3 ans ; au Mali, de 15,5 ans ; en Ouganda et en Angola, de 16,5 ans ; et en Zambie, de 17,5 ans.
Thèse deux. Les jeunes du Sud sont frustrés par le chômage. Le néolibéralisme a affaibli la capacité de l'État, ne laissant que très peu d'outils pour résoudre ce problème (ce qui a conduit à des demandes telles que l'ouverture d'opportunités d'emploi étatiques, dans le cas du mouvement de réforme des quotas au Bangladesh). Les jeunes éduqués ayant des aspirations de classe moyenne sont incapables de trouver un travail convenable, ce qui entraîne un chômage structurel ou un décalage des compétences. En Algérie, il existe un terme pour désigner les chômeurs qui emprunte à l'arabe et au français : ceux qui « s'appuient contre le mur » pour le soutenir (hittiste, de l'arabe hayt, qui signifie « vie »). Dans les années 1990, le système universitaire a été élargi et privatisé, ce qui a ouvert les portes – moyennant finance – à une grande partie de ce qui allait devenir la génération Z. Il s'agit d'enfants issus des classes moyennes et moyennes inférieures, mais aussi de la classe ouvrière et de petits agriculteurs qui ont réussi à gravir les échelles sociales. La génération Z est la plus instruite de l'histoire, mais c'est aussi la plus endettée et la plus sous-employée. Cette contradiction entre aspiration et précarité engendre un profond ressentiment.
Troisième thèse. Les jeunes ne veulent pas avoir à migrer pour avoir une vie digne. Au Népal, de jeunes manifestants ont scandé contre la contrainte à la migration économique. Nous voulons des emplois au Népal. Nous ne voulons pas avoir à migrer pour travailler. Cette obligation de migrer provoque une honte de sa propre culture et une déconnexion de l'histoire des luttes qui ont façonné sa société. Il y a près de 168 millions de travailleurs migrants dans le monde – s'ils formaient un pays, il serait le neuvième plus grand du monde, après le Bangladesh (169 millions) et devant la Russie (144 millions). Parmi eux, des ouvriers du bâtiment népalais dans les États du Golfe et des travailleurs agricoles andins et marocains en Espagne. Ils envoient des sommes qui soutiennent la consommation des ménages dans leurs pays ; dans de nombreux cas, le total des sommes (qui s'élevait à 857 milliards de dollars en 2023) est supérieur à l'investissement direct étranger (comme au Mexique). La dislocation sociale, la ligne de couleur internationale du travail et le mauvais traitement des migrants y compris le mépris de leurs qualifications éducatives – rendent l'attrait de la migration presque nul.
Quatrième thèse. Les grandes entreprises agroalimentaires et les sociétés minières ont intensifié leur assaut contre les petits agriculteurs et les travailleurs agricoles (l'incitation à la révolte des agriculteurs en Inde). Les jeunes de ces classes, fatigués de la détresse rurale et radicalisés par les protestations souvent ratées de leurs parents, se déplacent vers les villes puis à l'étranger pour trouver du travail. Ils apportent leur expérience de la campagne aux villes et sont souvent la principale phalange de ces mouvements de protestation.
Thèse cinq. Pour la génération Z, la question du changement climatique et de la détresse environnementale n'est pas une abstraction, mais une cause imminente de prolétarisation par le déplacement et les chocs de prix. Les habitants des zones rurales voient que la fonte des glaciers, les sécheresses et les inondations frappent précisément là où les chaînes d'approvisionnement « vertes » impérialistes cherchent des ressources comme le lithium, le cobalt et l'hydroélectricité. Ils comprennent que la catastrophe climatique est directement liée à leur incapacité à construire un présent, encore moins un avenir.
Thèse six. La politique établie est incapable de répondre aux frustrations de la génération Z. Les constitutions ne reflètent pas la réalité, et les pouvoirs judiciaires irresponsables semblent vivre sur une autre planète. Les principales interactions de cette génération avec l'État se font par le biais de bureaucrates insensibles et de policiers militarisés. Les partis politiques sont paralysés par le consensus de Washington sur l'austérité et la dette, et les organisations non gouvernementales se concentrent étroitement sur des questions individuelles plutôt que sur l'ensemble du système. Les anciens partis de libération nationale ont largement épuisé leur programme ou l'ont vu détruit par l'austérité et la dette, laissant un vide politique dans le Sud global. « Débarrassons-nous de tous » est une politique qui se termine par un tournant vers les influenceurs des réseaux sociaux (comme le maire de Katmandou, Balen Shah) qui n'ont pas participé à la politique des partis mais qui utilisent souvent leurs plateformes pour prêcher un évangile d'anti-politique et de ressentiment de la classe moyenne.
Thèse sept. L'essor du travail informel a créé une société désorganisée, sans espoir de camaraderie entre les travailleurs ou d'adhésion à des organisations de masse comme les syndicats. L'ubérisation des conditions de travail a créé une informalité de la vie elle-même, où le travailleur est aliéné de toute forme de relation. L'importance des médias sociaux augmente avec l'accroissement de l'informalité, car Internet devient le principal moyen de transmission des idées, supplantant les anciens modes d'organisation politique. Il est tentant mais inexact de suggérer que les médias sociaux sont eux-mêmes une force motrice derrière cette vague de protestations. Les médias sociaux sont un outil de communication qui a permis une diffusion des sentiments et des tactiques, mais ils ne sont pas la condition de ces sentiments. Il est également important de noter que l'internet est un outil d'extraction de surplus – les travailleurs de plateforme, ou travailleurs à la tâche, sont disciplinés par des algorithmes qui les poussent à travailler de plus en plus dur pour de moins en moins de rémunération.
Les sept thèses ci-dessus tentent de définir les conditions qui ont produit les soulèvements de la génération Z dans le Sud global. Ces soulèvements ont été largement urbains, avec peu d'indications qu'ils aient attiré la paysannerie et les travailleurs ruraux. De plus, les agendas de ces protestations abordent rarement les crises structurelles à long terme dans les pays sous-développés. En réalité, la politique typique des soulèvements de la génération Z mène à l'explosion du ressentiment de la classe moyenne. Ces protestations sont souvent – comme au Bangladesh et au Népal – récupérées par des forces sociales bien établies qui exacerbent les protestations dans les rues et développent un programme qui profite aux financiers occidentaux. Néanmoins, ces soulèvements ne peuvent être ignorés : leur fréquence ne fera qu'augmenter en raison des facteurs que nous avons décrits. Le défi pour les forces socialistes est d'articuler les véritables griefs de la génération Z en un programme qui exige une part plus élevée du surplus social et utilise ce surplus pour améliorer l'investissement fixe net et transformer les relations sociales.
Vijay Prashad, 13 octobre 2025
https://thetricontinental.org/newsletterissue/gen-z-rebellion/
Traduction Gilles Lemaire
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gouvernement Legault : le Titanic fonce sur l’iceberg et le capitaine appuie sur l’accélérateur

Le gouvernement Legault fait face à des vents contraires, voit sa base électorale fondre comme neige au soleil et sa déroute provoque un exode dans sa députation qui fait craindre un effacement complet de la formation politique lors de la prochaine élection en octobre 2026 (ou avant…). Un tel fiasco s'explique par l'accumulation d'échecs dans ce qui devait représenter son legs, l'effondrement de la filière batterie est symbolique en ce sens.
Les politiques impopulaires, comme celle de la réforme du régime forestier, la négation de la crise du logement, la démission face à la crise climatique, le refus de reconnaître le caractère systémique des discriminations vécues par les nations autochtones, son double discours concernant à la lutte des femmes contre les violences et les féminicides, autant d'échecs politiques dont une majorité de la population lui impute la responsabilité.
Les réactions de la CAQ : faire diversion en pointant de prétendus boucs émissaires responsables de la situation se dégageant ainsi de toute responsabilité. L'immigration serait responsable de la crise du logement. Il serait inutile d'en faire plus pour lutter contre la crise climatique, puisque tous nos voisins ont abandonné ce combat. La « capacité de payer » de la population expliquerait pourquoi il est impossible d'en faire davantage dans la lutte contre la violence faite aux femmes.
Face à cette situation intenable, la CAQ choisit la fuite en avant afin de tenter de regrouper sa base électorale complètement désorientée : une confrontation avec les médecins, des coupures massives dans la fonction publique, un balayage des normes de protection environnementales et des moyens pour les faire appliquer, une réduction importante des seuils d'immigration. Un tour de vis vers une droite de plus en plus décomplexée, qui frise le trumpisme sous certains aspects. La CAQ a choisi d'affronter les organisations qui représentent un contre-pouvoir : les syndicats sont dans sa mire et son intention est d'affaiblir la capacité de ces organisations de modifier le rapport de force en faveur des classes populaires.
Les oppositions : surenchère ou naïveté
C'est un pari risqué : le PQ, en tête dans les sondages, reprend une bonne partie de son discours, tout comme le parti conservateur qui pousse le discours droitier encore plus loin et les libéraux qui reprennent la position de parti du grand capital canadien. Beaucoup de propositions pour un électorat particulièrement segmenté.
Le PQ et le PLQ veulent profiter de la chute de la CAQ dans les intentions de vote. Le PQ s'inscrit en continuité avec le discours de la CAQ à propos de l'immigration. Il propose une alternative résolument campée à droite et profite actuellement de l'incapacité des autres partis à se démarquer. Le PLQ souhaite reprendre son rôle de défenseur du Canada en surfant sur la vague d'impopularité de la guerre tarifaire de Trump contre les intérêts économiques canadiens. Mais il suscite toujours la méfiance d'une majorité de la population qui se rappelle la gestion austéritaire des libéraux au pouvoir. QS est traversé par une crise d'orientation alors que son aile parlementaire et sa direction ont toutes deux tenté de recentrer le programme et le discours du parti de gauche pour lui donner un air de « respectabilité » sans que l'appui au parti ne progresse, loin de là puisqu'il semble croupir dans les bas-fonds des sondages.
Enfin, la majorité des organisations populaires, les centrales syndicales en premier, tiennent un discours prônant la reprise du « dialogue » avec le gouvernement, appelant la CAQ à de meilleures dispositions. Une telle preuve de naïveté désarme les personnes qui souhaitent se mobiliser contre les politiques de la CAQ. Une telle illusion sur la possibilité de ramener la CAQ et les autres partis de pouvoir à de meilleurs sentiments risque de coûter cher lorsque viendra le temps de fixer des objectifs de mobilisation. Laisser croire que la CAQ pourrait modifier son approche alors qu'elle joue sa survie dans les prochains mois repose sur une mauvaise lecture de la situation. Tente-t-on de « sensibiliser » la CAQ ou bien de provoquer sa chute ? Si plusieurs souhaitent que la CAQ soit éjectée du pouvoir, par qui la remplace-t-on ? Les réponses à de telles questions viendront teinter les débats dans les prochains mois.
Des perspectives de lutte bien vivantes
Malgré cela, les possibilités de résistance sont toujours bien réelles : une vaste mobilisation syndicale est prévue pour le 29 novembre, la Marche mondiale des femmes a remporté un franc succès, le milieu étudiant a démontré son potentiel de mobilisation grâce à son engagement envers la Palestine, et la volonté de se remobiliser contre la crise climatique persiste, révélant un grand potentiel de luttes citoyennes.
La formulation de revendications et d'objectifs visant à définir une alternative aux politiques de la CAQ et des partis qui lui ressemblent devient un incontournable. Il faut profiter des quelques mois qui viennent pour mettre de l'avant un programme basé sur les intérêts des classes populaires et se donner les outils politiques nécessaires pour les porter lors de la prochaine campagne électorale afin de les mettre en application. Ni le PQ, ni le PLQ, ni les conservateurs ne doivent remplacer la CAQ au pouvoir. Ce serait blanc bonnet et bonnet blanc. Des ruines caquistes doit émerger une nouvelle alliance sociale et un programme fondé sur les communs, la coopération, la solidarité et l'autonomie populaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Montréalais·es exigent une Ville Anti-Apartheid

Tiohtià:ke/Montréal, le 8 novembre 2025 *– Une semaine après les élections municipales, une manifestation rassemblant plusieurs centaines de Montréalais·es se termine par un coup d'éclat au Pont Jacques-Cartier, aujourd'hui le samedi 8 novembre 15h00, afin d'exiger des actions immédiates pour que la Ville de Montréal devienne une Ville Anti-Apartheid en soutien
avec le peuple palestinien.
Des Montréalais·es, membres de la communauté cycliste et de la société civile montréalaise, se sont rassemblées à 13h00 au Mont-Royal à l'appel des collectifs Bikers4Palestine, MtlAntiApartheid et Désinvestir pour la Palestine. Iels ont parcouru les rues de Montréal en manifestation à vélo jusqu'au Pont Jacques-Cartier.
Lors des élections, le *mouvement Montreal Anti-Apartheid* a réussi à placer la Palestine au cœur des débats. Grâce à la mobilisation de la jeunesse montréalaise, 109 candidat·es ont signé le pacte « Montréal anti-apartheid », ce qui représente 25% des candidat·es. De ce nombre, 24 ont été élu·es, et parmi eux et elles, 19 siègent au Conseil municipal de
la Ville.
Le message des Montréalais·es est clair : il est temps de passer à l'action ! La nouvelle mairesse, Soraya Martinez Ferrada, le nouveau conseil municipal et le nouveau comité exécutif de la Ville doivent adopter dans les 90 premiers jours une motion pour s'engager à faire de Montréal une Ville anti-apartheid pour rompre toute complicité avec le génocide colonial et les crimes commis par l'entité israélienne contre le peuple palestinien depuis les décennies. La Ville de Burnaby l'a fait, Montréal doit le faire aussi !
En 1987, suite à une campagne retentissante, la Ville de Montréal a adopté des mesures concrètes anti-apartheid en solidarité avec le peuple d'Afrique du Sud. La complicité avec le génocide en cours en Palestine est donc un choix politique. Le nouveau conseil municipal a le pouvoir d'adopter les demandes du mouvement Montréal Anti-Apartheid, énumérées plus bas, et d'être à la hauteur de la solidarité des Montréalais•es.
Les Montréalais·es exigent aussi que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec rompent tous leurs liens politiques, diplomatiques, économiques, commerciaux et culturels avec l'entité israélienne, et adoptent des sanctions et imposent un embargo immédiat sur les armes.
Le soi-disant « cessez-le-feu » du président Trump est un leurre : l'armée d'occupation israélienne continue ses bombardements sur la bande de Gaza et d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire au Gazaouis.
Revendications
· Coupe ses liens institutionnels avec le gouvernement israélien et ses villes.
· Retire les contrats municipaux et les fonds de pension de l'État d'Israël, de ses institutions, de ses entreprises, ainsi que des compagnies internationales qui contribuent au maintien de l'apartheid et du génocide en cours ;
· Boycotte les représentant·es israélien·nes des milieux sportif, académique et culturel.
· Offre un sanctuaire : Montréal doit offrir un accueil digne et sécuritaire aux réfugié·es palestinien·nes et garantir leur accès aux soins et aux services sociaux.
· Exige du gouvernement canadien l'imposition immédiate d'un embargo bilatéral sur les armes vers et depuis Israël, et la fin de tout commerce militaire avec Israël via la filière américaine.
· Exige du gouvernement canadien l'élargissement du programme de visa TRV pour les Canadien·nes cherchant à se réunir avec leurs proches à Gaza, et la suppression des exigences de vérification excessives dans le processus de demande.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réaction au Plan d’immigration du Québec 2026

Planification de l'immigration au Québec, politiques de plus en plus restrictives au Canada : la Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante (CQRJM) et ses allié·es sonnent l'alarme face à l'érosion des droits des personnes migrantes.
Montréal, le 7 novembre 2025. À l'occasion d'un mois d'action en faveur de la justice migrante du 4 au 28 novembre à travers le Québec, les organisations engagées dans la Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante (CQRJM) et ses allié·es dénoncent les attaques répétées contre les droits des personnes im·migrantes et enquête d'asile. Elles s'alarment d'un recul historique en matière de justice et de solidarité à l'issue de la publication du Plan d'immigration du Québec 2026, qui prévoit une baisse des seuils d'immigration. Ce scénario nous rend incapables de remplir nos obligations internationales en matière de protection des réfugié·es et de regroupementfamilial, en plus de pousser dans la précarité un nombre croissant des travailleuses et travailleurs migrant·es actuellement au Québec.
Des politiques régressives à tous les niveaux
Au provincial, la nouvelle planification pluriannuelle de l'immigration va aggraver les situations de vulnérabilité et d'abus vécues par de nombreuses personnes im·migrantes. En abaissant les seuils d'immigration permanente et temporaire, le gouvernement leur bloque l'accès à la résidence permanente et confirme sa politique d'affichage de la réduction du nombre de personnes au statut temporaire au mépris de ceux et celles qui vivent déjà au Québec avec ce statut. Et ce d'autant plus qu'il ne remet aucunement en question le permis de travail fermé, source systémique dedépendance, d'exploitation et de vulnérabilité. Parallèlement, le gouvernement instrumentalise les personnes im- migrantes dans ses négociations avec Ottawa, allant jusqu'à menacer de couper l'aide financière de dernier recours pour les personnes en demande d'asile. Cette approche s'inscrit dans un contexte de recul plus large, marqué par la fermeture du bureau d'aide juridique en immigration de Québec et d'autres mesures restreignant l'accès auxservices.
Au fédéral, le projet de loi C-12, anciennement C-2 (Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada), limiterait le droit d'asile tout en complexifiant les procédures de demande de statut de réfugié. Il prévoit également d'accorder au gouvernement des pouvoirs accrus pour suspendre ou annuler non seulement desdemandes d'immigration, mais aussi des documents et des programmes, y compris ceux liés à la résidence permanente, tout en facilitant le partage de données personnelles. Pourtant, la mobilisation au Canada de plus de 300 organisations de la société civile avait rejeté fermement l'ensemble du projet de loi C-2. La nouvelle mouture du projet de loi cède aux caprices de l'administration Trump dans l'espoir d'un nouvel accord commercial.
Un mois d'action pour réclamer le respect des droits des personnes migrantes
Cette conférence de presse s'inscrit dans un contexte de recul généralisé des droits des personnes im- migrantes, tantau Québec qu'au Canada, une tendance qui s'observe également à l'échelle mondiale. Elle vise à dénoncer ces politiques d'exclusion et à rappeler l'urgence de défendre une approche fondée sur la justice, la solidarité et les droits humains. À cette occasion, la CQRJM <https://cqrjm.org/> lance le mois d'action pour la justice migrante <https://cqrjm.org/activites/>
, qui se traduit par une série d'événements visant à sensibiliser et mobiliser autour des enjeux migratoires, notamment en demandant auxdéputés de prioriser l'accès à la résidence permanente, entre autres.
Citations :
« Qu'il s'agisse du gouvernement fédéral avec le projet de loi C-12 ou du gouvernement du Québec avec la baissedes seuils d'immigration, on observe la même logique utilitariste : celle d'un tri entre les vies, où certaines sont jugéesplus légitimes que d'autres. » Stephan Reichhold, Directeur général de la Table de concertation des organismes auservice des personnes réfugiées et immigrantes
https://tcri.qc.ca/>
(TCRI)."><https://tcri.qc.ca/> (TCRI).
« Nous désirons réaffirmer que les travailleuses et travailleurs migrant.es temporaires partagent solidairement lamême condition que l'ensemble de la force ouvrière du Québec : nous sommes tous et toutes des travailleurs,travailleuses qui avons des intérêts communs et des droits égaux. À cet égard, la FTQ réclame l'abolition des permisde travail nominatifs (fermés) liant les travailleuses et travailleurs migrant·e·s à un employeur unique et que lesgouvernements mettent en place sans délai des politiques d'immigration permettant l'obtention d'un statut permanent pour tous les travailleuses et travailleurs migrant·e·s. Il est temps de nous rappeler qu'au-delà des considérations purement économiques, ce sont aussi des parcours de vie dont il est question ici. » Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ<https:/ftq.qc.ca/>'><https://ftq.qc.ca/> Montréal métropolitain.
À propos
La Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante (CQRJM) regroupe 46 membres https://cqrjm.org/a-propos/>
."><https://cqrjm.org/a-propos/>
.
Parmi ses allié·e·s : Amnistie internationale francophone Canada, d'autres organisations du Front commun québécois contre C-12 et le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ).
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Zohran Mamdani : le miroir dans lequel le Canada devrait se regarder

La victoire de Zohran Mamdani à New York n'a pas seulement été un triomphe contre les républicains. Elle a surtout été une victoire contre l'establishment, y compris contre son propre Parti démocrate, qui en grande partie lui avait tourné le dos. Mamdani a gagné sans trahir ses principes, sans édulcorer son message, sans se soumettre aux grands donateurs.
Dans le contexte politique actuel, c'est déjà une révolution.
Sa victoire devrait rappeler —bien au-delà des frontières américaines— que dans la loterie électorale, l'argent ne fait pas tout. Comptent aussi l'enthousiasme, la capacité à le transmettre, la fermeté des convictions, la cohérence entre le discours et la pratique politique, et le courage de résister à la haine et aux pressions. Mamdani a réussi à faire passer les marges politiques au centre du débat, prouvant que la conviction et l'honnêteté peuvent encore vaincre la puissance économique et médiatique.
Le miroir canadien
Le Canada ferait bien de s'y regarder. Lors des dernières élections fédérales, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a perdu une grande partie de ce qu'il avait conquis lors des scrutins précédents, entraîné par le discours de la peur face à Donald Trump et par ce qu'on appelle ici le « vote stratégique », une logique qui a fini par placer Mark Carney au poste de premier ministre.
Moins d'un an plus tard, le nouveau gouvernement a présenté ce que l'on peut appeler sans exagération un budget de guerre. Parmi les mesures phares : une hausse de 62,7 milliards de dollars canadiens des dépenses militaires sur cinq ans, des engagements visant à atteindre —voire à dépasser— 2 % du PIB pour la défense, et une orientation claire vers les investissements en infrastructures et équipements militaires.
Dans un pays où tant de familles peinent à payer leur loyer, où les jeunes s'enlisent dans la précarité, et où l'accès à la santé et au logement devient un privilège, un tel budget ne peut être interprété que comme une déclaration de priorités : le capital avant l'humain, la guerre avant la justice sociale.
Le carrefour du NPD
Le NPD se trouve aujourd'hui face à une opportunité historique : s'opposer résolument à cette dérive belliciste et aux concessions faites à l'industrie de l'armement américaine. Mais pour y parvenir, il doit retrouver ses racines —celles des mouvements sociaux, de la rue, de la solidarité de base qui refuse la logique du profit et de la guerre.
S'il veut rester une force socialiste et transformatrice —à l'image de Mamdani, salué aujourd'hui par la gauche du monde entier—, le NPD doit s'interroger en profondeur sur son rôle actuel. Gérer l'administration ne suffit pas : il faut à nouveau parler d'égalité, de redistribution, de paix et de justice.
Certes, un budget national est un document complexe, truffé de chiffres techniques. Mais certaines données ne laissent place à aucun doute : quand les dépenses militaires explosent pendant que la santé, l'éducation et le logement stagnent, c'est qu'un pays se prépare à la guerre.
Nous y sommes déjà ?
Contre qui, et pourquoi ?
De qui devons-nous nous défendre ?
Et qui avons-nous offensé ?
Une bannière à relever
Un pays qui dépense plus pour les armes que pour les droits fondamentaux de sa population trahit son pacte social. Et si le NPD ne trouve pas le courage de le dire haut et fort, d'autres le feront. L'histoire donne toujours la parole à celles et ceux que les partis oublient d'écouter.
Aujourd'hui plus que jamais, le Canada a besoin que quelqu'un relève la bannière de la justice sociale, avec dignité, clarté et détermination. En ces temps où la gauche ne dispose pas des chiffres pour gouverner, la tâche urgente est de reconstruire le tissu social, d'unir les laissés-pour-compte, afin que demain une véritable majorité puisse se lever.
Personne sans toit. Personne affamé. Pas un dollar pour la guerre.
Manuel Tapial
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le déficit n’est pas un problème économique, c’est une arme politique

Le budget d'austérité tant attendu de Mark Carney a enfin été présenté au Parlement et devrait porter le déficit à 78 milliards de dollars. Si les détails du budget feront l'objet de débats au cours des prochaines semaines, le tableau d'ensemble montre que le premier ministre a tenu ses promesses : l'augmentation des dépenses en matière de défense et d'infrastructures est « compensée » par plus de 50 milliards de dollars de coupes budgétaires et d'autres économies.
5 novembre 2025
Depuis des mois, Carney prépare le terrain pour ces mesures, faisant des déclarations très médiatisées sur le prétendu problème de dépenses du Canada et promettant de discipliner les fonctionnaires afin de rétablir la santé financière. Ce genre de provocations sur le déficit avait toujours pour but de présenter ses politiques régressives comme la seule ligne de conduite « responsable ».
Cependant, avec ce budget il est difficile de prendre au sérieux les préoccupations de Carney concernant le déficit. Il reste déterminé à maintenir les échappatoires fiscales pour les milliardaires et à garantir que les rentiers de notre pays profitent du système. Après avoir aggravé le déficit avec ses propres politiques fiscales irresponsables au début de l'année, Carney veut utiliser le problème qu'il a lui-même contribué à créer pour justifier des coupes sombres dans presque tous les ministères fédéraux et la suppression progressive de programmes dont dépendent les Canadien·nes (les programmes de santé, d'environnement et de services aux Autochtones sont tous sur la sellette). Dans ce contexte, il est difficile de considérer ses lamentations sur les dépenses opérationnelles comme autre chose que de la mauvaise foi.
Malgré la nature manifestement conservatrice du budget, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s'est positionné pour riposter en agitant lui aussi la question du déficit. Il a passé des semaines à tenter d'obtenir une deuxième chance aux élections, affirmant que son parti pourrait ne pas appuyer un budget dont le déficit prévu dépasse 42 milliards de dollars. Le NPD étant également peu susceptible de voter en faveur du budget le 17 novembre, il pourrait revenir au Bloc québécois de décider si suffisamment de ses 18 revendications ont été satisfaites pour faire adopter le budget par le Parlement et éviter aux Canadien·nes de retourner aux urnes.
Lorsque le premier ministre lèvera les yeux au ciel devant les discours cyniques des conservateurs sur le déficit dans les jours à venir, nous devrions nous rappeler que les libéraux sont tout aussi habiles à tirer parti des déficits pour faire avancer leur programme politique et renforcer leur avantage politique.
L'hiver dernier, les libéraux ont mis en scène un drame élaboré autour du déficit. Tout a commencé avec la démission de Chrystia Freeland du cabinet, où elle a fait part de ses inquiétudes quant au fait que Trudeau donnait la priorité à des « gadgets politiques coûteux » plutôt qu'au « capital et à l'investissement ». Quelques jours plus tard, le gouvernement a annoncé une augmentation soudaine du déficit, soit 20 milliards de dollars, qui n'était pas due à de nouvelles dépenses, mais à l'ajout dans les comptes de « passifs éventuels » futurs, tels que les paiements anticipés pour les litiges à venir avec les Autochtones et les dépréciations des prêts accordés pendant la pandémie. Il n'y avait aucune obligation fiduciaire d'ajouter ces passifs au bilan, mais il y avait une forte obligation politique. La crise fabriquée de toutes pièces a fourni le prétexte nécessaire pour orchestrer le départ de Trudeau et lancer une course à la direction, permettant au parti de se refaire une image de marque en tant que parti « responsable » sur le plan financier.
Rétrospectivement, l'année écoulée a été marquée par de nombreux exemples très médiatisés de politicien·nes utilisant les déficits pour manipuler l'opinion publique. Il est tentant de croire que la panique théâtrale de nos politicien·nes indique un véritable problème dans les finances du Canada, mais le déficit réel est assez faible en termes macroéconomiques. Le Canada a réduit son déficit plus rapidement que les autres pays de l'OCDE après la flambée liée à la pandémie, et notre ratio dette/PIB est inférieur à la moyenne du G7 et représente moins de la moitié de celui du Japon. La dette publique nette du Canada est également la plus faible du G7.
À l'échelle mondiale, la dette publique du Canada est modeste et loin d'être alarmante. Nous n'avons tout simplement pas le type de dette susceptible de déstabiliser l'économie nationale. Les dettes écrasantes qui érodent la souveraineté et obligent les nations à mettre en place des programmes d'ajustement structurel présentent deux caractéristiques clés : elles sont détenues à l'étranger et libellées dans une devise étrangère que le gouvernement emprunteur ne contrôle pas. Le Canada n'est confronté à aucun de ces problèmes. La majorité de notre dette est une dette que nous avons envers nous-mêmes. Par ailleurs, les dettes que nous avons envers les investisseurs étrangers sont principalement des obligations libellées en dollars canadiens. En tant que nation souveraine sur le plan monétaire qui emprunte presque exclusivement dans sa propre devise, le risque de défaut involontaire est négligeable.
Le partenariat entre le gouvernement fédéral et la Banque du Canada garantit cette stabilité. La banque centrale fixe non seulement les taux d'intérêt, mais peut également acheter directement des obligations fédérales, ce qui lui permet d'agir en tant qu'acheteur de dernier recours et de garantir que la liquidité ne devienne jamais un frein aux dépenses publiques. Cette capacité distingue le Canada des gouvernements infranationaux, tels que les provinces ou les membres de la zone euro, qui peuvent véritablement « se retrouver à court d'argent ».
Toute évaluation lucide des risques posés par la situation financière du Canada indique que les déficits ne sont tout simplement pas le feu de cinquième alerte qu'on prétend qu'ils sont. Les déficits relativement mineurs du Canada pourraient être résolus dès demain grâce à une réforme fiscale réaliste. En comblant les lacunes et en instaurant une certaine équité de base dans le code fiscal, le gouvernement actuel pourrait bénéficier d'excédents, même si notre économie est assiégée par Donald Trump. Un « budget alternatif » publié par le Centre canadien de politiques alternatives montre qu'un système fiscal rationalisé pourrait ajouter près de 100 milliards de dollars par an au budget fédéral.
La théorie monétaire moderne (MMT) adopte une position encore plus audacieuse, affirmant que les déficits libellés en monnaies souveraines ne présentent aucun risque pour la solvabilité nationale. La MMT postule que les dépenses déficitaires ne deviennent un problème que lorsque l'argent injecté dans l'économie augmente la demande de biens et de main-d'œuvre au-delà de ce que l'économie peut physiquement supporter. Vu sous cet angle, les dépenses déficitaires ne deviennent problématiques que lorsqu'elles entraînent de l'inflation. Un budget MMT prévoirait que les dépenses de fonctionnement et d'investissement soient financées par la Banque du Canada, ce qui est exactement la raison pour laquelle elle a été créée. En fait, des années 1930 aux années 1970, la Banque du Canada a régulièrement créé du crédit pour des investissements publics – de la route transcanadienne aux programmes de logement d'après-guerre – sans déclencher d'inflation galopante ni compromettre la stabilité budgétaire.
Que vous trouviez la MMT convaincante ou non, il est incontestable que le déficit du Canada ne menace pas la stabilité économique. En tant que problème financier, il est tout à fait soluble. Cependant, en tant qu'instrument rhétorique, il est assez dangereux. La fonction première du déficit est politique : c'est un bâton utilisé pour imposer des politiques impopulaires et contraindre le public à accepter une baisse de sa qualité de vie au nom du profit privé. Nous devons cesser de confondre cette stratégie politique avec une nécessité économique.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le système d’immigration canadien est perdu dans les broussailles

L'ancien premier ministre canadien Pierre Elliot Trudeau a annoncé le multiculturalisme comme politique officielle du gouvernement le 8 octobre 1971, cette annonce ayant contribué à encourager l'immigration en provenance de pays non européens.
https://rabble.ca/politics/canadian-politics/canadas-immigration-system-is-lost-in-the-bushes/
4 novembre 2025
Depuis lors, nous avons assisté à de nombreux changements et améliorations dans la politique d'immigration canadienne, tels que l'introduction d'un système à points pour sélectionner les immigrant·es en fonction de leurs compétences et de leur niveau d'éducation et la codification d'objectifs humanitaires comme l'établissement des réfugié·es. Les changements récents apportés au cours des dernières années ont créé une certaine confusion et incertitude dans le système d'immigration. Après avoir constaté les déceptions de ces dernières années, dues à une perte d'opportunités, nous devons fixer des objectifs à long terme afin d'atteindre avec succès les objectifs nationaux de développement.
Le 24 octobre 2024, Marc Miller, ancien ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé le plan des niveaux d'immigration 2025-2027. En raison de la situation du logement, de l'accessibilité financière et du marché du travail, le gouvernement fédéral a pris cette mesure afin de réduire le quota annuel de résident·es permanent·es de 485 000 à 396 000 et la population de résident·es temporaires de 2,96 millions à 2,52 millions en 2025. Près de 1 262 800 résident·es temporaires devront quitter le pays l'année prochaine pour maintenir ce niveau.
Ces changements ont été annoncés dans le but d'attirer les meilleur·es et les plus brillant·es, avec des objectifs économiques à long terme, ce qui aurait un effet positif sur l'économie et la croissance.
Dans un sondage réalisé en 2023 par l'Environics Institute, basé à Toronto, 44 % des Canadien·nes estimaient que l'immigration au Canada était trop importante, contre 27 % l'année précédente. Et aujourd'hui, pour la première fois en plus d'un quart de siècle, une nette majorité de Canadien·nes ont exprimé leur mécontentement face à l'augmentation du nombre d'immigrant·es. Ce n'est pas la faute de celleux qui viennent ici pour chercher de meilleures opportunités, c'est notre incapacité à répondre aux attentes de l'État et des immigrant·es potentiel·les qui serait en cause.
Lors d'une récente discussion au sommet politique Canada 2020 Future Forward à Ottawa, le 23 septembre 2025, deux anciens ministres de l'Immigration, Marc Miller et Jason Kenney, l'un libéral, l'autre conservateur, se sont accordés sur les lacunes du système d'immigration canadien. Les deux anciens ministres ont déclaré que le Canada devait maintenir l'immigration au cœur de sa stratégie économique. Mais ils ont également tous deux déclaré que le Canada devait prendre des mesures importantes pour réformer le système avant que la confiance du public ne s'effrite davantage.
Le gouvernement souhaitait accueillir des étudiantes et étudiants étrangers dans les universités canadiennes afin de les aider à obtenir une meilleure éducation et d'aider ces établissements à gagner des millions de dollars chaque année. Mais un rapport publié en novembre 2024 indique que plus de 10 000 lettres d'acceptation d'étudiant·es étrangers provenant de collèges et d'universités canadiennes ont été signalées comme potentiellement frauduleuses par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, a déclaré à l'époque que le premier ministre Justin Trudeau et son ancien ministre de l'Immigration, Sean Fraser, avaient créé le problème en délivrant un million de visas étudiants sans se soucier des conséquences que cela aurait pour le pays.
De plus, ils ont fermé les yeux sur les fraudes et les abus manifestes commis dans le cadre du Programme des étudiants étrangers. Plus tard, ils ont écrit au Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, l'organisme qui délivre les licences aux consultant·es qui auraient attiré bon nombre de ces étudiants étrangers, pour leur demander de régler le problème.
Le gouvernement doit reconnaître son échec dans la gestion d'un système d'immigration efficace.
Selon un rapport publié par Emploi et Développement social Canada, le programme des travailleurs étrangers temporaires (TET) a connu une forte augmentation de la demande en raison de la conjoncture économique post-pandémique, des faibles taux de chômage et des taux de vacance d'emploi record en 2022. Pour remédier à ces pénuries de main-d'œuvre, le programme a adopté une série de changements politiques. Mais en mars 2024, Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé que certaines mesures temporaires prévues dans la feuille de route du programme des TET ne seraient pas renouvelées et que le gouvernement renverrait 1,2 million de travailleuse et travailleurs temporaires dans leur pays.
L'évolution des voies d'immigration, les défis économiques et la mauvaise planification sont à l'origine de cette situation.
Un récent rapport de Statistique Canada, cité dans le Toronto Star, révèle que les immigrant·es qualifié·es quittent le Canada en nombre record, près de 48 % d'entre elleux le faisant dans les sept ans suivant leur arrivée. Les plaintes les plus courantes concernent les bas salaires, le coût élevé de la vie et le logement inabordable. Nos meilleur·es diplômé·es universitaires sont attiré·es par les États-Unis. Pourquoi investissons-nous dans l'accueil d'immigrantes et d"immigrants talentueux, dans leur éducation et leur formation, pour finalement les perdre au profit des États-Unis ?
Je pose ces questions depuis 26 ans, depuis que je suis arrivé dans ce pays d'opportunités avec une maîtrise en chimie et que j'ai commencé à travailler dans une station-service. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de changements pour les immigrant·es ordinaires.
La grande question demeure : quels sont les buts et les objectifs de nos politiques d'immigration sans cesse révisées ? Pouvons-nous espérer des changements significatifs alors que notre gouvernement fédéral fonctionne de manière ponctuelle ?
Les solutions provisoires ne fonctionneront pas ici. Nous avons besoin d'une nouvelle politique d'immigration stable, fondée sur les besoins réels du Canada. Elle devrait également garantir l'intégrité du système d'immigration afin de pouvoir corriger les irrégularités actuelles.
Dans son article de recherche récemment publié, Lisa Brunner, de l'Université de Colombie-Britannique, recommande :
§ De rendre les voies d'immigration pour les étudiant·es claires et prévisibles.
§ D'investir dans le secteur public afin de réduire la dépendance des établissements envers les frais de scolarité internationaux.
§ De mettre en place des services d'établissement universellement accessibles avec une responsabilité partagée.
§ De renforcer la réglementation et la transparence dans les pratiques de recrutement.
En rééquilibrant le paysage politique vers la durabilité et la responsabilité éthique, le Canada peut également mieux soutenir les étudiantes et les étudiants étrangers tout en protégeant sa réputation mondiale et sa résilience économique, a-t-elle ajouté.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada doit cesser ses exportations d’armes vers les Émirats arabes unis et mettre fin à son soutien au génocide au Soudan.

Montréal, le 30 octobre 2025 — Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) exhorte le Canada à suspendre ses exportations d'équipements militaires vers les Émirats arabes unis, craignant que ces derniers ne détournent les armes canadiennes vers les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire soudanaise.
Les Émirats arabes unis, destination de millions de dollars d'armes canadiennes, sont connus pour armer illicitement les RSF, accusées de génocide. De plus, il a été découvert que des armes canadiennes liées aux Émirats arabes unis étaient utilisées par les RSF, notamment à El Fasher, où elles ont récemment massacré plus de 2 000 personnes. CJPMO demande instamment la suspension immédiate des exportations militaires vers les Émirats arabes unis et l'ouverture d'une enquête pour déterminer si les armes canadiennes alimentent le génocide au Soudan.
« Le Canada continue de vendre des armes aux Émirats arabes unis malgré leur rôle évident de facilitateur du génocide au Soudan », a déclaré Michael Bueckert, président par intérim de CJPMO. « La découverte de véhicules blindés canadiens entre les mains de la RSF à El Fasher, quelques mois seulement avant le dernier massacre, devrait alerter le gouvernement et l'inciter à prendre des mesures immédiates. Le Canada doit mettre fin à l'acheminement d'armes vers les Émirats arabes unis, y compris via les États-Unis », a ajouté M. Bueckert.
Les experts de l'ONU ont à plusieurs reprises mis en garde contre le fait qu'ils soupçonnent les Émirats arabes unis de fournir clandestinement des armes à la RSF via les pays voisins, estimant que les accusations de soutien militaire des Émirats arabes unis à la RSF sont crédibles. Plus récemment, les Émirats arabes unis auraient augmenté leurs livraisons d'armes à la RSF, notamment de drones. De plus, il a récemment été révélé que certaines des armes transférées à la RSF par les Émirats arabes unis avaient été fabriquées au Royaume-Uni, ce qui soulève la possibilité que les Émirats arabes unis puissent également faire passer clandestinement des équipements militaires provenant d'autres pays, tels que le Canada.
L'année dernière, le Canadaa exporté pour 7 millions de dollars canadiens d'armes vers les Émirats arabes unis, notamment dans la catégorie des avions militaires. En août dernier, le Globe and Mail a rapporté que des véhicules blindés produits par le groupe canadien Streit avaient été trouvés entre les mains des RSF lors du siège d'El Fasher. L'usine principale du groupe Streit est située aux Émirats arabes unis, et celui-ci a déjà vendu illicitement des armes au Soudan et à d'autres pays sanctionnés par le Canada.
Le détournement des exportations canadiennes est interdit par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation du Canada. En 2020, le Canada a imposé un embargo sur les exportations militaires vers la Turquie afin d'enquêter sur le détournement de la technologie des drones militaires vers l'Azerbaïdjan. Malheureusement, le Canada a levé ces restrictions en 2024 malgré le risque persistant, privilégiant les objectifs politiques aux préoccupations en matière de droits de la personne.
CJPMO s'inquiète également du fait que des armes pourraient parvenir aux Émirats arabes unis (et finalement au Soudan) via la faille américaine, qui permet d'exporter des biens militaires vers les États-Unis sans réglementation ni déclaration, avant de les envoyer aux Émirats arabes unis. Au début de l'année, les États-Unis ont annoncé plus de 200 milliards de dollars américains de contrats d'armement avec les Émirats arabes unis. CJPMO exhorte le Parlement à remédier à ce problème en adoptant le projet de loi C-233, la « No More Loopholes Act », qui garantirait que tout commerce militaire via les États-Unis soit soumis à une surveillance appropriée.
CJPMO exhorte le gouvernement canadien à suspendre toutes les exportations d'armes vers les Émirats arabes unis et à enquêter sur le détournement d'armes canadiennes vers les RSF ; à combler la faille américaine afin de garantir que les équipements militaires ne soient pas transférés vers les Émirats arabes unis sans réglementation ni déclaration via les États-Unis ; et à enquêter sur le groupe Streit pour avoir prétendument contourné les sanctions canadiennes contre le Soudan.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réactions des organisations des classes populaires au dépôt du budget fédéral

Voici les réactions d'organisations issues des classes populaires à la suite du dépôt du budget du gouvernement de Mark Carney par le ministre de finances François-Philippe Champagne. Les communiquées sont mis en ligne au fur et à mesure de leur publication.
Le budget fédéral 2025 creuse les inégalités, estime Oxfam-Québec
Montréal, le 5 novembre 2025 — Oxfam-Québec déplore la décision du gouvernement fédéral de sabrer 2,7 milliards $ dans l'aide publique au développement, au moment où les crises mondiales s'intensifient. Face aux conflits, aux dérèglements climatiques et à la montée des régimes autoritaires, le Canada choisit de désinvestir plutôt que de renforcer sa solidarité, tournant le dos aux populations les plus vulnérables. Oxfam-Québec est notamment préoccupée par les compressions dans le financement de la santé mondiale, qui risquent de mettre en péril les droits et la santé des femmes et des filles.
« Ce budget vise à réformer et à relancer l'économie, ce qui est nécessaire. Mais que vaut une relance qui aggrave les inégalités ? Près de 3 milliards $ de moins pour l'aide internationale, aucune initiative pour corriger l'iniquité fiscale et récupérer des revenus auprès des ultrariches et des entreprises polluantes, et trop peu pour les secteurs à prédominance féminine. Nous avons besoin d'une économie qui ne laisse personne de côté. Lutter contre les inégalités, c'est renforcer la stabilité, la démocratie et la prospérité au Canada comme ailleurs, pour tout le monde », souligne Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Oxfam-Québec.
Sur le plan climatique, l'absence de tout sentiment d'urgence est consternante. Le gouvernement recule encore sur la mise en place de ses engagements sur la finance durable dans sa stratégie de compétitivité climatique, qui mise davantage sur la compétitivité que sur la réduction réelle des émissions. La stratégie privilégie la création de marchés et la mobilisation de capitaux privés plutôt que des mesures concrètes : imposer davantage les profits des entreprises polluantes, cesser de subventionner l'industrie des énergies fossiles et légiférer pour que les banques canadiennes réduisent leurs émissions de GES.
Le budget ignore aussi l'importance de l'économie du soin et des secteurs à prédominance féminine, piliers de la résilience sociale et climatique. Santé, éducation, services de garde et soins aux personnes âgées sont essentiels pour le bien-être des populations et leur capacité à faire face aux crises. Pourtant, 115 milliards $ sont consacrés aux infrastructures et 30 milliards $ à la défense sur cinq ans, tandis que les services vitaux à la population restent sans investissement chiffré comparable.
Le budget ne propose aucune mesure pour réduire l'iniquité fiscale. Les ultrariches, qui ont vu leur fortune croître de plus de 51% depuis 2020, ne paient en moyenne que 24% d'impôt, contre 37% pour la moyenne des travailleurs. En effet, 100% du salaire est taxé, contre seulement 50% des gains en capital. Le gouvernement renonce ainsi à des revenus indispensables pour financer la transition écologique et renforcer les services publics.
Pour Oxfam-Québec, le premier budget du gouvernement Carney est une occasion manquée de corriger les inégalités et de construire un « Canada fort », juste et durable.
Don Davies, porte-parole du NPD en matière de finances, réagit au budget de l'automne 2025
En réaction au budget de l'automne 2025 présenté par le gouvernement, Don Davies, porte-parole du NPD en matière de finances, a fait la déclaration suivante :
« Le Canada est confronté à de graves défis économiques. Le chômage atteint son plus haut niveau depuis dix ans, les jeunes ayant particulièrement du mal à trouver un emploi. La moitié des Canadiens vivent au jour le jour. Le coût des produits de nécessité, qu'il s'agisse de nourrir votre famille ou de payer votre loyer, ne cesse d'augmenter. Et notre économie est au bord de la récession, le président américain Donald Trump étant déterminé à lui faire subir de nouveaux dommages.
Dans ce contexte, ce budget est crucial et arrive à un moment critique pour notre pays.
Les néo-démocrates comprennent que nous avons été envoyés à Ottawa pour travailler au nom des travailleurs et de leurs familles. Nous avons dit que les Canadiens ont besoin d'un budget qui investira dans la création d'emplois syndiqués de qualité, permettant de subvenir aux besoins d'une famille ; nous avons dit que les Canadiens ont besoin d'un budget qui aidera à construire des millions de nouveaux logements abordables ; nous avons dit que les Canadiens ont besoin d'un budget qui investit dans les programmes et les services dont dépendent les familles, notamment notre système de santé.
Et nous avons dit qu'il est de la responsabilité du premier ministre Mark Carney d'élaborer un budget qui investit dans les besoins des Canadiens et qui peut être adopté à la Chambre des communes. S'il n'est pas en mesure de le faire, il en assume l'entière responsabilité.
À première vue, il semble que ce budget contienne des mesures que nous saluons et que nous avons d'ailleurs revendiquées. Il s'agit notamment de mesures visant à fournir un financement supplémentaire pour les infrastructures liées aux emplois syndiqués, à prendre un engagement explicite en faveur des logements coopératifs et à faire référence à un réseau électrique est-ouest.
Malheureusement, certaines mesures nous semblent aller dans la mauvaise direction, notamment la réduction des travailleurs du secteur public et des services qu'ils fournissent aux Canadiens, la suppression de la taxe sur les logements inoccupés et la réaffirmation de la subvention de plusieurs milliards de dollars accordée par le gouvernement aux géants technologiques américains.
Les néo-démocrates prendront le temps d'étudier le budget et de discuter avec les Canadiens. Nous aurons davantage à dire à ce sujet dans les prochains jours. »
Réaction de Greenpeace Canada au Budget 2025
« C'est un budget qui dépense massivement sur la militarisation du pays. On dépense des milliards pour les frontières, la police et l'armée, pendant qu'on coupe dans les programmes qui aident les personnes et protègent la nature. On ne peut pas dire qu'on prépare l'avenir si on recule sur le climat, en laissant les compagnies pétrolières polluer davantage et en affaiblissant les lois contre l'écoblanchiment. »
– Keith Stewart, stratège sénior en énergie, Greenpeace Canada
Le budget met surtout l'accent sur la sécurité, les frontières et l'armée, plutôt que sur des investissements qui soutiennent les personnes et protègent l'environnement.
Le gouvernement recule sur l'action climatique. Il renonce à sa promesse d'imposer un plafond à la pollution des compagnies pétrolières et gazières et affaiblit les lois contre les fausses déclarations environnementales. Cela s'ajoute à l'abolition de la taxe carbone pour les consommateurs, à la pause des règles sur les véhicules électriques et à une nouvelle loi qui permet d'exempter certains projets, même liés au pétrole et au gaz, des lois environnementales, sous prétexte qu'ils seraient d'intérêt national.
Au lieu d'investir dans des solutions pour protéger la population contre les effets des changements climatiques, le gouvernement continue de miser sur le pétrole. Le budget accorde de nouveaux appuis au gaz naturel liquéfié et au captage du carbone, sans engagement réel pour atteindre les réductions d'émissions que le Canada a promises dans le cadre de l'Accord de Paris.
Le Budget 2025 est présenté comme une « action audacieuse pour assurer l'avenir du Canada ». En réalité, assurer notre avenir aujourd'hui veut dire sortir des combustibles fossiles qui aggravent la crise climatique et miser sur les énergies renouvelables pour bâtir un futur plus vert et plus prospère. D'un océan à l'autre, les Canadien·nes vivent déjà les impacts dévastateurs du climat : feux de forêt, inondations, vagues de chaleur, tempêtes violentes.
Pendant sa campagne, Carney avait promis de protéger l'eau, la nature et la biodiversité en travaillant main dans la main avec les peuples autochtones. Pourtant, dans ce budget, aucune mention de l'engagement du Canada à protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030. Ni les droits autochtones ni la protection de la nature ne sont pris au sérieux, alors que ce sont des éléments essentiels pour préserver la biodiversité pour les générations futures.
« À qui profite ce budget ? Certainement pas aux générations futures, ni aux terres, à l'eau et aux communautés qui nous font vivre. On ne peut pas parler d'avenir sans placer les droits autochtones et la réconciliation au cœur des décisions. Ce budget montre une vision à court terme qui met de côté les gens et la nature. Carney avait promis une alternative au discours de peur des conservateurs, mais avec ce budget, il leur ressemble plus que jamais, en misant lui aussi sur la peur plutôt que sur un avenir juste et durable. »
Budget fédéral : « Face à Trump, Carney choisit l'inaction » (CNC)
Montréal, le 4 novembre 2025 – Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) exprime sa déception quant au dépôt du budget fédéral.
« Sur la question de l'assurance-emploi, on est loin d'être à la hauteur de la situation. Alors qu'il y a une situation d'instabilité très grave avec la guerre commerciale avec les États-Unis et que les pertes d'emplois s'accumulent, le gouvernement de Mark Carney préfère l'inaction. C'est insensé ! », ont déclaré Milan Bernard et Selma Lavoie, co-porte-paroles du Conseil national des chômeurs et chômeuses. « Nous espérions que Mark Carney et son cabinet saisissent la gravité de la situation actuelle et la fragilité de l'économie canadienne, et agissent ainsi en conséquence, mais ce n'est pas le cas ».
La seule avancée sur la question de l'assurance-emploi est l'élargissement des prestations parentales de l'assurance-emploi aux parents advenant le décès de leur enfant. Une mesure similaire est déjà appliquée au Québec, via le RQAP.
Le CNC est également inquiet quant à la rhétorique austéritaire mise de l'avant par le Premier ministre, et les reculs annoncés sur les positions environnementales de son prédécesseur.
« Dans ce contexte, nous allons continuer d'analyser la situation pour proposer une voie alternative au gouvernement. Ne rien faire n'est pas une option », ont conclu Milan Bernard et Selma Lavoie.
Budget fédéral : le gouvernement met la hache dans les services publics et brime le droit à la négociation collective (AFPC)
Ottawa, 5 novembre 2025 — L'Alliance de la Fonction publique du Canada est très préoccupée par les coupes massives dans les services publics, la mise à pied de plus de 40 000 fonctionnaires fédéraux et l'atteinte au droit à la négociation collective de centaines de milliers de travailleuses et travailleurs que propose le gouvernement.
Malgré les besoins d'une population âgée sans cesse croissante, le gouvernement éliminera des programmes vitaux au cours des trois prochaines années et tassera les fonctionnaires pour faire de la place à l'IA. C'est ce que prévoit l'Examen exhaustif des dépenses entrepris par le gouvernement.
« Ces coupes massives dans les services publics se feront sur le dos des travailleuses et travailleurs, des familles et des collectivités du pays », déplore la présidente nationale de l'AFPC, Sharon DeSousa. « Les gens peuvent s'attendre à des attentes interminables pour un passeport, de l'assurance-emploi ou une allocation pour enfants. À moins de programmes sociaux et encore plus de difficulté à joindre l'Agence du revenu. À peu de ressources consacrées à la santé publique et à l'inspection des aliments. Bref, un gouvernement absent lorsque les gens en ont le plus besoin. »
Au lieu d'investir dans les services de première ligne et les fonctionnaires qui assurent la bonne marche du pays, le gouvernement mise sur l'abolition de postes et l'IA, au détriment de notre filet social.
L'AFPC fera tout en son pouvoir pour protéger les services publics et les gens qui les fournissent en s'assurant que le gouvernement respecte les droits prévus dans les conventions collectives et les lois du travail en vigueur.
« Le premier ministre Carney répète qu'on doit faire des sacrifices, mais à qui impose-t-il réellement des sacrifices dans son budget ?, demande Sharon DeSousa. Certainement pas aux grandes multinationales. Ni aux PDG et riches banquiers. C'est encore aux travailleuses et travailleurs qu'on demande de plier l'échine. »
La négociation collective menacée
La décision de changer unilatéralement les lois qui régissent la fonction publique fédérale nous inquiète tout autant et nous examinerons attentivement les changements législatifs mis de l'avant par le gouvernement.
« Encore une fois, le gouvernement s'en prend directement au droit à la négociation collective. Soyons clairs : les travailleuses et travailleurs ont dû se battre pour en arriver là et on ne laissera pas le gouvernement nous enlever ces acquis comme si de rien n'était. »
Équité pour le personnel de première ligne
Nous sommes heureux de constater que le budget prévoit un régime de retraite équitable pour les membres des forces de l'ordre et de la sécurité publique, qui pourront enfin prendre leur retraite dans la dignité après 25 années de service, sans pénalité. Il y avait longtemps que nous réclamions ce changement.
Des baisses d'impôts qui plombent le premier budget Carney (CSN)
C'est avec beaucoup de réserve que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) accueille le premier budget du gouvernement Carney. La centrale syndicale salue d'une part l'accroissement de l'investissement public en réponse à la guerre commerciale qui ébranle l'économie canadienne. Elle considère néanmoins que certains choix budgétaires, tels que des baisses d'impôts et une augmentation démesurée du budget alloué à la défense, minent la capacité du gouvernement à appuyer des secteurs stratégiques et à améliorer les conditions de vie de la population.
Si certains programmes fédéraux comme Maisons Canada ou l'appui à l'industrie du bois ou de l'acier ont toute leur raison d'être, la CSN déplore que le gouvernement se prive de revenus importants en abaissant d'un point le premier palier d'impôt sur le revenu des particuliers et en faisant une croix sur la hausse d'imposition sur les gains en capital, tout en abandonnant la taxe sur les services numériques. Au total, ces trois mesures auraient renfloué les coffres publics d'environ 10 milliards par année, selon les chiffres publiés par le Directeur parlementaire du budget. Et ce, sans compter les 300 millions en réduction fiscale additionnelle accordée aux entreprises par l'entremise de la superdéduction à la productivité.
Des compressions injustifiées
« À la lumière de l'ampleur de ce manque à gagner, les compressions demandées aux ministères et aux organismes publics – de 15 % sur trois ans – nous apparaissent totalement injustifiées », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.
La dirigeante syndicale pointe en particulier les compressions apportées au financement de Services correctionnels Canada. « Ces coupes ne peuvent qu'exacerber une situation déjà tendue dans les pénitenciers fédéraux, aux prises avec un problème de surpopulation et de manque d'effectifs », fait-elle remarquer.
La CSN se réjouit toutefois que Radio-Canada ait été épargnée par les mesures d'austérité du gouvernement Carney : son budget sera bonifié de 150 M$ cette année.
Alors que les transferts fédéraux en matière de formation de la main-d'œuvre sont augmentés dans le présent budget, la CSN rappelle qu'ils ne compensent toujours pas les coupes effectuées l'an dernier. « De nombreux travailleurs et travailleurs subissent déjà les effets de cette guerre commerciale. Plusieurs d'entre eux auront besoin d'appui pour se réorienter professionnellement. Le minimum aurait été de compenser entièrement ces compressions budgétaires en matière de formation de la main-d'œuvre », soutient Caroline Senneville.
Dans un tel contexte d'incertitude, la bonification du programme d'assurance-emploi aurait été des plus pertinentes : pourtant, si certaines mesures ont été prolongées, le gouvernement Carney continue d'ignorer la réalité des travailleuses et travailleurs saisonniers, particulièrement dans le secteur forestier.
Enfin, la CSN déplore que, sans objectifs précis, la nouvelle stratégie de compétitivité climatique du Canada ne fasse qu'accroître l'incertitude quant à l'atteinte de cibles de réduction d'émission de gaz à effet de serre. « Les impacts du réchauffement climatique sont déjà ressentis par la population canadienne. La guerre commerciale actuelle ne peut servir de prétexte pour renoncer aux balises environnementales dont le Canada s'est doté », de conclure la présidente de la CSN.
Budget fédéral 2025-2026 - L'UDA salue des investissements essentiels pour la culture
MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 - L'Union des artistes (UDA) accueille favorablement les mesures annoncées par le gouvernement fédéral dans le budget 2025-2026. Les investissements sont bienvenus dans un contexte où des coupures étaient redoutées. Ces gestes témoignent d'une volonté de préserver la vitalité culturelle et de soutenir les artistes et les créateur•trice•s, malgré un environnement économique et géopolitique incertain.
Protéger notre souveraineté culturelle doit être une priorité gouvernementale. Elle s'incarne par la protection de nos langues officielles dont le français et par le soutien aux expressions culturelles comme on le constate dans le budget. Notre meilleure défense est la protection de notre identifé collective. Le gouvernement confirme son engagement à renforcer les expériences culturelles locales et à investir dans les industries créatives. Ces initiatives contribueront, nous l'espérons, à la découvrabilité des œuvres canadiennes et québécoises et à la diversité culturelle. En ce sens, nous réitérons notre confiance en Steven Guilbault, ministre du Patrimoine, et espérons qu'il continuera à défendre la culture avec détermination.
Le gouvernement a également annoncé son intention de modifier la Loi sur le droit d'auteur afin d'instituer un droit de suite pour les artistes visuels. L'UDA invite le gouvernement à profiter de cette modification pour moderniser l'ensemble de la Loi, en tenant compte des nouveaux enjeux liés à la diffusion numérique et à l'intelligence artificielle. Il est impératif que les technologies émergentes ne contournent pas les droits d'auteur et que les artistes bénéficient d'une rémunération juste lorsqu'il y a une utilisation de leurs œuvres.
Un enjeu crucial demeure : le filet social des artistes
Malgré ces importants progrès, le budget ne prévoit pas de mesures concrètes pour adapter le régime d'assurance-emploi à la réalité des artistes travailleurs autonomes. Cette réforme est essentielle pour offrir un véritable filet social à des milliers d'artistes interprètes dont la carrière repose sur des contrats ponctuels et une grande précarité. Nous espérons que le gouvernement, dans le cadre des travaux en cours sur la modernisation de l'assurance-emploi, intégrera des dispositions spécifiques pour les artistes. Une telle initiative serait un pas décisif vers une meilleure équité et une reconnaissance des particularités du secteur culturel.
« Nos membres vivent une réalité professionnelle marquée par l'instabilité et l'absence de filet social. Nous espérons que la modernisation de l'assurance-emploi inclura enfin des mesures adaptées à leur situation. Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme la création et la diffusion, il est plus que jamais nécessaire de protéger les droits des artistes et de garantir des conditions de travail dignes. » souligne Tania Kontoyanni, présidente de l'UDA.
L'UDA réitère son engagement à collaborer avec le gouvernement pour bâtir un cadre qui soutienne à la fois la création, la diffusion et la sécurité socio-économique des artistes, tout en assurant la défense de leurs droits dans l'ère numérique.
SOURCE Union des artistes
Budget 2025 : Unifor salue les gains pour les travailleuses et travailleurs, mais réclame une riposte pour protéger les emplois au Canada
OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 - Unifor affirme que les investissements majeurs en capital en matière d'approvisionnement, d'infrastructures et le logement sont des progrès appréciables prévus dans le budget 2025, mais que ces mesures doivent se traduire par des emplois au Canada, une production canadienne et du contenu canadien soutenus par de solides stratégies industrielles sectorielles.
« Pour créer une économie résiliente, les engagements prévus dans le budget fédéral doivent se traduire par de bons emplois syndiqués pour les travailleuses et travailleurs canadiens, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les tarifs douaniers représentent une menace existentielle et le Canada doit répondre aux attaques afin de protéger les familles des travailleuses et travailleurs tout comme les industries. »
Unifor salue l'engagement du gouvernement dans les secteurs clés comme la foresterie, notamment la somme de 13 milliards de dollars octroyée au programme de logements faits au Canada « Maisons Canada », qui est associé à une stratégie fédérale d'achats canadiens pour les matériaux de bois d'œuvre. Le budget prévoit aussi des investissements dans une stratégie moderne de défense industrielle qui doit obligatoirement dynamiser le développement de l'industrie manufacturière intérieure, y compris dans le secteur de l'aérospatiale.
« Le budget 2025 comprend des annonces qui pourraient stimuler la fabrication, notamment dans nos secteurs de l'aérospatiale et de la foresterie, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Cependant, le gouvernement doit tenir ses promesses et mettre en place des stratégies permettant de protéger les travailleuses et travailleurs des répercussions des tarifs douaniers américains. »
Unifor réitère que le Canada a besoin de stratégies industrielles globales pour soutenir et développer tous les secteurs affectés par les tarifs douaniers, et le syndicat réclame le déploiement dynamique et efficace du Fonds de réponse stratégique de 5 milliards de dollars afin de protéger les emplois industriels.
Le budget prévoit des améliorations spéciales au régime d'assurance-emploi ainsi que des flexibilités de travail partagé pour les travailleuses et travailleurs affectés par les tarifs douaniers. Unifor considère que ces mesures temporaires importantes devraient devenir permanentes dans le cadre d'une réforme élargie du régime d'assurance-emploi.
Les nouvelles dépenses en capital, notamment le montant de 115 milliards de dollars sur cinq ans destiné aux infrastructures dans certains secteurs comme le transport en commun, les soins de santé et le logement, doivent appuyer la création d'emplois au Canada par le biais de règles régissant le contenu intérieur.
La mise en œuvre d'une réglementation sur le gaz méthane réclamée par Unifor doit faire en sorte que les canalisations vieillissantes soient réparées et créer de nouveaux emplois syndiqués. Nous constatons toutefois l'absence dans ce budget 2025 d'engagements concrets visant à renforcer les liens ferroviaires pour le transport énergétique de l'Ouest vers l'Est, y compris l'expédition de produits au moyen de wagons-réservoirs faits au Canada, comme l'a recommandé Unifor.
« Malheureusement, ce budget porte également un dur coup aux services publics essentiels, a ajouté Mme Payne. L'austérité et la privatisation, notamment les menaces persistantes de vente de sociétés publiques et d'aéroports, ne sont pas des approches judicieuses, en particulier en temps de crise. Des services publics forts permettent de faire travailler les gens et de maintenir notre économie à flot. »
Le temps est venu de tirer profit des ressources, des compétences et de la capacité d'innovation du Canada afin de propulser une économie autosuffisante misant sur les produits faits au Canada.
SOURCE Le Syndicat Unifor
Les coupes budgétaires fédérales risquent d'avoir des conséquences réelles pour la population, comme le ralentissement du versement des prestations ou l'affaiblissement des interventions d'urgence (IPFPC)
OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 - L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) prévient que les coupes budgétaires fédérales annoncées aujourd'hui, qui visent à supprimer plus de 40 000 emplois dans la fonction publique, vont bien au-delà de l'« efficacité » et toucheront des services essentiels sur lesquels compte la population.
Les gens veulent que leur gouvernement dépense judicieusement, et les professionnel•les de la fonction publique sont d'accord. Mais si l'on élimine les fonctionnaires chargés d'inspecter les aliments, de distribuer les prestations sociales, de protéger les données et de surveiller les feux de forêt, on ne réduit pas le gaspillage — on augmente les risques.
« Les Canadiennes et les Canadiens attendent de l'efficacité, pas de l'érosion », déclare Sean O'Reilly, président de l'Institut. « Derrière chaque coupe se cache un retard de service, une intervention d'urgence plus lente ou un système qui n'est qu'à une défaillance de la crise. Ces réductions ne nous permettent pas de nous alléger ; elles nous rendent plus fragiles. »
Les professionnel•les de la fonction publique sont les spécialistes qui protègent nos données, gèrent les situations d'urgence, suivent les épidémies et entretiennent les systèmes que les gens voient rarement, mais dont ils dépendent tous les jours. La diminution de leur capacité n'entraîne pas seulement une réduction de la taille de l'administration, mais aussi une érosion de la résilience du Canada.
« Nous partageons l'objectif d'une fonction publique plus efficace et plus innovante. Mais on ne peut pas faire plus avec moins. Une véritable efficacité signifie des investissements plus intelligents, et non pas la suppression de services », ajoute M. O'Reilly.
Parallèlement, le gouvernement continue d'investir des sommes record dans l'externalisation de travaux à des consultants privés : 26 milliards de dollars sont prévus pour cette seule année, soit le montant le plus élevé jamais enregistré selon ses propres estimations. Bien que le budget prévoie une vague réduction de la sous-traitance, l'IPFPC note que des promesses similaires ont déjà été faites sans résultats concrets. C'est une approche qui ne tient toujours pas la route.
« Il n'est pas efficace de remplacer des fonctionnaires expérimentés par des consultants onéreux qui coûtent 25 % de plus qu'un•e professionnel•le de la fonction publique », poursuit M. O'Reilly. « Si l'objectif est de réaliser des économies, il faut commencer par les milliards versés aux entreprises privées, et non par les inspecteur•rices de la sécurité alimentaire ou les scientifiques de la santé publique. »
Les professionnel•les de la fonction publique savent où se situent les véritables inefficacités : mauvaise planification, systèmes obsolètes, manque de confiance et de consultation avec les spécialistes de la fonction publique, et recours excessif à une externalisation coûteuse.
« Il faut donner aux fonctionnaires les moyens de se moderniser de l'intérieur », conclut Sean O'Reilly. « Laissez les professionnel•les prendre les devants. C'est ainsi que l'on obtient une efficacité réelle, sans réduire les services dont dépend la population. »
L'Institut représente plus de 85 000 professionnel•les du secteur public un peu partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et sur Instagram.
SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)
Budget fédéral - « Un budget décevant et traditionnel malgré un enrobage sucré », fait valoir la CSQ
MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) prend acte du premier budget du ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, et souligne qu'il s'agit, à bien des égards, d'un budget décevant.
« Il y a beaucoup d'enflure verbale quant à la couleur que le gouvernement souhaite donner à ce premier budget, mais à première vue, ce que l'on constate, c'est que l'approche budgétaire et comptable du gouvernement sert surtout à masquer le fait qu'il s'agit, malgré tout, d'un budget de compressions », de réagir à chaud le président de la CSQ, Éric Gingras.
Que ce soit les quelque 40 000 postes supprimés dans la fonction publique d'ici 2029 ou encore la croissance des dépenses de programmes, qui passera d'une moyenne de 8 % par année à seulement à 0,6 % pour la première année, il est difficile de ne pas y voir une logique comptable qui ne place pas les travailleuses et les travailleurs au cœur de l'équation.
« On se retrouve donc avec un budget qui parle de dépenses et d'investissements, en établissant une distinction arbitraire qui dévalorise les travailleuses et les travailleurs de nos réseaux publics. Comme si leur travail représentait un coût alors qu'il s'agit d'un investissement social. Le gouvernement aurait pu faire davantage et rien ne justifiait de réduire les services à la population, considérant que le ratio dette/PIB du Canada figure parmi les plus bas des pays du G7. »
La CSQ déplore par ailleurs les orientations du gouvernement quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, dont l'objectif premier est de rendre la fonction publique plus productive, tout en doublant ses intentions de compressions de postes.
« C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ! Cela fait des mois qu'on parle de l'importance de placer l'humain au cœur du déploiement de l'intelligence artificielle et du fait qu'elle ne doit pas être utilisée d'abord comme un outil de compressions budgétaires. C'est une grave erreur et, surtout, un modèle à ne pas suivre ! »
Sur la question du logement, la Centrale voit d'un bon œil la volonté du gouvernement de s'attaquer à la crise, mais déplore, du même souffle, l'absence d'investissements dans les logements sociaux et l'absence de mesures structurantes.
« Il y a une volonté claire, et on ne peut que saluer cette transition, même si ce n'est évidemment pas suffisant pour régler la crise. : la question du logement constitue une préoccupation majeure pour les travailleuses et les travailleurs que nous représentons. »
Pour la CSQ, le fait que le gouvernement confirme que la proportion des dépenses en défense atteindra 5 % du PIB en 2035 a de quoi faire sourciller. « Il faut simplement prendre acte du fait qu'il s'agit d'une somme considérable et que c'est un gros morceau qui ne va ni dans les services ni dans les transferts aux provinces dans nos réseaux. Pourquoi, d'ailleurs, ne parle-t-on jamais en termes de proportion du PIB lorsqu'il s'agit de nos réseaux publics, notamment en éducation ? Cela nous permettrait de mieux comprendre et de comparer des pommes avec des pommes. »
Pour conclure, il est impossible de ne pas souligner l'absence quasi totale d'investissements en environnement, ainsi que le statu quo quant à l'assurance médicaments, un programme insuffisant dans son état actuel.
SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Réaction de la FTQ au budget fédéral
MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) prend acte du budget fédéral présenté par le gouvernement et accueille positivement les investissements annoncés pour les entreprises, les infrastructures et le domaine de la science qui doivent créer et maintenir des emplois. Cependant, elle s'inquiète des compressions prévues dans la fonction publique fédérale.
« Nous le savons tous, les travailleurs et travailleuses souffrent des caprices de notre voisin du sud avec sa guerre commerciale sur les tarifs douaniers. La dernière chose que souhaite le Québec en ce moment, c'est une élection fédérale. La FTQ invite donc le gouvernement et les partis d'opposition à trouver des voies de passage pour assurer la stabilité politique afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs et travailleuses et de toute la population », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.
« Il ne faut surtout pas oublier que pour Bâtir un Canada fort comme le souhaite le gouvernement fédéral, cela ne peut se faire sans les travailleurs et travailleuses qui sont appelés à livrer les services à la population, surtout en période de crise », conclut le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.
SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Les syndicats du Canada appellent à des mesures plus fortes relatives aux emplois et aux services publics (CTC)
OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 - Le budget fédéral déposé aujourd'hui tombe à un moment de profonde incertitude. Les travailleuses et travailleurs doivent composer avec la hausse des prix, une crise commerciale grandissante et des programmes publics grevés au maximum. Puisque les tarifs douaniers imposés par les É.-U. éliminent déjà des emplois canadiens, ce budget donnait une occasion de montrer que le Canada est prêt à défendre les travailleuses et travailleurs, à accroître sa résilience, à protéger les emplois et à investir dans les personnes et les services publics.
Le gouvernement Carney a plutôt livré un budget qui réduit les services sur lesquels comptent les travailleuses et travailleurs et qui ne comprend pas les protections que l'actuel gouvernement a été élu pour mettre en œuvre.
« Pour ce qui est de défendre les emplois canadiens, le gouvernement actuel doit se relever les manches de nouveau. Les tarifs de Trump et les menaces commerciales mettent les travailleuses et travailleurs du Canada en péril, et le gouvernement ne peut pas se croiser les bras devant cela. Il nous faut des investissements générationnels dans le logement et l'infrastructure publique — construits par une main-d'œuvre syndiquée à l'aide de matériaux faits au Canada — pour assurer de bons emplois et maintenir la prospérité ici au Canada », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.
« On ne peut pas créer des emplois en en éliminant des milliers », ajoute madame Bruske. « Pas plus qu'on ne peut aider à la croissance de l'économie en réduisant les services publics. Les travailleuses et travailleurs ont besoin d'un budget qui investit dans les personnes et l'infrastructure publique. »
« Puisque le parlement est minoritaire, ce budget n'est pas un fait accompli et il n'est pas nécessaire de tenir une élection pour que la population canadienne le fasse savoir », dit madame Bruske, « Les syndicats du Canada demandent au gouvernement libéral de travailler avec les autres partis pour modifier le budget de manière à assurer les soutiens, les investissements et les protections dont les travailleuses et travailleurs ont besoin afin de résister aux tarifs douaniers étatsuniens, de protéger les emplois canadiens et d'assurer une sécurité économique durable. Il est temps que le parlement défende les travailleuses et travailleurs. »
Le budget comprend des mesures sur lesquelles il vaut la peine de faire fond, y compris l'affectation de milliards de dollars à la construction d'habitations et d'infrastructures, le doublement des fonds affectés au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical et le nouveau crédit d'impôt de 1 100 $ pour les personnes préposées aux bénéficiaires. Ces investissements sont précisément du genre dont les travailleuses et travailleurs ont besoin, car ils renforcent les compétences, haussent les salaires et améliorent les soins.
Mais pour vraiment protéger les travailleuses et travailleurs et notre économie, il faut prendre plus de mesures de ce genre — et procéder à moins de coupures.
Le parlement doit s'unir pour modifier le budget afin qu'il protège les services publics, renforce les soins de santé, modernise l'assurance-emploi, voie à ce que le commerce soit assujetti au respect des normes du travail, élimine les échappatoires fiscales dont profitent les entreprises et procède à des investissements générationnels dans le logement, l'infrastructure et la production canadienne dont le Canada a besoin pour garantir notre avenir économique. Les travailleuses et travailleurs sont prêts à bâtir cet avenir — il est temps que notre gouvernement les appuie activement.
« Les travailleuses et travailleurs ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à faire leur part pour rebâtir le Canada au besoin », conclut madame Bruske. « Il est temps que notre gouvernement adopte une détermination semblable — en défendant activement les travailleuses et travailleurs. »
SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marinvest Energy, un nouveau projet de GNL au Québec ?

Si vous avez eu la chance de partir en vacances cet été et de décrocher des nouvelles, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais on veut nous refaire le coup d'un projet de transport de gaz dit « naturel » sur le territoire du Québec. En gros, un GNL Québec 2.0 ! Voici donc un résumé de ce que Nature Québec sait de Marinvest Energy pour le moment.
Une nouvelle tentative de projet de gaz fossile ?
Précisions d'entrée de jeu : il n'y a, pour le moment, officiellement aucun projet déposé nulle part. Les informations dont nous disposons sont issues de recherches sur le registre des lobbyistes du Québec, de demandes d'accès à l'information de Greenpeace Canada et d'enquêtes menées par des journalistes. Mais la nature du projet est, elle, déjà bien connue ainsi que ses composantes principales.
Ce nouvel essai énergétique est porté par une compagnie norvégienne, Marinvest Energy AS. Elle a pour idée d'implanter un complexe gazier constitué d'un gazoduc s'étendant de la frontière avec l'Ontario jusqu'à Baie-Comeau, en passant au nord du Lac Saint-Jean, et un terminal : une usine de liquéfaction flottante dans la Baie des Anglais. Ce gaz naturel liquéfié (GNL) albertain serait ensuite transbordé sur des méthaniers et envoyé sur les marchés européens.
Qui est Marinvest Energy AS ?
Créée en 2020, cette entreprise norvégienne se spécialise dans le développement de terminaux et systèmes d'énergie marine pour transporter le GNL. Elle a enregistré récemment une filiale au Québec sous le nom de Marinvest Énergie Canada. Pour le moment, il n'y a qu'un seul employé, le directeur de l'exploitation, Greg Cano, connu pour avoir joué un rôle majeur dans la construction du gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Ce pipeline avait défrayé l'actualité à cause de la violence avec laquelle les membres de la Nation Wet'suwet'en (1) avaient été traités pour leur opposition au projet.
Qu'est-ce que le GNL ?
GNL est l'acronyme de gaz naturel liquéfié. On parle ici de gaz dit « naturel » (car issu d'un processus terrestre naturel) qu'on refroidit à environ -160°C pour le transformer à l'état liquide, permettant ainsi de le transporter et de le stocker plus facilement sur de longues distances, notamment sur des bateaux qu'on appelle des méthaniers.
Un projet qui aggraverait sans aucun doute la crise climatique
Si certains détails restent flous, l'objectif même de Marinvest Energy — permettre l'augmentation de la production du gaz fossile au Canada et l'exportation de cette ressource sur les marchés mondiaux — ne laisse aucun doute quant aux impacts climatiques et à la hausse des émissions de GES du pays.
Rappelons que le gaz dont on parle ici est du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO2 lors de ses vingt premières années de vie dans l'atmosphère. Il est également issu en très grande partie de la fracturation hydraulique, le procédé d'extraction le plus polluant et ayant des impacts sérieux sur la santé des populations vivant à proximité des sites (contamination des nappes phréatiques, destruction de milieux naturels et fuites de méthane qu'il entraîne). C'est d'ailleurs en partie pour ces raisons que la province de Québec a interdit cette pratique en 2021 avec la Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure.

La compagnie veut alimenter en électricité l'usine de liquéfaction grâce à un parc éolien. C'est d'ailleurs sur cet argument qu'elle s'appuie pour qualifier son projet de « carboneutre ». On entend aussi souvent dire que le gaz est une énergie de transition, or ce n'est pas le cas. À la combustion, il émet en effet moins que le charbon ou le pétrole, mais lorsqu'on prend en compte les émissions sur l'ensemble de son cycle de vie, de l'extraction jusqu'à la combustion, le GNL a un bilan d'émission de GES égal, voire pire que le charbon (2).
L'utilisation de termes comme « carboneutre » ou « énergie de transition » dans ce contexte n'est qu'une stratégie de marketing et elle porte un nom : l'écoblanchiment ! Ce projet augmenterait nécessairement les émissions de GES du Canada.
Et les impacts sur la biodiversité et la protection des territoires ?
Les enjeux pour la protection de la biodiversité et du territoire sont nombreux et varient en fonction des différentes infrastructures qui doivent composer le complexe gazier.
Le gazoduc
Avec près de 1000 km de long, sa construction va entraîner de la déforestation sur l'ensemble du tracé ainsi qu'une grande fragmentation des habitats fauniques et floristiques et la destruction de nombreux milieux humides et hydriques. De nombreuses traversées de rivières, dont plusieurs sont actuellement harnachées, présentent aussi des risques pour la faune aquatique et la pollution de l'eau. De plus, l'emprise du pipeline de 60 mètres de large limite beaucoup d'activités comme le reboisement ou l'interdiction de certaines plantations. Nommons également que le tracé de ce gazoduc traverserait des territoires non cédés de plusieurs Premières Nations.
L'usine de liquéfaction
La Baie des Anglais où elle serait construite abrite une riche biodiversité, notamment sur le plan des oiseaux et de la faune aquatique. Elle est reconnue à travers différentes désignations, que ce soit des aires de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA), la zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), ou encore la région de biosphère Manicouagan-Uapishka. Certaines espèces aquatiques en péril comme le rorqual commun, le rorqual bleu ou encore le béluga sont aussi présentes ou susceptibles d'être dans ce secteur. Les travaux de construction de cette nouvelle usine pourraient également augmenter le bruit sous l'eau et causer la mortalité ou le déplacement d'invertébrés benthiques et de poissons fréquentant le site, en plus de détruire ou de modifier localement leurs habitats.
Les éoliennes
Leur installation risquerait d'engendrer déboisement, fragmentation d'habitats fauniques et floristiques à cause des chemins forestiers et perte de milieux hydriques et humides. On sait aussi que leur fonctionnement a des impacts significatifs sur les oiseaux et les chauves-souris.
Les méthaniers
Il est également important de prendre en compte les impacts cumulatifs qu'un tel projet énergétique pourrait avoir sur le climat, la biodiversité, et l'environnement de façon plus générale (p. ex. qualité de l'eau et de l'air), considérant les nombreuses activités industrielles se déroulant déjà dans le secteur.
Est-ce un projet sérieux ?
Après avoir fermé la porte au projet d'oléoduc Énergie-Est et à GNL Québec il y a quelques années, nous pensions en avoir fini avec les projets de pipelines d'énergies fossiles au Québec. Malheureusement, c'était sans compter le chaos géopolitique mondial actuel et son instrumentalisation par les entreprises d'énergies fossiles.
Un lobbyisme intensif en cours
Ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'entreprise est en train d'enchaîner les rencontres avec le gouvernement Carney et le gouvernement Legault pour aller chercher leur appui politique afin, ensuite, d'attirer des investisseurs. Et à ce registre, elle ne chôme pas. Depuis le mois de février 2025, ses six lobbyistes ont déjà obtenu de nombreuses audiences. Au provincial, des discussions ont eu lieu avec le cabinet du premier ministre, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et celui de l'Environnement.
Du côté d'Ottawa, c'est le cabinet du premier ministre Carney ainsi que celui du ministre de l'Énergie, Tim Hodgson, qui ont été rencontrés. Ici, aucune surprise quant au fait qu'une partie de la conversation porte sur la possibilité pour le projet d'être désigné comme d' « intérêt national » en vertu des dispositions adoptées sous bâillon avec la loi C-5. Si cela s'avérait, ce complexe gazier pourrait être approuvé de manière accélérée, sans évaluation environnementale approfondie et en contournant les droits des communautés autochtones et plusieurs lois environnementales, comme celle sur les espèces en péril. Au vu des impacts éventuels du projet, c'est loin d'être rassurant.
Un contexte économique loin d'être favorable
Nature Québec a publié en juin 2025 une analyse économique (3) confirmant que pour voir le jour et être rentables, des projets comme celui de Marinvest Energy devraient être financés par les contribuables. Pourquoi ? Premièrement, dans une lettre ouverte (4), 46 économistes ont montré qu'un tel projet coûterait entre 33 et 41 milliards de dollars. Or, notre rapport économique et différentes études consultées (5) sur les projections de la demande pour le gaz abondent toutes dans le même sens : la production mondiale de gaz va excéder la demande, créant un contexte de marché risqué pour les producteurs. Par exemple, le marché européen visé par le projet a vu sa consommation de gaz reculer de 20 % entre 2021 et 2024 (6). Dans ce contexte, la seule façon de réduire les risques pour le secteur fossile privé est de sécuriser du financement public.
Deuxièmement, on se souvient qu'interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, François Legault et d'autres membres du gouvernement se sont dit ouverts au projet à condition qu'il amène des retombées économiques pour le Québec. Serait-ce le cas ? En fait, les retombées économiques seraient minimes, presque exclusivement générées lors de la phase de construction des différentes infrastructures. En effet, n'étant qu'un projet de transport de GNL, le Québec ne serait qu'un corridor où circulerait et serait liquéfié le gaz fossile pour ensuite être acheminé vers les marchés européens.
Quel rôle jouera Nature Québec pour la suite ?
Pour notre organisation, il est clair que ce projet de complexe gazier ne tient pas la route, ni économiquement, ni à cause de son impact environnemental. S'il voyait le jour, il constituerait une bombe climatique en plus de causer des dommages irrémédiables aux écosystèmes. Ce GNL Québec 2.0 n'est pas une solution efficace pour l'économie québécoise, ni un gage de beaucoup d'emplois à long terme. Les Québécois, Québécoises et les communautés locales doivent avoir accès à ces informations. C'est pourquoi nous étions à Baie-Comeau en septembre 2025 suite à l'invitation du TROC-CDC Côte-Nord et de Mères au front pour participer à une séance d'informations publique sur les enjeux entourant le projet. Nous créons et partageons également des contenus sur les réseaux sociaux pour informer au mieux le public.
Nous suivons donc de très près le dossier et intervenons à chaque étape pour que ce projet ne voit jamais le jour. Nous sommes intervenu-e-s dans les médias, nous alertons les leaders politiques et nous aidons les Québécois-es à se mobiliser.
Avec nos allié-e-s, nous avons dit non à Énergie-Est et non à GNL Québec.
Aujourd'hui, Marinvest Energy, c'est encore NON !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pas de chèque en blanc pour QSL

Plusieurs signes nous laissent croire que le projet de terminal de QSL à la Baie de Beauport pourrait être inclus dans la Loi C-5 dès novembre, c'est-à-dire qu'il ne serait soumis à aucune évaluation environnementale ni consultation citoyenne.
En tant que citoyen·ne·s, regroupements et élu·e·s, nous demandons au Maire de Québec et à ses conseillers·ères de Limoilou et de Beauport de s'opposer à cette dérive autoritaire du gouvernement canadien.
À l'été 2024, la Table citoyenne Littoral Est apprenait dans les médias que l'entreprise QSL développait un autre projet de terminal de conteneurs au Port de Québec : 250 000 conteneurs y seraient transbordés par année. Cette annonce survient trois ans à peine après le refus du projet Laurentia à cause de ses impacts environnementaux importants et la pollution de l'air qu'il aurait occasionné. Les acteurs locaux sont consternés par la résurrection d'un nouveau projet de conteneurs au Port de Québec. Une mobilisation citoyenne s'organise et on interpelle les élu·es. Cependant, autant du côté de l'administration portuaire que de la Ville de Québec, les réponses sont évasives : « il n'y a aucun projet concret sur la table, donc aucune matière pour se prononcer ».
Un an plus tard, il n'y a toujours pas de projet « officiellement » déposé au Port de Québec par QSL, ni aucune information accessible au public quant à son contenu et à ses impacts. Pis encore, les quelques informations existantes ne sont pas transmises, alors que plusieurs demandes ont été faites.
Or, en coulisses, ça semble être tout autre chose : QSL, à grand coup de lobbyisme, fait pression sur le gouvernement Carney pour obtenir les autorisations dont elle a besoin pour avancer. À tel point qu'on est passé en quelques semaines d'un projet inexistant à un projet « d'intérêt national » !
QSL et C-5 : des signes avant-coureurs
En juin dernier, le gouvernement Carney adoptait, sous bâillon, la Loi C-5 qui vise à accélérer le lancement de grands projets d'infrastructures considérés « d'intérêt national », dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, en outrepassant les mécanismes d'évaluations environnementales en place.
Pour nous, la menace de voir le projet de QSL bénéficier des échappatoires de la loi C-5 est imminente. Les signes avants-coureurs s'accumulent : les élus libéraux de Québec s'enthousiasment, une étude financée par la chambre de commerce maritime décrit le projet comme « névralgique » et finalement, la semaine dernière, le gouvernement Carney dévoile son premier budget, dont la page couverture est un bateau-cargo à Québec ! On peut y lire que le gouvernement confirme l'ajout de ressources frontalières pour le commerce maritime et que le projet de terminal de QSL est en voie d'être désigné comme port de conteneurs international.
Non à QSL dans la Loi C-5 !
À l'heure actuelle, nous, citoyen·ne·s, regroupements et élu·es, sommes particulièrement inquièt·es que le gouvernement du Canada nous impose ce terminal de conteneurs, sans étude environnementale, sans consultation citoyenne, sans débat démocratique.
Le Maire de Québec, Bruno Marchand, a signifié il y a quelques mois que son appui au projet n'était pas un chèque en blanc ; pourtant, c'est bel et bien ce qu'il sera si le gouvernement Carney l'inclut dans C-5.
Nous demandons donc au Maire de Québec Bruno Marchand et à ses élu·es des districts concernés - Marylou Boulianne, Raymond Poirier et Éric Courtemanche-Baril - de tenir parole en s'opposant à ce que le terminal de QSL fasse partie de C-5. Nous leur demandons de réclamer que le projet soit soumis aux mécanismes que la démocratie a mis en place pour évaluer si un projet est bon ou néfaste pour l'environnement et la communauté.
Limoilou, Beauport et la Basse-Ville de Québec subissent plus que les autres les effets néfastes d'un cocktail de pollution atmosphérique, en raison notamment de la proximité de ces quartiers avec le Port de Québec, où les activités de transbordement et le transport lourd qui en résulte nous empoisonnent quotidiennement. Dans ce contexte, il est inacceptable d'outrepasser les règles environnementales et d'imposer unilatéralement d'autres activités industrielles préjudiciables pour les citoyen·nes des quartiers centraux de Québec, quartiers qui, on doit le rappeler, sont déjà des milieux saturés en matière de pollution. Nous refusons qu'on nous en ajoute encore plus !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une délégation jeunesse représente l’AQOCI à la COP30 et au Sommet des peuples au Brésil

Montréal, le 10 novembre 2025 - Une délégation jeunesse de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) participe à la 30e Conférence des parties sur les changements climatiques (COP30) et au Sommet des peuplesqui se déroulent à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025.
Lors de ces événements déterminants dans la lutte aux changements climatiques, sept jeunes militant·es des quatre coins du Québec représentent l'AQOCI, dont trois jeunes autochtones. Ils et elles portent unplaidoyer pour une justice climatique féministe visant à amplifier les voix des communautés les plus affectées par la crise climatique, notamment les pays du Sud global, et influencer les décideur·euses québécois·es et canadien·nes.
La COP30 a pour objectif principal d'accélérer la mise en œuvre de l'Accord de Paris et son emplacement en Amazonie permet également de mettre en lumière les enjeux liés à la biodiversité et à la préservation des forêts. Parallèlement, Belém accueille le Sommet des peuples, rassemblant la société civile et les peuples autochtones du monde entier pour faire entendre leurs voix.
À travers sa délégation jeunesse et son plaidoyer, l'AQOCI poursuit la lutte pour la justice climatique, en solidarité avec ses partenaires du Sud global, notamment en demandant au Canada de faire sa juste part en termes de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de financement climatique.
« La COP30 à Belém, en Amazonie, représente une occasion incontournable de recentrer les discussions sur les territoires les plus touchés par la crise climatique, mais aussi sur les savoirs, les résistances et les solutions qui en émergent. C'est également une opportunité de réfléchir collectivement aux contradictions entre les discours climatiques et les logiques d'extractivismes actuels, et de réaffirmer la nécessité d'une lutte contre les changements climatiques qui soit véritablement juste, inclusive et centrée sur les droits des communautés. » Frédérique Malecki, déléguée jeunesse de l'AQOCI.
« En tant qu'Autochtone et jeune Wendat-Innu, il est primordial d'affirmer l'apport des peuples autochtones à la lutte contre les changements climatiques. La souveraineté alimentaire fait partie intégrante de notre culture : les Trois Sœurs maïs, courges et haricots nourrissaient autrefois notre peuple à plus de 85 %. Nos valeurs de respect, de bienveillance et de pensée circulaire demeurent au cœur de notre quotidien et inspirent la protection de nos forêts, de nos terres, de notre eau et de notre territoire. La COP30 sera pour moi et l'ensemble de la délégation l'occasion de réaffirmer et de faire progresser la lutte contre les changements climatiques depuis cette perspective wendat. » Hadishrayen Diego Gros-Louis Rock, délégué jeunesse de l'AQOCI.
« La crise climatique a des impacts disproportionnés sur les femmes et les personnes de genres divers, particulièrement celles qui font face à de multiples formes de discrimination
croisées. Dans le cadre de la COP30, nous demandons l'adoption d'un nouveau Plan d'action sur l'égalité des genres transformateur et ambitieux. » Marie-Jeanne Eid, déléguée jeunesse de l'AQOCI.
« Il n'est jamais trop tard pour convaincre les États, et la COP est l'un des seuls lieux où la société civile peut approcher directement les décideurs. Mais le plus important réside dans les convergences entre mouvements sociaux internationaux, rendues possibles par la présence de militants du monde entier. Cette première COP dans un régime démocratique depuis 2021 se traduira inévitablement par un regain en puissance des luttes mondiales pour la justice climatique. » Albert Lalonde, délégué·e jeunesse de l'AQOCI.
L'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) créée en 1976, regroupe plus de 70 organismes de 14 régions du Québec qui œuvrent, à l'étranger et localement, pour un développement durable et humain. L'AQOCI a pour mission de soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'AQOCI œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la construction d'un monde basé sur des principes de justice, d'inclusion, d'égalité et de respect des droits humains.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Manifeste pour une révolution écosocialiste : une déclinaison possible aux Philippines

Adopté par la Quatrième Internationale, le « Manifeste pour une révolution écosocialiste – Rompre avec la croissance capitaliste » a été présenté à Manille en octobre 2025 lors d'une discussion réunissant universitaires, militants de mouvements sociaux et d'organisations politiques. La réunion était co-organisée par l'IIRE-Philippines et le Partido Manggagawa. Le texte ci-dessous est celui de l'intervention de Daniel Tanuro, qui a a coordonné le travail de rédaction du Manifeste. Nous publions par ailleurs le texte « Introduction to the Manifesto for an Ecosocialist Revolution : Work Less, Live Better » (sur ESSF, article 76874) que Maral Jefroudi (codirectrice de l'IIRE Amsterdam) a présenté au cours de la même réunion.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
31 octobre 2025
Par Daniel Tanuro
Bidonvilles et gratte-ciel sur le front de mer à Manille
Lors de son dernier congrès mondial, la Quatrième Internationale a adopté un document intitulé « Manifeste pour une révolution écosocialiste – Rompre avec la croissance capitaliste ». L'objectif de cette conférence n'est pas d'entrer dans le détail de ce texte, mais plutôt de présenter les problèmes qu'il soulève. En guise de conclusion, je proposerai quelques pistes pour une éventuelle concrétisation dans le contexte philippin.
POINT DE DÉPART : L'IMMENSE MENACE DE LA « CRISE ÉCOLOGIQUE »
Le point de départ est ce que l'on appelle la « crise écologique mondiale ». Nous pensons que cette crise nous confronte à une situation de menace existentielle sans précédent, non seulement dans l'histoire du capitalisme, mais aussi dans l'histoire de l'humanité.
Les scientifiques identifient neuf paramètres qui conditionnent la durabilité humaine sur la planète Terre :
Le changement climatique (principalement dû à la concentration atmosphérique croissante en CO2, par suite principalement de la combustion d'énergies fossiles) ;
La perte de biodiversité (dont le rythme est actuellement plus rapide qu'à l'époque de la disparition des dinosaures, il y a 60 millions d'années) ;
La pollution de l'air par les particules (à l'origine de nombreuses maladies respiratoires) ;
L'empoisonnement des écosystèmes par de « nouvelles substances chimiques » (nucléides radiactifs, pesticides, PFAS… et autres substances cancérigènes, dont certaines s'accumulent car elles ne sont pas – ou très lentement - décomposables naturellement) ;
Le changement d'affectation des sols et leur dégradation (déforestation, érosion, perte de nutriments, destruction des zones humides…) ;
L'acidification des océans (entraînant la disparition des récifs coralliens, hauts lieux de la biodiversité) ;
Les ressources en eau douce ;
La perturbation des cycles de l'azote et du phosphore (la surutilisation des nitrates et des phosphates en agriculture provoque un phénomène appelé eutrophisation : la prolifération excessive d'algues appauvrit l'eau en oxygène dissous) ;
L'état de la couche d'ozone stratosphérique (qui nous protège des rayons UV).
Pour chacun de ces paramètres, les scientifiques ont déterminé un « seuil » de durabilité. Ce seuil n'est pas une limite stricte, mais son franchissement signifie que nous entrons dans une zone dangereuse. Il y a quinze ans, les chercheurs estimaient que trois seuils avaient été franchis : le CO2, la biodiversité et l'azote. Actuellement, ils estiment que sept seuils ont été franchis. Le seul indicateur ayant évolué positivement est l'état de la couche d'ozone (grâce à la mise en œuvre de mesures adéquates, non néolibérales, de régulation, pour des raisons spécifiques qui ne seront pas développées ici). Aucun seuil clair n'a encore été déterminé pour la pollution atmosphérique par les particules.
Il suffit de parcourir cette liste de paramètres pour comprendre que la soi-disant « crise écologique » est aussi une crise sociale majeure aux conséquences potentiellement énormes. Ces conséquences sont bien connues, en particulier dans votre pays : typhons plus violents, pluies torrentielles plus fréquentes, sécheresses plus intenses, vagues de chaleur plus nombreuses, glissements de terrain plus fréquents, inondations côtières et fluviales plus fréquentes, élévation du niveau de la mer, etc. Tous ces phénomènes s'aggravent et continueront de s'aggraver si rien ne change.
Si l'on met de côté la couche d'ozone, les autres facettes écologiques de la crise sont étroitement liées, et le changement climatique occupe une position centrale dans le tableau. Le réchauffement climatique accélère la perte de biodiversité, la combustion des énergies fossiles est une cause majeure de pollution atmosphérique par les particules, l'acidification des océans résulte de la concentration croissante de CO2 dans l'atmosphère, la déforestation est la deuxième source d'émissions de CO2, les nitrates en excès se dégradent en libérant un puissant gaz à effet de serre (l'oxyde nitreux), les pesticides et les PFAS sont des produits de l'industrie fossile (pétro-chimique)…
Les scientifiques alertent depuis des décennies sur une catastrophe imminente, mais les gou-vernements sont restés passifs, ou presque. Aujourd'hui, certains chefs d'État, comme Trump et Milei, nient ouvertement la réalité. D'autres prennent des mesures largement insuffisantes, inefficaces, voire contre-productives ; de plus, ils remettent leurs propres mesures en question au nom de la compétitivité.
Du fait de cette attitude, la catastrophe n'est plus une simple possibilité. Nous y sommes déjà, et elle s'accélère. Si rien ne change, si aucun plan d'urgence n'est mis en œuvre, elle deviendra incontrôlable. L'état physique de la Terre se modifiera, et il n'y aura plus de retour en arrière. La catastrophe se transformera en cataclysme, comparable à celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Selon certaines recherches récentes, une succession de « rétroactions positives » à partir de 2 °C de réchauffement pourrait suffire à précipiter la planète sur cette voie irréversible.
Les populations les plus pauvres ne sont pas responsables de la catastrophe, mais elles en sont les principales victimes, surtout dans les pays les plus pauvres. À l'heure actuelle, selon le GIEC (AR6, groupe de travail 2, rapport complet), les trois quarts des surfaces cultivées mondiales subissent des pertes de rendement dues à la sécheresse météorologique ; 3 à 3,5 milliards de personnes sont fortement impactées par le changement climatique ; quatre milliards de personnes souffrent de graves pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année. La plupart de ces personnes vivent dans les pays les plus pauvres. Leur existence même est menacée.
Une climatologue de renom, ancienne coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC, l'a récemment déclaré lors d'une interview : au rythme actuel, nous nous dirigeons vers une augmentation de 4 °C de la température moyenne mondiale dans les prochaines décennies. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera la Terre dans une telle situation, mais une chose est absolument certaine : une planète aussi chaude ne pourra pas supporter 8 milliards d'êtres humains ; probablement seulement la moitié.
Le simple bon sens devrait exiger la prise urgente de mesures drastiques de justice sociale et écologique. Pourquoi n'est-ce pas le cas ? Qu'est-ce qui est plus fort que le bon sens, plus fort que l'instinct de survie collectif ? La réponse est limpide : la course au profit, qui implique inévitablement de produire toujours plus de biens à moindre coût, engendrant ainsi toujours plus d'inégalités et de discriminations sociales.
La vérité est que le capitalisme est un système productiviste, et que ce productivisme est destructiviste. Le capitalisme social n'existe pas. Le capitalisme vert n'existe pas non plus, pour la même raison. Nous devons nous efforcer de sortir de ce système absurde. Sans cela, il écrasera les classes populaires, mutilera la nature dont nous faisons partie et pourrait même détruire l'humanité.
Une révolution – une révolution mondiale sociale, écologique, féministe et anticolonialiste – est objectivement nécessaire. C'est le point de départ de notre Manifeste.
UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE MONDIALE RENOUVELÉE
Ce point de départ n'est pas nouveau. Mais il implique une perspective historique mondiale renouvelée. Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels écrivaient que « le prolétariat doit prendre le pouvoir politique pour augmenter la quantité de forces productives ». Ce n'est plus une option envisageable aujourd'hui à l'échelle mondiale. Même une économie stationnaire n'est plus envisageable. À l'échelle mondiale, le franchissement des seuils de la soutenabilité humaine sur Terre signifie clairement que le capitalisme nous a menés trop loin. Il nous faut revenir en arrière, point final. Accroître les forces productives, c'est le propre du capitalisme. Nous devons les réduire globalement. Autrement dit, une décroissance est objectivement nécessaire. Cette décroissance n'est évidemment pas notre projet de société : l'écosocialisme est notre projet. La décroissance globale n'est pas une revendication : c'est une contrainte dont nous devons tenir compte dans la transition vers une autre société.
Cette nécessité de décroissance mondiale semble en totale contradiction avec la situation dans un pays comme les Philippines et d'autres pays pauvres. En effet, d'immenses besoins sociaux restent insatisfaits dans votre pays. Un quart de la population souffre de malnutrition. Il est in-dispensable de développer le système éducatif, le système de santé, un système de distribution d'eau potable pour tous, etc.
Ces besoins sont pleinement légitimes. Nul ne peut les nier, ils doivent être satisfaits. Bien évidemment, cela implique une certaine forme de croissance économique. Construire des logements décents pour tous nécessite du ciment. Produire ce ciment demande de l'énergie et émet du CO2. Des capacités accrues sont indispensables pour relever tous ces défis, dans l'intérêt des populations les plus pauvres.
C'est dire que l'humanité ne pourra faire face à la crise socio-écologique qu'en tenant compte d'un principe fondamental inscrit dans la CCNUCC : le principe des« responsabilités et capacités communes mais différenciées ». Les pays développés sont responsables de la catastrophe, doivent en supporter le coût. Ces pays ont les moyens nécessaires. Ils doivent les transférer. Ils doivent réduire leurs émissions de 15 % par an. Ce n'est possible qu'au prix d'une décroissance économique radicale, sans frapper les populations pauvres de ces pays.
Cependant, le défi de la décroissance concerne aussi les pays pauvres. En effet, le principe des « responsabilités et capacités communes mais différenciées » ne signifie pas que ces pays pourraient suivre le modèle de développement des pays développés.
Ce modèle reposait – et repose encore – sur les énergies fossiles et l'agrobusiness. La classe dirigeante mondiale et les « élites » capitalistes du Sud prétendent que ce modèle extractiviste permettra même aux pays les plus pauvres de rattraper les pays les plus développés. C'est totalement faux. En réalité, si les pays pauvres continuent d'appliquer ce modèle de « développement » – comme le fait la Chine –, cela aggravera la catastrophe dont ils sont déjà victimes, et accélérera la transformation de la catastrophe en cataclysme. On comprend immédiatement qu'il est absurde de persister dans cette voie !
CONSÉQUENCES POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES
Ceci nous amène à une conclusion importante de notre Manifeste. Citation :
« Le discours du « rattrapage du Sud par rapport au Nord » est une chimère, un écran de fumée destiné à masquer la perpétuation de l'exploitation capitaliste et impérialiste, qui creuse les inégalités. Face à la multiplication des catastrophes écologiques, ce discours perd toute crédibilité. (…) L'heure n'est plus au « rattrapage », mais au partage planétaire. (…) Pour satisfaire leurs besoins, les populations des pays dominés ont besoin d'un modèle de développement radicalement opposé au modèle impérialiste et productiviste, un modèle qui privilégie les services publics pour le bien commun et non la production de biens destinés au marché mondial. Ce modèle anticapitaliste et anti-impérialiste exproprie les monopoles des secteurs de la finance, des mines, de l'énergie et de l'agroalimentaire, et les socialise sous contrôle démocratique. »
Le Manifeste va plus loin. Il établit une distinction entre les pays dits « émergents » et les pays plus pauvres. Notamment les Philippines, qui émettent en moyenne 1,4 tCO₂/habitant par an, c'est-à-dire moins que la moyenne mondiale des émissions par habitant nécessaire au respect de l'Accord de Paris.
Voici ce que le Manifeste dit au sujet de ces pays :
« Surtout dans les pays les plus pauvres, la nécessité de satisfaire les besoins de la population exigera une augmentation de la production matérielle et de la consommation d'énergie pendant une certaine période. Dans le cadre d'un modèle de développement alternatif et d'autres échanges internationaux, la contribution de ces pays à la décroissance écosocialiste mondiale et au respect des équilibres écologiques consistera à :
« Imposer une juste réparation aux pays impérialistes.
« Mettre fin à la consommation ostentatoire de l'élite parasitaire.
« Lutter contre les mégaprojets écocides inspirés par les politiques néolibérales capitalistes, tels que les oléoducs géants, les projets miniers pharaoniques, les nouveaux aéroports, les puits de pétrole offshore, les grands barrages hydroélectriques et les immenses infrastructures touristiques qui s'approprient le patrimoine naturel et culturel au profit des riches.
« Mettre en œuvre une réforme agraire écologique pour remplacer l'agro-industrie. » Refuser la destruction des biomes par les éleveurs, les planteurs d'huile de palme, l'agro-industrie en général et l'industrie minière, la « compensation forestière » (projets REDD et REDD+) ainsi que les « accords de pêche » qui offrent des ressources halieutiques aux multinationales de la pêche industrielle, etc. »
Nous avons constaté que cette voie de développement (la décroissance écosocialiste) est contradictoire avec l'approche productiviste du Manifeste du Parti communiste. Mais elle n'est nullement contradictoire avec le marxisme. En effet, Marx lui-même a changé d'avis.
Le Marx du Manifeste du Parti communiste considérait l'émancipation des exploités et des op-primés comme conditionnée par l'accroissement des forces productives. Vingt ans plus tard, le Marx du Capital, conçoit l'émancipation comme conditionnée par la gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et le reste de la nature. C'est « la seule liberté possible », dit-il. Il n'est plus productiviste, ni un admirateur de la technologie en général. Au contraire, il dénonce l'alliance entre l'agrobusiness et la grande industrie qui « ruine les deux sources de toute richesse : la Terre et le travailleur ».
Et ce n'est pas le point final de son évolution. Vingt autres années plus tard, à la fin de sa vie, dans sa lettre à la populiste russe Vera Zassoulitch, Marx affirme clairement que la « commune rurale », dans les pays où elle existe, et grâce à l'alliance avec la classe ouvrière des pays développés, pourra construire une société socialiste sans passer par le capitalisme. Cette dernière évolution de sa pensée revêt une grande importance aujourd'hui, notamment au regard des luttes des peuples autochtones.
Nous considérons donc notre Manifeste écosocialiste comme un prolongement et un approfon-dissement de cette évolution de la pensée de Marx.
UN PROGRAMME DE TRANSITION RENOUVELÉ : FEMMES, PAYSANS, PEUPLES AUTOCH-TONES
La nouvelle perspective anti-productiviste de notre Manifeste implique un effort de renouvellement de notre programme, c'est-à-dire de notre vision du monde pour lequel nous luttons, de nos revendications et de notre stratégie. Je ne peux développer tous ces aspects en détail.
Le monde pour lequel nous luttons est le sujet du chapitre trois de notre document. Ce chapitre est essentiel. Il repose sur l'idée que, dès lors que les besoins fondamentaux sont démocratiquement satisfaits, l'être est plus important que l'avoir.
Quant aux revendications de transition qui constituent un pont vers la société nouvelle, nous restons fidèles à la méthode tracée par Léon Trotsky. Nous reprenons les revendications qu'il a formulées - telles que l'expropriation des grands groupes capitalistes, la réduction du temps de travail, le contrôle ouvrier, etc. - mais nous élargissons le champ d'application de sa méthode.
Nous élargissons le champ car nous considérons tous les mouvements sociaux comme faisant partie intégrante de la lutte des classes. Permettez-moi encore une citation de notre document :
« La lutte des classes n'est pas une froide abstraction. (…) ‘Le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses' (Marx) la définit et en désigne les acteurs. Les luttes des femmes, des personnes LGBTQI+, des peuples opprimés, des personnes racisées, des migrant.e.s, des paysan.ne.s et des peuples indigènes pour leurs droits ne sont pas placées à côté des luttes des travailleur·ses contre l'exploitation du travail par les patrons. Elles font partie de la lutte des classes vivante. Elles en font partie parce que le capitalisme a besoin de l'oppression patriarcale des femmes pour maximiser la plus-value et assurer la reproduction sociale à moindre coût. Il a besoin de la discrimination des personnes LGBTI+ pour valider le patriarcat. Il a besoin du racisme structurel pour justifier le pillage de la périphérie par le centre. Il a besoin de “politiques d'asile” inhumaines pour réguler l'armée de réserve industrielle. Il a besoin de soumettre la paysannerie aux diktats de l'agro-industrie productrice de malbouffe, pour comprimer le prix de la force de travail. Et il a besoin d'éliminer la relation respectueuse que les communautés humaines entretiennent encore en elles-mêmes et avec la nature, pour la remplacer par son idéologie individualiste de domination, qui transforme le collectif en automate et le vivant en chose morte. »
Le Manifeste accorde une place centrale aux revendications féministes. Les femmes « prennent soin » davantage que les hommes. Les raisons de cette réalité font débat parmi les féministes : est-ce dû à leur nature de femmes ou à l'oppression patriarcale ? Nous pensons que l'oppression patriarcale est le facteur déterminant, mais là n'est pas la question ici. L'essentiel ici est que « prendre soin des autres » est ce dont nous avons un besoin urgent : en effet, pour lutter contre la catastrophe écosociale, nous devons prendre soin des personnes et de la nature.
Prendre soin implique de reconnaître l'importance centrale de la reproduction sociale par rapport à la production. Cette importance ne peut que croître dans le contexte du tournant nécessaire vers une décroissance juste et écosocialiste. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si la droite, l'extrême droite et les forces réactionnaires en général s'attaquent violemment aux droits des femmes, en particulier à leur droit de disposer de leur corps et de leur capacité reproductive. Le virilisme et le machisme sont évidement utilisés et encouragés par l'extrême-droite comme armes de domination sur les femmes. Mais cette domination des femmes s'inscrit dans un projet réactionnaire plus vaste de domination de la société et d'appropriation de la nature par le capital. En fin de compte, la violence croissante contre les femmes (et les personnes LGBT+) témoigne de la détermination de la classe dirigeante à défendre par tous les moyens son système d'exploitation du travail et de la nature.
L'importance accordée aux peuples autochtones illustre notre approche renouvelée du pro-gramme de transition. Bien que minoritaires au sein de la population mondiale, les peuples indi-gènes apportent la preuve qu'une autre relation entre l'humanité et le reste de la nature est possible. Leur témoignage revêt ainsi une immense portée idéologique. Citation :
« En particulier, les peuples autochtones et les communautés traditionnelles sont à l'avant-garde de la lutte contre la domination destructrice du capitalisme sur leurs corps et leurs territoires. Dans de nombreuses régions, ils sont même l'avant-garde de nouveaux mouvements révolutionnaires des classes subalternes. C'est pourquoi nous reconnaissons qu'ils sont une partie fondamentale du sujet révolutionnaire du 21e siècle. »
Pour les mêmes raisons, le Manifeste accorde également une grande importance aux luttes et aux revendications des petit.e.s paysan.ne.s face à l'agrobusiness. Citation : Des politiques volontaristes sont nécessaires pour stopper la déforestation et remplacer l'agro-industrie, les plantations industrielles et la pêche à grande échelle respectivement par l'agroécologie paysanne, l'écoforesterie et la pêche artisanale. (…) La souveraineté alimentaire, conformément aux propositions de la Via Campesina, est un objectif clé. Elle passe par une réforme agraire radicale : la terre à celleux qui la travaillent, en particulier les femmes. Expropriation des grands propriétaires terriens et de l'agro-industrie capitaliste qui produisent des biens pour le marché mondial. Distribution de la terre aux paysan·nes et aux paysan·nes sans terre (familles ou coopératives) pour la production agrobiologique. »
UNE STRATÉGIE RENOUVELÉE
Un programme renouvelé implique logiquement une stratégie renouvelée. Le Manifeste rompt avec la vision dogmatique de la lutte des classes comme l'action d'une classe ouvrière industrielle, majoritairement masculine, objectivée et idéalisée. Non seulement les luttes des femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des petits paysans, des migrants et des personnes LGBT+ font partie intégrante de la lutte des classes, mais elles y jouent un rôle décisif dans certaines circonstances. Prenons l'exemple de Greta Thunberg : quand elle traverse l'Atlantique à la voile et mobilise 500 000 personnes à Montréal dans une manifestation pour le climat, ou quand elle navigue vers Gaza pour briser le blocus israélien, cette jeune femme est à l'avant-garde de la lutte des classes !
De plus, ces luttes contribuent à combattre l'idéologie productiviste au sein de la classe ouvrière. Ce point avait d'ailleurs été relevé par Lénine dans sa lutte contre l'« ouvriérisme » et l'« économisme ». Dans « Que faire ? », il écrivait ceci : « La conscience politique de classe ne peut être apportée aux travailleurs que l'extérieur de la lutte économique, de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et employeurs. » Le Manifeste, dans son dernier chapitre, insiste donc sur l'importance d'une stratégie fondée sur la convergence et l'articulation des luttes. Le chemin est semé d'embûches, car chaque mouvement social possède son propre rythme et ses spécificités. C'est entre autres pour cette raison qu'il est crucial de construire des partis politiques, avec des membres actifs dans différents mouvements sociaux.
UN PLAN D'URGENCE POUR LE CLIMAT ET LA JUSTICE SOCIALE AUX PHILIPPINES ?
On a vu que le Manifeste communiste n'était pas un point final mais un point de départ dans la pensée de Marx et Engels. Il en va de même pour notre Manifeste écosocialiste, même s'il n'a évidemment pas la même ambition historique !
En réalité, notre Manifeste n'est rien de plus qu'un diagnostic, une perspective qui en découle, et quelques orientations stratégiques et programmatiques. Ces orientations doivent être concrétisées et approfondies au niveau des différents pays et groupes de pays.
Selon le Rapport mondial sur les risques 2017, les Philippines sont le troisième pays le plus vulnérable au changement climatique. Non seulement les pauvres sont et seront les principales victimes, mais la catastrophe engendrera de nouveaux pauvres et alimentera une spirale de vulnérabilité et d'inégalités sociales. Dans ce contexte, la concrétisation du Manifeste pourrait consister à élaborer un « Plan d'urgence pour le climat et la justice sociale ». L'ambition devrait être de s'attaquer aux principaux problèmes sociaux et écologiques combinés, en tenant compte de l'extrême urgence d'une réponse cohérente, planifiée et immédiate.
Il y a un ouvrage bien connu d'Eduardo Galeano intitulé « Les veines ouvertes de l'Amérique latine ». En réalité, les veines des Philippines sont également ouvertes, pour les mêmes raisons : le colonialisme (par le même colonisateur) et le pillage impérialiste avec la complicité des « élites » locales corrompues. La situation est même pire que celle décrite par Galeano, car non seulement votre main-d'œuvre et vos ressources naturelles sont pillées, mais, en plus vous subissez en retour, de plein fouet, la catastrophe écosociale causée par les puissances capitalistes.
À quoi pourrait ressembler un plan d'urgence pour le climat et la justice sociale ? Au vu de ce que nous avons et discuté vu ces derniers jours, l'alternative pourrait reposer sur une réforme agraire radicale visant à généraliser l'agroécologie, dans le respect des droits des peuples autochtones et en protégeant la biodiversité. Vingt pour cent de la population active travaille dans l'agriculture, et 60 % dans le secteur (surtout informel) des services. La question foncière est cruciale pour freiner – et inverser si possible – l'exode rural, la croissance insoutenable d'une mégapole comme Manille et de ses bidonvilles, l'émigration de millions de jeunes (principalement des femmes) vers les pays du Golfe et d'autres régions, ainsi que pour affronter les problèmes de santé liés à la pollution et à la destruction de l'environnement.
Les défis sont immenses et ne doivent pas être sous-estimés. Ils exigent des réponses structurelles. Selon moi, une réforme agraire radicale et démocratique pourrait constituer le pilier central d'un plan répondant aux besoins fondamentaux en matière de santé, d'eau, de logement, d'assainissement et d'éducation.
Prenons, à titre d'exemple, les menaces qui pèsent sur Manille et sa région. Ces menaces résultent de la combinaison de l'accumulation de la pauvreté (due au modèle de développement capitaliste), de l'accélération de la subsidence des sols (due au pompage excessif des eaux souterraines), de la montée du niveau de la mer et de l'intensification des typhons (tous deux liés au changement climatique). On parle d'« élévation relative du niveau de la mer » quand on additionne les effets de la montée du niveau de la mer à l'échelle mondiale, des ondes de tempête et de la subsidence des sols. Les scientifiques estiment cette élévation relative dans la baie de Manille à 60 cm au cours du siècle dernier (soit trois fois la montée du niveau de la mer à l'échelle mondiale). Elle pourrait atteindre 2,04 mètres d'ici 2050. Une telle élévation inonderait de façon per-manente 60 à 80 kilomètres carrés dans la seule métropole de Manille (Metro Manila). Il faut souligner que ces chiffres n'incluent ni les risques croissants d'inondations fluviales dus à la multiplication des fortes pluies et aux mauvaises pratiques d'aménagement du territoire (déforestation, etc.), ni les impacts potentiels d'une dislocation (probable) d'une partie de la calotte glaciaire antarctique !
Une grande partie des habitant.e.s des bidonvilles vivent dans les zones les plus vulnérables de la baie de Manille. Des millions de personnes pauvres sont menacées, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les digues et autres aménagements ne suffiront pas à prévenir le danger. Au contraire, une telle approche, qui vise à maintenir le statu quo, pourrait aggraver la situation (c'est ce que le GIEC appelle la « maladaptation » : une adaptation qui accroît les risques). Surtout si elle est mise en œuvre de manière technocratique, sans contrôle démocratique ni participation des communautés.
La relocalisation de millions de personnes semble inévitable. Mais elle aussi doit être organisée de manière sociale et démocratique. Très souvent, les catastrophes sont instrumentalisées par les gouvernements pour expulser les populations pauvres. À ma connaissance, c'est le cas à Manille. Selon certaines études, 6 000 ménages ont été relogés dans des zones dépourvues d'accès aux services essentiels, transformées en nouveaux bidonvilles. Le dernier rapport du GIEC mentionne qu'à Manille, « la fragmentation des infrastructures urbaines, censée promouvoir la résilience climatique, n'a entraîné qu'une réduction marginale de la vulnérabilité, l'augmentation de la vulnérabilité des communautés exclues compensant largement la diminution de la vulnérabilité des communautés plus aisées ». La raison est politique : « les plans d'adaptation sont principalement évalués sous l'angle de leur viabilité économique et financière », dit le GIEC.
La relocalisation et les autres mesures d'adaptation constituent des demandes immédiates qui exigent un engagement clair en faveur de la justice sociale, de l'écologie et de la démocratie. La relocalisation, en particulier, implique une planification, la propriété publique des terres, des entreprises publiques pour construire des logements décents dans un cadre urbain de qualité, et un contrôle populaire pour prévenir les scandales de corruption. Plus largement, la relocalisation implique un modèle de développement rompant avec les différentes formes d'extractivisme (exploitation minière, agro-industrie et pêche industrielle) qui alimentent un sous-développement néfaste et inégalitaire (le fait que les Philippines ne soient pas autosuffisantes en production de riz est révélateur). En d'autres termes, lutter contre les menaces socio-écologiques requiert des mesures qui commencent à remettre en question les règles du capitalisme.
UNE LUTTE POUR LE POUVOIR POLITIQUE
Mettre en lumière les problèmes urgents et les relier à des solutions anticapitalistes fut la méthode transitoire employée par Lénine dans son célèbre texte « La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer ». Nous devrions tous le relire, car il est une source d'inspiration.
Un tel plan d'urgence, ancré dans les principaux problèmes et menaces écosociales immédiats, pourrait paraître exagéré, voire irréaliste. Mais il est, hélas, fort probable que l'évolution de la catastrophe révélera sa pertinence et son urgence aux yeux d'une part croissante de la population.
Cette prise de conscience pourrait être plus lente qu'en Russie entre juillet et octobre 1917 (Lénine écrivit « La catastrophe imminente » en juillet). Cela tient au fait que le rythme de la catastrophe écosociale est encore relativement lent pour le moment. Mais ce rythme n'est pas linéaire, une accélération soudaine est probable. Il nous faut tirer la sonnette d'alarme avec vigueur :
Comme je l'ai mentionné précédemment, la probabilité de la dislocation d'un immense glacier en Antarctique (le glacier Totten) est très élevée. Nul ne sait quand cela se produira, mais les scientifiques la considèrent comme inévitable et cette dislocation provoquera une montée immédiate du niveau de la mer d'au moins 1,5 m.
À titre d'exemple, selon le GIEC, le réchauffement climatique et la disparition des récifs coralliens pourraient entraîner une baisse de 50 % du potentiel halieutique maximal des eaux philippines d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2001-2010.
D'après le World Resources Institute, le pays connaîtra une pénurie d'eau sévère d'ici 2040, avec des conséquences néfastes, notamment pour l'agriculture (baisse de 10 % du rendement du riz par degré Celsius de réchauffement).
Bien entendu, un tel plan d'urgence pour la justice sociale et écologique n'est envisageable que s'il s'inscrit dans une lutte pour le pouvoir politique. En effet, la réalisation du plan suppose un gouvernement fondé sur les besoins et la mobilisation des classes populaires, rompant avec les dogmes capitalistes, la corruption, l'extractivisme et la dictature du capital financier.
Un tel gouvernement aurait du mal à résister à l'impérialisme s'il restait isolé, mais la grande similitude des situations en Asie du Sud-Est (les menaces sur Jakarta et Hô Chi Minh-Ville sont très semblables à celles qui pèsent sur Manille) permet d'espérer une extension de la lutte à plusieurs pays.
Notre plus grand souhait est que notre Manifeste encourage la gauche et les mouvements sociaux à élaborer une telle alternative et à s'unir autour d'elle.
Daniel Tanuro
P.-S.
• Version du 30 octobre 2025.
• Traduit de l'original anglais par l'auteur.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Faire la part des choses

Chaque fois que se produit un conflit de travail dans le secteur public ou parapublic, les commentateurs de droite (comme Richard Martineau dans le Journal de Montréal, entre autres exemples) qualifient ce mouvement de revendication ou de « prise d'otages » par les grévistes.
Ils se font ainsi la courroie de transmission du patronat dont ils répètent le discours comme des perroquets. Le présent conflit de travail à la STM en fournit un exemple parfait.
Ces gens qui défendent d'habitude le système capitaliste et minimisent le plus souvent ses abus et méfaits se découvrent soudain une grande commisération pour le pauvre peuple, et en particulier les petits travailleurs victimes de l'intransigeance ou du fanatisme syndical, ce qui confine de leur point de vue, à une forme de criminalité. Pas question pour eux de blâmer la partie patronale (ou alors, si peu), dans ce cas-ci la Société de transport de Montréal, ou STM, et surtout le gouvernement du Québec pour des années de négligence dans le financement des transports publics. Tout au plus, ils affirment que les politiciens n'ont pas toujours assumé leurs responsabilités.
Mais tout d'abord, qui finance les transports publics à Montréal ? Avant tout l'Autorité régionale de transport métropolitain (ou ARTM) qui verse à la STM les montants que lui fournissent les deux paliers de gouvernement, avant tout celui du Québec, mais aussi les municipalités, et les usagers et usagères quand ils paient pour emprunter métro et autobus, puis finalement les automobilistes par le biais de la taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles (celle-ci gérée par la Ville de Montréal). L'ARTM subit un déficit d'investissement important, due à l'insuffisance de la contribution gouvernementale. La STM subit donc les contrecoups de cette déficience de financement par l'ARTM, ce qui a une incidence majeure sur les salaires et les conditions de travail des employés et employées.
Les chauffeurs et opérateurs exigent des horaires plus stables, les employés d'entretien veulent l'élimination, du moins la réduction de la sous-traitance dans l'entretien et la réparation des véhicules et dans la question de la maintenance. Ils réclament la fin des plages de temps non rémunérées. Tous visent à obtenir des augmentations de salaires pour compenser les méfaits de l'inflation. Jusqu'à maintenant, on assiste à un dialogue de sourds entre les parties en conflit. La STM se montre inflexible sur ce qu'elle considère comme essentiel : la « flexibilité » (c'est-à-dire l'acceptation de la sous-traitance) par les syndiqués. On ne fait état d'aucun progrès dans les « négociations ». La rigidité de la direction de la STM provient sans doute du budget serré dont elle dispose. D'ailleurs, depuis des années, sinon des décennies, les travailleurs et travailleuses doivent affronter des reculs à divers degrés dans leurs conditions de travail et leur rémunération. Ce qui se passe présentement à la STM n'a donc rien d'inédit.
Il faut garder en tête ce contexte défavorable et ne pas juger trop vite les employés de la STM. Ils sont victimes de politiques budgétaires et financières restrictives. Ils savent bien aussi qu'ils sont l'objet de la vindicte populaire ; en effet. les usagers et usagères sont frustrés dans leur liberté de mouvement, et ce, à juste titre. Mais il est trop facile de s'en prendre aux syndiqués sans tenir compte de la responsabilité des administrateurs et administratrices de la STM et de l'ARTM, et en définitive des gouvernements, en particulier celui du Québec.
Mais par ailleurs, l'actuelle situation ne peut s'éterniser, pour des raisons que plusieurs commentateurs ont déjà mentionnées, entre autres parce qu'elle nuit à plusieurs travailleurs peu payés aux horaires atypiques et à bien des aînés qui ont du remettre leur rendez-vous médical faut d'être en mesure de se rendre à la clinique ou au bureau de leur médecin. Des événements importants comme le Salon du Livre de Montréal se trouvent aussi menacés cette année à cause de ce conflit de travail. S'il ne se règle pas dans les meilleurs délais (on est déjà le 11 novembre), la tenue de ces événements sera compromise, ce qui constituerait une perte majeure pour la métropole.
Comment s'y prendre alors pour régler ce problème à temps ? Il n'existe pas de solution facile qui satisfasse tout le monde. On peut avancer une suggestion : que la nouvelle administration municipale réunisse au plus tôt les deux parties et fasse pression sur elles afin d'en arriver à une entente rapide, quitte à ce que chacune mette de l'eau dans son vin (surtout la patronale). Si cela s'avère impossible, la mairesse et ses conseillers devront imposer un règlement aussi équitable et équilibré que possible, qui refléterait un « préjugé favorable aux travailleurs » pour reprendre la formule utilisée durant son mandat initial de premier ministre entre 1976 et 1980. Mais cette fois, pour vrai.
Jean-François Delisle
Nota bene
Dans mon analyse parue la semaine dernière (numéro du 4 au 10 novembre) et intitulée : « L'indépendance, dépassée ou pas ? », j'ai commis une erreur. En effet, le cinquième paragraphe de mon texte débutait par la phrase suivante : « La réforme progressiste du marché de l'emploi... », alors qu'il aurait fallu lire : « La réforme restrictive du marché de l'emploi... ».
Désolé pour cette faute due à la fatigue et à la distraction. Elle contredit mon propos qui attaquait au contraire les politiques néolibérales menées à divers degrés par les différents gouvernements tant péquistes que libéraux et conservateurs, que ce soit à Ottawa ou à Québec.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le SPGQ invite la ministre à sortir de son bunker

Québec, le 5 novembre 2025 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) accueille avec beaucoup de méfiance le projet de loi déposée aujourd'hui par la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, sur la réduction de la bureaucratie et l'efficacité de l'État.
« On n'est pas contre la vertu, bien entendu, mais ça fait déjà un an que ce gouvernement prétend couper dans la bureaucratie sans toucher aux services aux citoyens, alors que c'est faux ! J'invite Mme Duranceau à arrêter de gérer l'État avec des fichiers Excel et à sortir un peu de son bunker pour rencontrer le personnel. Elle va constater à quel point on a coupé n'importe qui n'importe comment dans les derniers mois et que les services à la population sont bel et bien touchés. Nos membres constatent tous les jours des augmentations des délais et la disparition de services », dénonce Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.
Mensonge
La ministre est complètement déconnectée du terrain. « Elle ment lorsqu'elle déclare en conférence de presse que ce ne sont que des départs à la retraite et des postes vacants qui sont abolis. Dans les derniers mois, nous avons des appels chaque semaine de personnes qui ont vu leur contrat prendre fin avant terme ou qu'on a mises à la porte parce qu'elles n'avaient pas leur permanence », rappelle M. Bouvrette.
Jusqu'à maintenant, la présidente du Conseil du trésor n'a même pas daigné rencontrer les syndicats représentant le personnel de la fonction publique, malgré leurs demandes répétées.
Améliorer l'efficacité de l'État
Par ailleurs, si le gouvernement veut réellement améliorer l'efficacité de l'État, le SPGQ est troublé par le silence de Mme Duranceau sur la sous-traitance. « Actuellement, des personnes sont mises à la porte et sont remplacées par des consultants à gros prix dans les jours qui suivent. Ça paraît bien de diminuer le nombre d'employés, mais il n'y a aucune économie, ça coûte même plus cher ! Le scandale SAAQclic a abondamment démontré que le privé est loin d'être plus efficace », souligne M. Bouvrette.
Fusions et abolitions d'organismes
Le SPGQ est prudent quant aux annonces de fusions et d'abolitions de nombreux organismes, dont l'INESSS et l'INSPQ. « Il va falloir analyser le projet de loi plus en profondeur, mais de prime abord, nous sommes préoccupés par le maintien des missions et de l'expertise d'organisations parfois bien différentes dans l'intérêt de la population. Nous sommes aussi préoccupés par la manière dont seront effectuées les transitions, alors que le personnel de l'État est déjà fragilisé par le fameux “traitement choc” qui comprend le gel d'embauche et les abolitions de postes. Espérons que le gouvernement saura faire les choses de manière plus humaine, cette fois-ci », note M. Bouvrette.
Équiper le TAT
Finalement, le SPGQ s'inquiète du transfert de la mission de la Commission de la fonction publique au Tribunal administratif du travail (TAT). « La Commission déplorait déjà son manque de ressources et le TAT ne manque pas de travail. Il faudra éviter d'allonger les délais ou de tourner les coins ronds pour s'assurer de maintenir le traitement équitable de tous les employés et employées de la fonction publique », indique M. Bouvrette.
À propos du SPGQ
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 34 000 spécialistes, dont environ 25 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.
Source
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mouvement syndical québécois devrait tout autant faire front commun pour défendre le droit de grève

Face au monde patronal qui monte de plus en plus au front pour exiger que Québec déclare illégale la grève dans le transport en commun à Montréal, le mouvement syndical québécois devrait tout autant faire front commun pour défendre le droit de grève
Quand le monde patronal fait front commun pour s'attaquer aux syndicats, comme c'est le cas présentement, dans le cas de la présente grève dans les transports en commun à Montréal, cela devrait être le devoir des syndicats québécois de faire de même, de ne surtout pas laisser seuls les travailleurs actuellement ciblés, de mobiliser leurs membres et de contre-attaquer aussi fort qu'il le faudra pour faire obstacle à cette nouvelle attaque au droit de grève. Notre position.
Pas plus tard que ce matin, le mouvement syndical albertain, par la voie du président de la Fédération des travailleurs de l'Alberta, Gil McGowan, annonçait que son mouvement était en train de préparer une réponse " grande, audacieuse et sans précédent " à la décision récente du gouvernement conservateur de cette province d'adopter une loi spéciale pour briser une grève des 55,000 professeurs de cette province, en n'excluant toujours pas, en même temps, la possibilité de même tenir une grève générale contre ce gouvernement.
Le mouvement syndical albertain n'est pourtant pas reconnu comme étant particulièrement militant et pourtant, eux, comprennent que lorsqu'on est attaqué, il faut savoir faire front commun.
Plus souvent qu'autrement, tel n'est pas ce qu'ils auront fait et à chaque fois, il l'auront payé chèrement.
La grande question, que tous et toutes devraient se poser en même temps est la suivante : si, même en Alberta, les gens semblent prêts à s'unir selon le principe " Une attaque contre un est aussi une attaque contre tous ", alors qu'attendons-nous pour faire de même ?
Qu'attendons-nous pour avertir dès à présent le gouvernement Legault du fait que si celui-ci devait effectivement aller de l'avant avec sa nouvelle menace de devancer la mise en application de sa fameuse loi 89, pour casser sans plus attendre la grève, qu'alors ils devraient tout autant être prêts à en payer le prix, et cela, pas juste dans un avenir qui resterait vague au possible, mais bien dès à présent, et que cela lui coûtera aussi très cher.
Depuis plusieurs jours, autant les Chambres de Commerce , que le Conseil du Patronat, que diverses autres associations patronales répètent à l'unisson que la grève actuelle au niveau du transport en commun à Montréal serait intolérable et exige haut et fort que le gouvernement Legault bouge sans plus tarder contre ces travailleurs.
Même la nouvelle mairesse de Montréal, soit Soraya Martinez Ferrada, toute très libérale qu'elle était et demeure, s'est joint à ce mouvement. Elle n'est supposée entrer en fonction que dans plusieurs semaines, mais déjà, elle serait intervenue pour dire qu'elle désirait dire, haut et fort, que la date limite pour mettre fin à cette grève serait le 15 novembre. Pas plus tard.
Le mouvement syndical québécois ne doit pas juste faire front commun. Il doit dès à présent commencer à hausser le ton et faire comprendre autant à madame Ferrada, qu'au gouvernement Legault, ainsi qu'à tout le monde patronal, qu'aussi forts qu'ils peuvent penser être, que le mouvement syndical, lui, peut être encore plus fort.
Tel est ce que nous pensons que les syndicats, à ce point, devraient faire. S'ils ne le font pas, alors ce sera une porte ouverte pour que tout ce beau monde renchérisse également dans un paquet d'autres conflits de travail à venir pour répéter le même scénario et continuer de s'en prendre à eux.
Oui, une solution négociée serait toujours possible. Encore faudrait-il que la partie patronale, du côté de la STM, veuille en même temps vraiment négocier, et non juste se rabattre sur cette loi 89 qui s'en vient et, dans leur tête, pourra toujours finir par s'abattre sur les syndiqués. La population montréalaise, de son côté, devrait aussi rappeler à nos politiciens qui sont les vrais responsables du merdier actuel, ainsi que le fait que ce ne sont pas les travailleurs de la STM qui seraient à pointer du doigt dans tout cela et qu'eux aussi se retrouvent tout autant pris dans une situation très difficile.
Le fait que le ministre du Travail, soit Jean Boulet, ait en même temps — cela se passait également il y a quelque jours — son autre projet de loi, avec le NO 3, qui est l'autre volet de son offensive anti-syndicale, avec cette fois d'autres mesures visant cette fois à restreindre les sources de revenus des syndicats, démontre on ne peut mieux l'urgence de réagir. Tout de suite et ce, de manière non équivoque.
Le PQ devrait tout autant sortir haut et fort pour dénoncer la manière dont la CAQ, de concert avec la nouvelle mairesse, ainsi que de larges sections du monde patronal, dans cet autre dossier chaud, tente désespérément de manipuler l'opinion publique dans un but au fonds abject.
Madame Soraya déclarait encore ce soir que les syndicats avaient le devoir de négocier, comme si c'était eux qui refusaient de négocier. C'est le monde à l'envers, mais le mépris, lui, n'aura qu'un temps.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dans une tente au centre de Gaza, un festival du film féminin voit le jour

Organisé sur six jours la semaine dernière, le premier Festival international du cinéma des femmes est “une affirmation que Gaza aime la vie malgré le génocide.”
Tiré d'Agence médias Palestine.
Au bout d'un tapis rouge de fortune déroulé entre des bâtiments détruits à Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, quelques dizaines de Palestinien-nes étaient assis devant un grand écran de télévision. Le silence tomba lorsque le film commença : les spectateurs, tour à tour concentrés et en larmes, voyaient leurs expériences des deux dernières années se refléter à l'écran pendant une heure et demie. Le film, intitulé « La voix de Hind Rajab », marquait l'ouverture du premier Festival international du cinéma des femmes de Gaza.
« J'ai pleuré en regardant le film », confie Nihal Hasanein, l'une des spectatrices, au magazine +972 après la projection du 26 octobre. Plus tôt dans l'année, elle a perdu trois de ses fils dans une frappe aérienne israélienne sur sa maison à Beit Lahiya ; elle vit désormais dans le camp d'Al-Jazaeri, à Deir Al-Balah, où la projection a eu lieu.
« Cela a ravivé le souvenir de la perte de mes enfants, tous en même temps, et de ma maison », dit-elle.
Réalisé par la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, La voix de Hind Rajab reconstitue le meurtre de la fillette de cinq ans et de six membres de sa famille par des soldats israéliens, alors qu'ils tentaient de fuir Gaza-Ville en voiture en janvier 2024. Présenté en avant-première au Festival de Venise en septembre, le film a reçu le Grand Prix du Jury et une ovation debout de 23 minutes. Il a ensuite remporté plusieurs autres récompenses prestigieuses, devenant l'une des œuvres arabes les plus saluées de l'année. La projection à Gaza, au sud de la ville natale de Rajab, était la première dans le monde arabe.
Le Festival international du cinéma des femmes de Gaza a été lancé par le cinéaste et chercheur palestinien Ezzaldeen Shalh, ancien président de l'Union internationale du cinéma arabe, en collaboration avec le ministère palestinien de la Culture et plusieurs institutions cinématographiques locales et internationales.
Selon lui, le festival vise à mettre en avant des films produits, réalisés ou écrits par des femmes, particulièrement palestiniennes, mais aussi du monde arabe et au-delà, abordant les questions féminines.
La première édition, organisée sous le slogan « Femmes légendaires pendant le génocide », cherchait à mettre en lumière la souffrance des femmes palestiniennes au cours des deux dernières années et à relancer la vie culturelle de Gaza. « Il fallait une plateforme artistique qui représente les femmes palestiniennes et leur permette de raconter leurs histoires au monde à travers leur propre regard », explique Shalh.

Du 26 au 31 octobre, dates coïncidant avec la Journée nationale de la femme palestinienne et l'anniversaire du premier Congrès des femmes palestiniennes en 1929, le festival a présenté près de 80 films venus d'une vingtaine de pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Europe et des Amériques. Plus de 500 personnes ont assisté aux projections, un chiffre modeste comparé à l'époque d'avant-guerre, où plus de 2 000 personnes par jour participaient à des festivals culturels similaires à Gaza.
Aux côtés de Ben Hania, le festival a rendu hommage à deux autres figures féminines dont le travail a servi la cause palestinienne : la cinéaste palestinienne Khadijeh Habashneh et la réalisatrice libanaise Jocelyne Saab (décédée). Le jury comptait des personnalités telles que Anne-marie Jacir, Céline Sciamma et Jasmine Trinca.
Yusri Darwish, président de l'Union générale des centres culturels en Palestine, a salué le festival comme « une nouvelle affirmation que Gaza aime la vie malgré le génocide, et qu'elle peut transformer les décombres en écran et la tristesse en message d'espoir ».
Darwish a ajouté que la tenue du festival à ce moment précis était « un hommage aux femmes palestiniennes qui ont enduré les horreurs de la guerre, la perte, la détention, le déplacement, et qui méritent que leurs histoires soient racontées au monde avec honnêteté et justice ».
Surmonter les obstacles
Selon Shalh, le principal défi fut de trouver un lieu pour le festival, car « tous les espaces de ce type à Gaza ont été détruits ». L'équipe a dû installer des tentes provisoires sur fond de bâtiments partiellement effondrés ; faute d'électricité, les projections ont été alimentées par générateur. « La communication avec les réalisateurs et le jury a également été difficile », a-t-il ajouté.
Les conditions à Gaza ont rendu impossible la venue de nombreux spectateurs vivant trop loin. Niveen Abu Shammala, journaliste originaire du quartier de Shujaiya à Gaza-Ville, aujourd'hui déplacée dans une tente à l'ouest de la ville, couvrait autrefois les événements culturels et les festivals de cinéma de la bande de Gaza. Mais cette fois, le coût élevé du transport et l'heure tardive des projections (après 15h30) l'ont empêchée d'y assister.

« Même si la guerre est terminée, on a encore peur de se déplacer la nuit », explique-t-elle. « J'aurais aimé voir les films participants, mais il est presque impossible de les télécharger avec un internet aussi faible. »
Nelly Al-Masri a, elle, pu assister aux projections du deuxième jour, tenues au siège du Syndicat des journalistes. Elle a été particulièrement touchée par le court-métrage jordanien Hind Under Siege, également consacré à Hind Rajab.
« Ce film m'a profondément émue », confie-t-elle à +972. « Il parlait au nom de tous les enfants de Gaza, pas seulement de Hind. »
Elle aurait voulu voir davantage de films, mais le coût du transport, la difficulté d'obtenir nourriture et eau potable, et la prise en charge de ses enfants l'en ont empêchée. « Beaucoup de femmes vivent la même situation », dit-elle. « Nous espérons que les conditions à Gaza s'amélioreront. »
La petite Hamsa Mahmoud, 10 ans, ne connaissait pas le festival avant de voir des foules se rassembler près des tentes installées à proximité de chez elle. Elle a fini par assister à plusieurs projections.
« C'est la première fois que je vais à un festival », raconte-t-elle. « J'étais heureuse d'être là, encore plus heureuse de pouvoir regarder quelque chose sur un écran. Depuis le début de la guerre et les coupures d'électricité, on n'a plus rien pu regarder. J'aimerais qu'il y ait plus de festivals comme celui-ci. »
Une autre participante, Faten Harb, militante communautaire, voit dans le cinéma un moyen essentiel de renforcer la résilience des femmes palestiniennes à Gaza. « L'art est un message noble, le moyen le plus simple et le plus direct d'atteindre le monde sans trop parler », dit-elle.
« Le monde est fatigué d'entendre parler de morts, de destructions et de blessés », poursuit-elle. « C'est pourquoi nous devons trouver d'autres façons de transmettre la souffrance du peuple de Gaza. Nous avons urgemment besoin de ce genre d'événements pour mettre en lumière ce qui s'est passé dans la bande de Gaza pendant la guerre génocidaire, surtout pour les femmes, qui ont été les plus touchées. »
Traduction : RM pour l'Agence Média Palestine
Source : +972mag
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le choix des mots Persévérance ou résilience ?

Le terme résilience, qui était jusqu'alors propre au domaine de la physique, a fait son entrée dans le domaine de la psychologie dans les années 1980.
(Ce texte a d'abord été publié dans l'édition de novembre du journal Ski-se-Dit.)
Il devait se répandre une dizaine d'années plus tard au secteur de la gouvernance, puis à une foule d'autres domaines. Son caractère de plus en plus vague, se prêtant à une foule de définitions, tantôt englobantes, tantôt générales, a certainement contribué à sa propagation.
L'importation de ce concept issu de la physique dans le domaine des affaires humaines nous offre un bon indice de sa véritable fonction dans le discours. Désignant la capacité d'un corps à retrouver sa forme d'origine après avoir subi une déformation, son application à des êtres pensants – comme à des objets ou à de la matière – suppose qu'il est de la nature des humains de se remettre d'une situation difficile et même d'en sortir grandi.
Le terme a en fait de plus en plus remplacé dans le discours celui beaucoup plus précis et humain de persévérance, terme qui implique un effort de volonté, de patience, de courage et même d'abnégation, pour poursuivre une action malgré les difficultés – caractéristiques qui ne sauraient, bien sûr, s'appliquer à des objets ou à de la matière. La persévérance ne mène pas toujours aux résultats voulus, mais elle demeure tout de même louable aux yeux de tous.
Deux caractéristiques implicites de cette résilience appliquée aux humains sont pour le moins… déshumanisantes.
La première est que ce concept vague dérivé de la physique pose comme prémisse qu'il est de la nature humaine – je déteste ce terme – de franchir des obstacles et d'en sortir grandi. Sans que cela ne soit explicité, il suppose une défaillance chez ceux qui n'y parviennent pas. Or, certains obstacles sont infranchissables pour certaines personnes dans bien des contextes. Accepter cette prémisse, c'est donc fermer les yeux sur la misère sociale et se refuser à remettre en cause, solidairement, les structures sociales responsables de cette misère. C'est aussi générer insidieusement un sentiment d'échec ou d'inaptitude chez ceux et celles qui ne sont pas en mesure de « profiter » des difficultés rencontrées et des souffrances éprouvées.
La seconde, qui dérive de la première, est son caractère essentiellement individualiste, d'où son essor fulgurant dans les domaines managérial et entrepreneurial. Le concept entérine la souffrance psychologique comme une nécessité liée à l'avancement personnel au détriment de l'autre, dans une lutte à plusieurs. C'est le contraire de la solidarité et des luttes communes si nécessaires de nos jours en vue d'un monde meilleur, égalitaire et pleinement soucieux de protéger son environnement.
Nous devons persévérer, collectivement, pour faire de ce monde un monde égalitaire, fraternel et libre. Et c'est seulement à partir de cette valeur strictement humaine qu'est la persévérance, valeur que l'on s'efforce de banaliser ou de remiser, que nous y parviendrons.
Le mot résilience, sorti des limites de la physique, est un mot du domaine de la novlangue, un mot que nous devrions, en ce sens, bannir de notre vocabulaire !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Armement nucléaire - La course à la bombe : encore ?

L'arme nucléaire revient sur le devant de la scène internationale, avec les annonces successives, par Vladimir Poutine, du développement de nouveaux armements, et par Donald Trump de la reprise d'essais. Les traités de limitation des armements sont de plus en plus ignorés et cette nouvelle course entre les deux (anciens) Grands de la guerre froide pourrait, cette fois, inciter plusieurs nouveaux participants à entrer dans la compétition…
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
1er novembre 2025
Par Cyrille Bret
Depuis une semaine, l'actualité stratégique est devenue retro. Elle a repris une chorégraphie très « années 1950 » car elle a été bousculée par le retour du nucléaire au-devant de la scène internationale.
Le 26 octobre dernier, en treillis et en vidéo, Vladimir Poutine présente (à nouveau) le missile expérimental russe Bourevstnik (« annonceur de tempête »), doté d'une tête et d'un système de propulsion nucléaires. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'un drone sous-marin à propulsion nucléaire, le Poséidon, déjà présenté il y a quelques années, d'avoir les honneurs des autorités russes qui proclament qu'il est indétectable et pourrait venir percuter les côtes ennemies et y faire exploser une charge nucléaire. Enfin, le 29 octobre, Donald Trump annonce sur le réseau Truth Social la reprise des essais pour « les armes nucléaires », une première depuis l'adoption du Traité sur l'interdiction des essais nucléaires en 1996.
Cette guerre des communiqués a déclenché l'onde de choc d'une bombe – médiatique, fort heureusement – dans les milieux stratégiques. En effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la guerre d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, le bombardement de l'Iran par les États-Unis et la guerre Inde-Pakistan du début de l'année, l'attention des analystes militaires s'était portée sur les armements traditionnels (blindés, missiles, munitions, chasseurs) et sur les systèmes innovants (drones, artillerie mobile, munitions guidées, bombes perforatrices).
Dans cette séquence en Technicolor et en Mondovision, tout se passe comme si le célèbre Dr. Folamour du film de Stanley Kubrick (1964) faisait son grand retour : ce personnage de fiction, scientifique nazi employé par l'armée américaine, paraît comme rappelé à la vie par la nouvelle guerre froide que se livrent les grandes puissances militaires dotées de l'arme atomique, à savoir les États-Unis, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, respectivement pourvues d'environ 3700, 4200 et 600 ogives nucléaires. Ce parfum de course à la bombe fleure bon les années 1950, les Cadillac roses et les défilés sur la place Rouge.
Pourquoi la course aux armements nucléaires est-elle aujourd'hui relancée, du moins au niveau médiatique ? Et quels sont les risques dont elle est porteuse ?
Essais nucléaires américains et surenchères médiatiques
En annonçant la reprise des essais nucléaires sur le sol des États-Unis, Donald Trump s'est montré aussi tonitruant que flou. Dans ce domaine-là comme dans tous les autres, il a voulu claironner le Make America Great Again qui constitue son slogan d'action universelle pour rendre à l'Amérique la première place dans tous les domaines.
En bon dirigeant narcissique, il a voulu occuper seul le devant de la scène médiatique en répliquant immédiatement aux annonces du Kremlin. En bon animateur de reality show, il a volé la vedette atomique à son homologue russe. Invoquant les initiatives étrangères en la matière, il a endossé son rôle favori, celui de briseur de tabous, en l'occurrence le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) adopté en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies, avec le soutien des États-Unis de Bill Clinton, érigés en gendarme du monde.
Le message trumpien procède d'une surenchère évidente sur les annonces du Kremlin : comment Donald Trump aurait-il pu laisser toute la lumière à Vladimir Poutine en matière d'innovations nucléaires de défense ? Il lui fallait réagir par une annonce plus forte, plus choquante et plus massive. C'est tout le sens de la reprise des essais sur « les armements nucléaires ». Personne ne sait s'il s'agit de tester de nouvelles ogives, de nouveaux vecteurs, de nouveaux modes de propulsion ou de nouvelles technologies de guidage. Mais tout le monde retient que c'est le président américain qui a officiellement relancé et pris la tête de la course mondiale à la bombe. C'était le but visé. Examinons maintenant ses conséquences.
À moyen terme, cette déclaration n'a rien de rassurant : les États-Unis, première puissance dotée historiquement et deuxième puissance nucléaire par le nombre d'ogives, envoient par cette annonce un « signalement stratégique » clair au monde. Ils revendiquent le leadership en matière d'armes nucléaires (dans tous les domaines) en dépit du rôle essentiel qu'ils ont joué depuis les années 1980 pour le contrôle, la limitation et la réduction des armes nucléaires.
En effet, les différents traités signés et renouvelés par Washington – Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (1987), START I (1991), II (1993) et New START (2010), TICEN, etc. – avaient tous pour vocation de dire au monde que les États-Unis se donnaient comme horizon la dénucléarisation des relations internationales ainsi que de l'espace et même la suppression de l'arme comme le souhaitait le président Obama.
Avec cette annonce – qu'on espère réfléchie même si elle paraît compulsive –, les États-Unis changent de rôle mondial : ils cessent officiellement d'être un modérateur nucléaire pour devenir un moteur de la nucléarisation des relations internationales.
L'avenir du nucléaire : dissuasion ou suprématie ?
La tonalité qui se dégage de cette guerre des communiqués atomiques ressemble à s'y méprendre à la première guerre froide et à la course-poursuite à laquelle elle avait donné lieu. Après avoir conçu, produit et même utilisé l'arme atomique en 1945 contre Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis avaient continué leur effort pour obtenir la suprématie nucléaire dans le domaine des vecteurs, des milieux (air, terre, mer) et des technologies de guidage. L'URSS de Staline avait, elle, d'abord cherché à briser le monopole américain sur l'arme nucléaire puis gravi tous les échelons technologiques pour devenir une puissance nucléaire à parité avec ce qu'on appelait alors le leader du monde libre.
Le pivot historique doit être noté, surtout s'il se confirme par une course aux armements. Jusqu'à la guerre d'Ukraine, les armes nucléaires faisaient l'objet de perfectionnements technologiques réguliers. Mais le cadre de leur possession restait inchangé : elles devaient constituer un outil de dissuasion. Autrement dit, elles devaient rester des armements à ne jamais utiliser. Les signalements stratégiques sont aujourd'hui sensiblement en rupture avec cette logique établie depuis les années 1980.
Depuis le début de la guerre d'Ukraine, le Kremlin laisse régulièrement entendre qu'un usage sur le champ de bataille (le fameux « nucléaire tactique ») n'est pas à exclure en cas de risque pour les intérêts vitaux russes. De même, les États-Unis viennent de faire comprendre que leur priorité n'est plus la lutte contre la prolifération nucléaire, qu'elle soit nord-coréenne ou iranienne. Si le message de Donald Trump sur Truth Social est suivi d'effets, la priorité nucléaire américaine sera la reconquête de la suprématie nucléaire en termes de quantité et de qualité.
Autrement dit, les anciens rivaux de la guerre froide relancent une course aux armements nucléaires au moment où les instruments internationaux de limitation et de contrôle sont démantelés ou obsolètes. Ils ne luttent plus pour se dissuader les uns les autres d'agir. Ils participent à la course pour l'emporter sur leurs rivaux. Le but n'est plus la MAD (Mutual Assured Destruction) mais la suprématie et l'hégémonie atomique.
L'effet d'imitation risque d'être puissant, donnant un nouvel élan aux proliférations.
De la compétition internationale à la prolifération mondiale ?
Si les annonces russo-américaines se confirment, se réalisent et s'amplifient sous la forme d'une nouvelle course aux armements nucléaires, trois ondes de choc peuvent frapper les relations stratégiques à court et moyen terme.
Premier effet de souffle, au sein du club des puissances officiellement dotées de l'arme nucléaire au sens du Traité de Non-Prolifération(TNP), la République populaire de Chine ne pourra pas se laisser distancer (quantitativement et qualitativement) par son rival principal, les États-Unis et par son « brillant second », la Russie. En conséquence, la RPC s'engagera progressivement dans un programme visant à combler son retard en nombre de têtes et dans la propulsion des vecteurs. Cela militarisera encore un peu plus la rivalité avec les États-Unis et « l'amitié infinie » avec la Russie. Il est à prévoir que de nouveaux armements nucléaires seront développés, adaptés à l'aire Pacifique et dans les espaces que la Chine conteste aux États-Unis : Arctique, espace, fonds marins… Il est également à prévoir que la Chine s'attachera à développer des systèmes de lutte contre ces nouveaux vecteurs à propulsion nucléaire.
Le deuxième effet sera, pour les Européens, une interrogation sur les ressources à consacrer à leurs propres programmes nucléaires, de taille réduite car ils sont essentiellement axés sur la dissuasion stratégique. S'ils refusent de s'y engager pour concentrer leurs ressources sur les armes conventionnelles, ils risquent un nouveau déclassement. Mais s'ils se lancent dans la compétition, ils risquent de s'y épuiser, tant leur retard est grand. Nucléarisés mais appauvris. Ou bien vulnérables mais capables de financer le réarmement conventionnel.
Enfin, le troisième effet indirect des déclarations russo-américaines sur la reprise de la course aux armements sera la tentation, pour de nombreux États, de se rapprocher du seuil afin de garantir leur sécurité. Si l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Pologne et même le Japon et l'Allemagne considèrent que leur sécurité nécessite des armes nucléaires et que le cadre du TNP est obsolète, alors la prolifération risque de reprendre de plus belle, à l'ombre des menaces nord-coréennes et iraniennes.
De Dr. Folamour à Dr. Frankenstein
Les annonces russes, américaines et, n'en doutons pas, bientôt chinoises sur les armements nucléaires présagent d'une nouvelle phase dans les affaires stratégiques, celle d'une compétition majeure sur toutes les technologies liées à ces armes complexes. Si la tendance se confirme, les armes nucléaires, leurs vecteurs, leurs usages et leurs doctrines seront de nouveau propulsés au premier plan du dialogue compétitif entre puissances. Et l'espace sera lui-même susceptible de devenir le nouvel espace de la compétition nucléaire.
Vivons-nous pour autant une régression historique vers la guerre froide ?
La donne est bien différente de celle des années 1950, quand le but des puissances communistes était de rattraper leur retard sur les armes américaines (acquisition de la bombe, passage au thermonucléaire). Et le débat stratégique est bien distinct de celui des années 1970, quand la compétition était quantitative (combien de têtes ? Combien de vecteurs ?).
Aujourd'hui, les risques liés aux armes nucléaires sont différents : démantèlement progressif des traités de limitation et de contrôle de ces armes, tentation retrouvée de se porter au seuil pour les puissances non dotées et surtout réflexion sur un usage (et non plus sur la dissuasion).
Ce n'est pas Dr. Folamour qui a connu une résurrection, c'est un nouveau Dr. Frankenstein qui s'est lancé dans des expérimentations.
Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
< !—> The Conversationhttp://theconversation.com/republishing-guidelines —>
P.-S.
• The Conversation. Publié : 1 novembre 2025, 15:21 CET.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.Lire l'article original.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le syndicalisme étatsunien à l’ère de Trump : notes sur une table ronde

Labor Notes, un site internet mettant en réseau des syndicalistes étatsunien·nes, organise depuis le début du mois d'octobre une série de tables rondes sur le thème : « Comment les syndicats peuvent-ils défendre le pouvoir des travailleurs contre Trump 2.0 ? ». Le site publie au fur et à mesure les textes des intervenant·es, des dirigeants syndicaux et des universitaires.
Nous proposons ici une synthèse de ces différents textes en français afin de faire ressortir certains éléments qui permettent d'éclairer l'action et le rôle politique des syndicats dans un contexte "autoritaire". Des débats qui pourraient notamment intéresser les syndicalistes au Québec au moment où le Gouvernement Legault multiplie les attaques antisyndicales.
À titre d'exemple, la lecture de ces textes oblige notamment à mettre en perspective le silence assourdissant des centrales syndicales québécoises sur le terrain politique, comme l'atteste par exemple, leur mutisme lors de la campagne électorale des municipales de Montréal de 2025. Ce silence était d'autant plus incompréhensible et irresponsable quand on garde en tête que pendant la campagne, les travailleurs et travailleuses de la Société du transport de Montréal (STM) étaient en grève. Mais ce silence apparait tout bonnement sidérant quand on se rappelle qu'au même moment les syndicats New Yorkais, sous la pression de la base, s'engageaient politiquement et appelaient massivement quant à eux, à voter pour le programme de Zohran Mamdani dont certaines mesures faisaient alors le tour du monde, comme la gratuité des bus, l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et travailleuses et un réinvestissement massif dans le secteur des transports collectifs.
L'urgence d'agir
Pour le moment, cinq articles ont été publiés. Les textes proviennent de dirigeants d'importants syndicats dans l'enseignement, comme Alex Caputo-Pearl de l'United Teachers Los Angeles (UTLA) Jackson Potter de la Chicago Teachers Union (CTU), de Peter Olney, un ancien dirigeant d'un syndicat de dockers (ILWU), de Rand Wilson membre d'un syndicat dans le secteur des microprocesseur (CHIPS Communities United), Jimmy Williams président de l'International Union of Painters and Allied Trades qui représente environ 140,000 travailleurs dans la construction ou des universitaires comme Kate Bronfenbrenner et Eric Blanc.
Ces différents textes mettent tous l'accent, d'une façon ou d'une autre, sur l'urgence d'agir : « can't afford to wait » souligne Kate Bronnefender. Et il ne s'agit pas seulement de l'urgence à lutter contre les employeurs mais bien plus largement de s'organiser politiquement face à une attaque organisée menée par une oligarchie de milliardaires néofascistes complètement fous de la Silicon Valley et d'un gouvernement ouvertement à son service.
Les auteurs rappellent ainsi le licenciement de 13 % des 2,4 millions de fonctionnaires du pays, soit 312 000 personnes par Elon Musk ou l'abolition par décret du droit de négociation collective d'un million de fonctionnaires fédéraux dans plus de dix ministères, détruisant de facto les syndicats, notamment dans le secteur des services sociaux et de santé. Ils insistent également sur les interventions militaires à Los Angeles et Washington, les rafles menées par les agents de l'ICE, le ciblage systématique des étrangers, la brutalité des interpellations, le chantage du Gouvernemental aux investissements et aux subventions fédérales à des fins politiques, le redécoupage de la carte électorale etc. ; bref, « le temps presse » pour reprendre Peter Olney et Rand Wilson.
Curieusement, les termes fascisme ou néofascisme ne sont pas mobilisés, peut-être parce que tous les syndicats ne sont pas encore interdits et peuvent encore s'exprimer et agir. En revanche, le régime est toujours qualifié d'autoritaire. Et le mouvement syndical est présenté comme l'un ou le dernier rempart. À titre d'exemple Alex Caputo-Pearl et Jackson Potter rappellent ainsi que :
« L'histoire nous montre que lorsque l'autoritarisme fait son apparition, son implantation dépend de la réponse du mouvement syndical. C'est pourquoi les syndicats doivent être au centre du mouvement anti-autoritaire naissant qui se manifeste dans les efforts visant à construire une coalition pro-démocratique plus large sous des slogans tels que « No Kings » (Pas de rois) et « Workers Over Billionaires » (Les travailleurs avant les milliardaires) ».
Des centrales syndicales majoritairement contre Trump
Aujourd'hui 10% des travailleurs et des travailleuses aux États-Unis sont syndiqué·es contre 20 à 25% dans les années 1980. La très grande majorité le sont dans le secteur public (33% de syndiqués contre 6% dans le privé). C'est donc au moins 15 millions de travailleurs et de travailleuses qui sont organisé·es syndicalement, et l'immense majorité sont affiliés à la plus grande centrale, l'AFL-CIO.
Dans leur synthèse Jackson Potter et Alex Caputo-Pearl estiment que cinq des dix plus grandes organisations syndicales internationales du pays (« international unions » ) doivent être
« considérées comme faisant partie du front progressiste, compte tenu du soutien majoritaire de leurs membres à Kamala Harris pour les élections de 2024 et de l'élaboration de programmes politiques qui rejettent le virage autoritaire ».
C'est en particulier le cas des trois plus grands syndicats du secteur public :
– la National Education Association (NEA ; 3 millions de membres)
– l'American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME ; 1.4 million de membres)
– et l'American Federation of Teachers/American Association of University Professors (44 000 membres) (AFT/AAUP) – (respectivement 1.8 million de members et 44 000 membres)
C'est aussi le cas, de deux syndicats regroupant divers secteurs publics et privés, le Service Employees (SEIU) (deux millions de membres) et l'UAW (400 000 membres) .
Les auteurs soulignent que plus de 50 autres syndicats internationaux affiliés à l'AFL-CIO ont également clairement manifesté leur opposition à Trump. De même, de nombreuses directions syndicales ont affiché un soutien sans ambiguïté aux mouvements de solidarité avec les immigrants et aux manifestations pour les libertés civiles, comme par exemple, le syndicat des infirmières (National Nurses United, 220 000 membres) .
En revanche d'autres centrales ont choisi d'appuyer Trump. C'est notamment le cas du syndicat des Teamsters (4e plus grand syndicat des États-Unis et le plus important dans le secteur privé, avec 1.3 million de membres, qualifié par un spécialiste de « syndicat corrompu » ) qui soutient ouverment Trump et les Républicains, au nom de la défense de l'emploi étatsunien . Son président, Sean O'Brien (qui avait obtenu le soutien de Labor Notes lors de sa campagne… ), s'est même présenté à la Convention nationale républicaine au milieu de la campagne électorale. D'autres syndicats dans la construction ont également apporté leur soutien à Trump même si, soulignent Peter Olney and Rand Wilson, Sean McGarvey, le président de la North America's Building Trades Unions (environ 3 millions de membres dans la construction ) a clairement dénoncé le programme de Trump, au service « des plus riches d'Amérique ».
Bref, à l'exception notable des Teamsters et de certains syndicats moins importants, on retient que les grandes structures syndicales ont majoritairement manifesté leur opposition à Trump.
Des centrales syndicales apathiques et aux stratégies de mobilisation contestées
Malheureusement cette condamnation semble s'être essentiellement limitée à des prises de paroles, des communiqué de presse et des recours judiciaires.
Plusieurs textes dénoncent ainsi l'apathie des centrales syndicales et une action « largement limitée au dépôt de plaintes judiciaires » . C'est le cas, notamment, de la Fédération américaine des employés du gouvernement (AFGE), qui représente 800 000 fonctionnaires fédéraux, et qui a décidé de contester la suppression des syndicaux fédéraux, tout en sachant pertinent que la Cour suprême valide à validé, jusqu'à présent, à peu près tout ce qu'avait demandé le Gouvernement Trump :
« Beaucoup trop de démocrates et de dirigeants syndicaux ont naïvement espéré que les tribunaux nous sauveraient. Mais la Cour suprême a donné son feu vert à la prise de pouvoir de Trump et semble prête à invalider la section 2 du Voting Rights Act, dernier obstacle juridique majeur empêchant les républicains de priver de leurs droits électoraux des millions de démocrates et d'électeurs noirs dans tout le Sud ».
L'apathie est telle que le 2 novembre 2025, les dirigeants des syndicats d'enseignants de Chicago et de Los Angeles (CTU et UTLA), ont estimé nécessaire d'appeler de nouveau l'AFL-CIO à s'engager activement contre le gouvernement de Trump et exigé de la plus grande centrale étatsunienne qu'elle ait le courage d'appeler à remettre en cause l'ordre établi .
Au mieux, certains textes soulignent le relatif succès de la campagne may2028.org, impulsé par le président de l'UAW, Shawn Fain. Cette action consiste à fixer la date d'expiration des conventions collectives au premier mai 2028 afin de pouvoir, légalement, déclencher un vaste mouvement de grève. Certes, l'initiative a reçu le soutien d'autres secteurs d'activités que l'automobile (dont des syndicats de la CWA, du SEIU, UNITE HERE, de l'UE, de l'AFT et des affiliés nationaux et locaux de la NEA). Le problème cependant est la date retenue : mai 2028. Sur ce point, les auteurs sont unanimes pour dire que les travailleurs et les travailleuses ne peuvent pas attendre trois ans pour réagir.
Bref, les recours judiciaires et la mobilisation may2028, restent les principales actions organisées à l'échelle des grandes centrales syndicales identifiées dans ces textes.
La mobilisation des syndicats locaux dans les mobilisations historiques de 2025
En contrepoint, les textes insistent sur l'implication des organisations syndicales de base, dans les mobilisations exceptionnelles de 2025. Certaines organisations ont même été à la pointe de la contestation, comme lorsque Trump a envoyé des militaires à Los Angeles, Washington D.C. et Chicago.
« Les syndicats d'enseignants et de travailleurs des services ont été les plus virulents et les plus actifs. En juillet, 1 400 personnes ont envahi le centre des congrès de Los Angeles pour participer à une « formation à l'action directe non violente » principalement parrainée par la Fédération syndicale du comté de Los Angeles ».
Ce sont également des syndicats d'enseignant·es qui mènent activement des actions visant pour faire des écoles des « sanctuaires » pour les migrants pourchassés par l'ICE. Ils adoptent ainsi des résolutions rappelant que le personnel scolaire ne doit jamais demander le statut d'immigrant, en conserver trace ou le divulguer ou que es agents fédéraux ne sont pas autorisés à pénétrer dans nos écoles sans mandat judiciaire . Ce sont aussi des organisations syndicales de base, qui ont organisé des actions telles que le « Tesla Takedown », les rassemblements devant les magasins Whole Foods appartenant à Amazon ou qui ont créé la coalition Athena qui relie les vastes activités anti-Bezos/Amazon.
Mais surtout, de nombreuses organisations locales se sont jointes aux manifestations nationales exceptionnelles de l'années 2025, participant ainsi aux réseaux tels que 50501, Indivisible Fight Back Table (qui est présentée comme l'organisation ayant organisé les marches #HandsOff le 5 avril), Labor on the ligne etc.
Parmi ces mobilisations les plus importantes, les auteur·es rappellent :
– « Hands Off ! National Day » - 5 avril 2025
Il y a un débat sur le nombre de personnes qui ont manifesté le 5 avril. Dan la Botz, qui en a dressé un compte-rendu, parle dans tous les cas de millions de personnes dans les 50 États américains, et de plus 1 600 manifestations dans les grandes et petites villes, en défense de la démocratie, des droits reproductifs, des LGBTQ+, des immigrants, de la sécurité sociale, des services publics etc.
– May day strong (“Workers Over Billionaires”) – 1er mai 2025
Plusieurs textes insistent également sur le succès des manifestations du 1er mai 2025, qui fut également historique :
« Cela a fonctionné au-delà de ce que nous pensions possible. Cette année, nous avons eu le plus grand nombre de marches du 1er mai de l'histoire des États-Unis. La fête du Travail, quant à elle, est passée de 25 barbecues initialement prévus par l'AFL-CIO à 1 200 événements dans les 50 États, la fédération adoptant le message « Les travailleurs avant les milliardaires » » .
– « No Kings », manifestations exceptionnelles des 14 juin et 18 octobre et… 22 novembre 2025
Mais ce sont surtout les deux grandes manifestations sous le thème « No Kings » du 14 juin et du 18 octobre 2025 qui ont marqué les esprits l'attention ; « les plus importantes de l'histoire des États-Unis » souligne Eric Blanc . Les chiffres de 13 millions de manifestant·es le 14 juin et de 7 millions lors de la manifestation d'octobre sont avancés. On peut rappeler que le samedi 22 novembre, No Kings appelle de nouveau à marcher sur Washington et dans tout le pays.
Et pour toutes ces mobilisations les auteur·es insistent en particulier sur deux choses : l'implication de nombreux syndicats locaux et l'absence des centrales syndicales.
Propositions d'actions : boycott et syndicalisation
Les différents textes ne se contentent pas de faire un bilan des actions et mobilisations. Ils suggèrent également des pistes d'actions. Parmi celles-ci, Caputo-Pearl et Potter rappellent le succès de certaines campagnes de boycott, comme celle menée par le Black Clergy (clergé noir) contre Target qui a décidé de supprimer ses actions en faveur de la diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), ou celle invitant à la résiliation des abonnements chez Disney pour avoir retiré Jimmy Kimmel de l'antenne .
Dans son étude sur l'évolution des stratégies de syndicalisation, Kate Bronfenbrenner , invite quant à elle les centrales syndicales à revoir leurs stratégies, qui sont principalement restées centrées ces dernières années sur la syndicalisation « des petites unités des secteurs à but non lucratif, des médias et des services » et « des unités d'étudiants diplômés d'universités privées telles que Columbia, le MIT et Cornell » ; des secteurs considérés comme « plus faciles » à syndiquer.
En revanche, les centrales ont délaissé les campagnes de syndicalisation dans les grandes entreprises, celles qui pèsent sur l'économie et les choix politiques du gouvernement Trump ; elle souligne en ce sens que les apparentes « victoires » en termes de syndicalisation chez Amazon, Starbuck, REI et Trader Joe's etc., très médiatisées, n'ont cependant pas permis la conclusion d'une seule convention collective, les employeurs refusant de négocier avec le syndicat. Ce à quoi on rajoutera que quand ils sont contraints de négocier, comme au Québec, ces mêmes multinationales préfèrent fermer et sous-traiter, comme l'a fait Amazon à Montréal. Kate Bronfenbrenner invite alors les syndicats à mener la lutter auprès de ces grandes structures et à multiplier les actions :
« Aussi difficile que cela puisse être, les syndicats doivent syndiquer les travailleurs des entreprises les plus grandes et les plus puissantes du pays, et ils ne peuvent pas se permettre d'attendre une réforme du droit du travail ou une administration plus favorable pour le faire » .
La question de la grève sociale et des grèves illégales
Mais c'est surtout la question des grèves et de la grève sociale ou politique qui est discutée par les auteurs. Pour Éric Blanc par exemple, il semble certain que « la tactique la plus efficace pour exprimer ce type d'alliance anti-autoritaire large est une grève générale à grande échelle, parfois appelée « grève politique », qui inclut non seulement les travailleurs, mais aussi les gouvernements locaux, les églises, les médias, les associations professionnelles et même certaines entreprises qui soutiennent le mouvement ».
Le problème ici serait tout à la fois politique et juridique. D'un point de vue politique, les textes soulignent à plusieurs reprises que les travailleurs et les travailleuses étatsuniennes n'ont plus l'expérience des grèves, alors que le nombre d'arrêt de travail a considérablement chuté depuis les années 80. Ainsi pour Alex Caputo-Pearl and Jackson Potter :
« nous devons être lucides : notre mouvement syndical n'est pas en état de lutter. La plupart de nos syndicats n'ont pas l'expérience récente de la grève ou de l'action collective conflictuelle ».
Un autre problème, davantage juridique, est la peur de déclencher une grève, sachant que la grève est interdite pour les non syndiqué·es et que pour ces derniers elle n'est légale que lors des rares périodes de négociations collectives. « Notre plus grand obstacle reste un sentiment omniprésent de peur et d'impuissance, en particulier parmi les classes populaires », estime ainsi Eric Blanc.
Ce dernier préconise alors le recours à deux tactiques concrètes : des grèves stratégiques menées par des groupes syndiqués, relativement protégés et ayant des liens communautaires profonds (comme les étudiants et les enseignants) et des perturbations/manifestations visant à bloquer le fonctionnement des institutions , sur le modèle des mobilisations des immigrants en 2006, Occupy Wall Street en 2011 ou Black Lives Matter en 2020. Aussi, parmi les actions « disruptives », Eric Blanc évoque, notamment des « Freedom Friday », invitant les étudiants et leurs professeurs à manifester tous les vendredis après-midi ou les « Mass Black Out » . Parmi les autres actions « disruptives » il évoque les pistes suivantes :
« Les entreprises pourraient mettre fin à leur collusion généralisée avec le régime, signer des engagements en faveur de la démocratie, fermer volontairement leurs portes le jour de l'action, afficher des posters « No Kings » dans leurs vitrines ou sur leurs pages web, ou au moins choisir de ne pas pénaliser ceux qui se mettent en grève ou se font porter malades. Les districts scolaires pourraient combiner la fermeture des écoles, des séances d'information de masse et des sorties scolaires pour assister à des rassemblements. Les églises et les élus locaux pourraient soutenir la journée d'action et contribuer à mobiliser les participants (…) ».
Plusieurs textes invitent également les travailleurs et les travailleuses à user des stratégies de contournement, pour éviter d'être dans l'illégalité, comme le recours à des congés maladies. On rappelle ainsi que c'est en mobilisant les arrêts de travail pour cause de maladie qui ont permis à des millions d'immigrants et autres « de descendre dans la rue le 1er mai 2006 pour protester contre le projet de loi anti-immigrés draconien de Sensenbrenner ».
Enfin, une autre solution mise de l'avant est d'inviter les syndicats à négocier une date de fin des conventions collectives commune, afin de permettre la grève du plus grand nombre au même moment. Nous l'avons vu, c'est la stratégie développée par l'UAW dans le secteur automobile avec le lancement de la campagne may2028.org. Mais c'est aussi la stratégie retenue par les sections locales d'éducateurs de Californie, qui ont formé la California Alliance for Community Schools et lancé la campagne We Can't Wait avec 32 sections locales qiu ont aligné les dates d'expiration des contrats dans tout l'État .
Bref, les auteur·es étudiés ici, appellent tout à la fois à la construction d'une large alliance, vers la grève sociale ou politique et à la multiplication des actions de terrains, de blocage à plus ou moins grande échelle.
“Get politics out of our union” ?
Mais curieusement, il est très peu question dans ces textes du rapport des syndicats aux partis politiques, si ce n'est le texte Peter Olney et Rand Wilson, qui appellent à soutenir les candidats démocrates, pro-travailleurs, face aux Républicains . On a parfois l'impression que la lutte syndicale peut se suffire à elle-même pour renverser ce régime néofasciste, ce qui nous semble très douteux d'un point de vue historique.
Une exception notable est le texte de Jimmy Williams, le président de l'International Union of Painters and Allied Trades . Celui-ci rapporte que nombreux membres demandent au syndicat de ne pas faire de politique : “ I often get comments that we need to “get politics out of our union”. Certes, souligne-t-il, il est épuisant de parler de politique « quand les deux partis continuent de nous décevoir tous ».
Le problème c'est « que cela nous plaise ou non, les décisions prises par nos responsables politiques ont un impact majeur sur notre syndicat, notre portefeuille et nos communautés ».
Alors pour ce dirigeant syndical :
« Si nous voulons vaincre Trump et tout autre politicien anti-ouvrier, nous aurons besoin d'ouvriers organisés. Nous ne pouvons pas nous recroqueviller et espérer que la prise de pouvoir autoritaire de Trump passe. Nous devons organiser de nouveaux membres, construire un pouvoir politique indépendant dans nos communautés et éduquer nos collègues et nos communautés sur les enjeux. Nous devons tenir pour responsables tous les politiciens qui ne sont pas favorables aux travailleurs, quel que soit leur parti et leur rhétorique (…) Nous avons besoin d'une armée de travailleurs qui comprennent l'histoire de leur syndicat et du mouvement syndical, et qui sont prêts à se battre pour un nouveau mouvement syndical, tout comme nos ancêtres l'ont fait pour les générations futures ».
Il s'agit là, nous semble-t-il, d'une prise de position politique qui mériterait minimalement d'être débattue au Québec. Et pour ouvrir la discussion, un tel appel à s'engager sur le terrain politique pourrait par exemple être mis en rapport avec le silence assourdissant des centrales syndicales québécoises lors des dernières élections municipales de novembre 2025. Le cas échéant, on rappellera alors que sous la pression de leur base militante, les syndicats New Yorkais se sont clairement engagés en faveur de Zohran Mamdani. Et depuis, ils s'organisent concrètement pour lutter contre une éventuelle occupation de New York par la garde nationale : Hands Off NYC.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.